« Il faut s’adapter »
Sur un nouvel impératif politique
Barbara Stiegler
NRF Essais, 2019
Un livre qui a la force de déranger les idées préconçues et de bousculer les certitudes. Barbara Stiegler, professeur de philosophie politique à l’université Bordeaux Montaigne, revient sur un mot qui est employé à tort et à travers, dont on se gargarise ou qu’on dresse comme un épouvantail, mais sans qu’il ne soit défini : le néolibéralisme. Ce concept est un inconnu célèbre, ou comme l’objet d’une rumeur, qui finit par exister à force de passer de bouche en bouche, mais sur le mode d’un fantôme sans forme précise, changeant et menaçant : personne ne sait ce qu’il est, personne ne l’a vu, mais chacun s’est convaincu de son existence. Il en va de même du néolibéralisme. « Il faut s’adapter » se propose d’éclairer ce concept à partir d’une figure méconnue en France, mais dont l’importance fut décisive aux Etats-Unis dans les années 20 et 30 : Walter Lippmann. Barbara Stiegler croise la pensée de ce journaliste-philosophe avec celle d’une autre grande figure de l’époque, le philosophe pragmatiste John Dewey, dont la confrontation avec les thèses de Lippmann fut cristallisée par la controverse du Lippmann-Dewey Debate qui fit couler tant d’encre.
Les origines darwiniennes du néolibéralisme
Revenons d’abord sur le titre de l’ouvrage. Stiegler soutient que la nouvelle injonction du néolibéralisme qui naît à la fin des années 30, en rupture avec le libéralisme classique et son « laisser-faire », est désormais celle-ci : « il faut s’adapter ». S’adapter aux conditions du capitalisme, au monde en perpétuel changement, aux rythmes accélérés par la mondialisation, aux flux qui vont et qui viennent en donnant le tournis. Adapter la société et « libérer les énergies », promouvoir les mobilités, la « flexibilité »… Toute ressemblance avec un dirigeant français actuel ne serait pas purement fortuite… Voilà pour l’usage superficiel de l’adaptation. Mais plus profondément, la rhétorique de l’adaptation se fonde, comme le montre de manière très convaincante Barbara Stiegler, sur une lecture de l’évolutionnisme darwinien. L’adaptation néolibérale est avant tout une adaptation de l’espèce, au sens darwinien. Walter Lippmann (1889-1974) fut lui-même très fortement impressionné par les thèses de l’Origine des espèces, qu’il commenta et utilisa afin d’élaborer ses propres conceptions politiques et philosophiques. Ce journaliste influent est l’un des pères du néolibéralisme, qui vit le jour notamment grâce au Colloque Lippmann en 1938 réunissant la plupart des grands noms de ce qui allait devenir le néolibéralisme. Au « darwinisme social » d’Herbert Spencer, Lippmann oppose une lecture plus fine de l’œuvre de Charles Darwin. D’abord, Lippmann critique vertement la téléologie spencerienne, c’est-à-dire le fait que l’évolution soit orientée, pour Spencer, vers un but ultime. Lippmann lui rétorque qu’il n’y a pas de but, pas de telos prédéterminé. Ensuite, il ne s’agit plus de laisser faire (comme chez Spencer) la sélection naturelle tous azimuts qui se chargera bien d’éliminer les faibles pour peu qu’on ne la contrarie pas – telle est la lecture simpliste et caricaturale qu’en fait le « darwinisme social » – mais de comprendre que la modernité, en particulier la révolution industrielle, a créé un « décalage de rythme entre les penchants naturels de l’espèce humaine, hérités d’une longue histoire évolutive se modifiant au rythme très lent de l’histoire biologique et les exigences de notre nouvel environnement, imposées brutalement par la révolution industrielle. »(p.14). Il y a un hiatus entre l’adaptation de l’espèce humaine qui s’est faite au long des millénaires au grès des changements progressifs de son environnement, et la violente rupture de l’ère industrielle qui bouleverse tout et tout le temps. Bref, à cause de l’accélération inédite imposée par la révolution industrielle capitaliste, la nature n’arrive plus à suivre. De là vient toutes les mentions au « retard » de nos sociétés, que l’on nous ressert à chaque « réforme ». Dès lors, « comment réadapter l’espèce humaine à un environnement instable, constamment changeant et complètement ouvert ? »(p.14) Telle est la problématique nouvelle que pose Lippmann. Tout l’enjeu, sera donc de créer les conditions de cette réadaptation.
On le voit, le « nouveau libéralisme » lippmannien rompt avec le non-interventionnisme des pères fondateurs du libéralisme : il faut au contraire un politique pro-active, interventionniste voire intrusive afin de réadapter les hommes au capitalisme. Ici, Barbara Stiegler adresse une critique percutante à Lippmann. Ce dernier n’envisage l’adaptation que comme adaptation au capitalisme. Sous-entendu : le capitalisme est le nouvel environnement de l’Homme. Qu’est-ce qui permet d’affirmer une telle chose ? En disant cela, Lippmann fait du capitalisme le milieu « naturel » de l’Homme, il le naturalise et le pose comme horizon indépassable. On ne peut sortir du capitalisme, « there is no alternative » dira plus tard Margaret Thatcher. Le capitalisme, soutient Lippmann, est la destinée ultime de l’Homme, son telos. Il fait exactement ce qu’il reprochait à Spencer : il pose un sens de l’évolution, un but prédéterminé. Arbitraire pur.
John Dewey, partant d’un constat assez similaire, à savoir l’inadéquation moderne de l’Homme avec son environnement, arrive à une conclusion inverse. Pour lui, ce n’est pas tant l’Homme qui est en retard et qu’il faut réadapter, que l’environnement moderne (capitaliste) qui est inadapté à l’Homme et l’empêche d’exprimer toutes ses potentialités. D’une certaine manière, on pourrait dire que Dewey prône la réadaptation de l’environnement capitaliste à l’Homme. Deux voies radicalement opposées quant aux solutions, bien que basées toutes deux sur une fine lecture du darwinisme. Barbara Stiegler explore longuement les similitudes de surfaces entre les deux penseurs américains pour en débusquer les divergences profondes, et montre comment le Lippmann-Dewey Debate structure très intimement nos débats contemporains.
Le gouvernement des experts
Réadapter l’Homme, voilà le programme lippmannien. Comment ? « Posant dès son premier livre le diagnostic d’une mauvaise orientation naturelle des impulsions, qu’il imagine figées par l’histoire évolutive, Lippmann en appelle déjà à une transformation profonde de l’espèce humaine par le gouvernement des experts. »(p.34) Après la Première Guerre Mondiale, Lippmann ne croit plus à la démocratie telle qu’elle avait pu être pensée jusque-là, car elle repose sur une fiction : « l’omniscience du sujet citoyen et […] la prétendue sagesse de la volonté populaire. »(56) Or, la démonstration semblait faite, au sortir de la boucherie de 14-18, que la volonté populaire est défaillante, mal orientée, et que le peuple n’est capable que de passions irrationnelles, figé dans ses « stases »[1] pour employer le mot de Barbara Stiegler. En effet, réadapter l’Homme, c’est par-dessus tout le réadapter au flux, et donc combattre toute forme de stase, de fermeture, de conservatisme. Si donc le peuple n’est qu’une « masse informe », il n’est plus qu’un troupeau à domestiquer. Il lui faut donc des maîtres, des bergers qui le guideront vers l’adaptation : ce seront les « experts ». Lippmann entend liquider la vieille démocratie croulante, lui préférant une masse docile conduite par des experts clairvoyants qui feront son bonheur malgré elle.
Je suis ici volontairement caricatural. Lippmann était lui-même plus subtil que cela, et surtout n’a cessé d’hésiter, d’évoluer ou plutôt d’osciller sur ce point. L’une des forces de l’ouvrage de Barbara Stiegler est de montrer les atermoiements de Lippmann ; « Il faut s’adapter » nous montre une pensée dynamique qui se déploie de manière non linéaire, avec ses revirements, ses cahots mais aussi ses constances. En fin de compte, Lippmann considère que les citoyens, la « masse », doivent se contenter de consentir aux décisions expertes. Les dirigeants devront recourir pour ce faire à la « fabrique du consentement » des masses, selon la formule célèbre de Lippmann lui-même, à l’aide des procédés issus de la propagande. Ils devront atteindre une « fabrication industrielle et technoscientifique du consentement »(67). « L’opinion publique se trouve ainsi définie comme une masse de supporters, qui « suit » (follow) ou ne nuit plus, qui « s’aligne » ou ne s’aligne plus, derrière tel ou tel champion. »(88-89) Lippmann rejette toute forme de conflit politique, au nom de l’efficacité des réformes à prendre, réformes qui, selon la lecture qu’il fait de l’évolution darwinienne, doivent se succéder de manière graduelle et insensible, presque continue mais sans brusquer les choses.
Lippmann oppose clairement, on le voit, la passivité (des masses) à l’activité (des leaders), et l’innovation (des leaders) à la stabilité (des masses). Or, Dewey dénonce ces oppositions et montre qu’elles sont totalement dépassées et stériles : partant lui aussi de Darwin, il affirme que la vie est à la fois active et passive, et que la stabilité (l’habitude) est tout autant féconde que l’innovation. Toute la difficulté selon Dewey est de penser la nécessaire tension entre ces pôles, et non de la rejeter. Il faut, d’une certaine manière, parvenir à une certaine subtile alchimie entre passivité et activité et composer avec le flux et la stase. C’est parce qu’il part de ces tensions irréductibles qu’il ne cherche pas à réduire que Barbara Stiegler qualifie Dewey de « tragique » au sens Nietzschéen. De plus, si Lippmann ne considère le public que comme une « masse », Dewey lui oppose l’existence d’une intelligence collective capable d’expérimentations qui font « progresser » tout un chacun et le groupe dans son ensemble – dissolvant là encore l’opposition entre l’individu et le collectif. Dewey défend une démocratie participative forte qui ne se réduit pas à une « participation au débat » ni à une simple « consultation préalable des citoyens en vue de la délibération finale des décideurs »(159).
Rééduquer les masses
Lippmann reprend au bon vieux libéralisme l’idée d’un individu a priori, isolé, opposé au groupe, d’une monade qui se fait seule, mue par son seul intérêt. C’est le thème de l’atomisation salutaire, dans l’esprit des libéraux, qu’il faut encourager. De la mise en concurrence et en compétition des individus atomisés naît une sorte d’harmonie. Cependant, le néolibéralisme rompt brutalement avec l’homo oeconomicus des anciens libéraux, cet être calculateur, rationnel et intéressé. On l’a dit, Lippmann considère que les individus sont par essence irrationnels, passionnés, pulsionnels, etc. Ce qui implique qu’ils doivent être rééduqués. Chez Lippmann, le gouvernement des experts, donc, devra redresser les masses et, toujours dans la perspective darwinienne, mettre en place une série d’ambitieuses réformes sociales afin que la compétition entre individus se fasse à armes égales. Le but est de faire en sorte que seules les inégalités intrinsèques (naturelles) déterminent les gagnants et les perdants de la mise en compétition généralisée : mettre tout le monde sur un pied d’égalité, sur la même ligne de départ, pour que seule la vélocité des coureurs fasse la différence. En somme, l’idéal est une compétition généralisée mais loyale. Cela pose d’immenses problèmes, nous y reviendrons.
On voit d’ores et déjà se dessiner le programme néolibéral. « Refusant à la fois la Providence de la nature et le contrôle de l’avenir par l’intelligence collective des publics, le nouveau libéralisme théorisé par Lippmann décidera de s’en remettre, d’une part, aux artifices du droit et, d’autre part, à la réadaptation forcée des populations aux exigences de la mondialisation, passant par une politique publique invasive, chargée de transformer activement les dispositions et les comportements de l’espèce humaine. »(187) Le dispositif juridique et judiciaire joue un rôle fondamental dans la réadaptation de l’espèce humaine au capitalisme mondialisé. Le droit est la courroie de transmission du néolibéralisme, c’est par lui qu’il faut redresser les hommes, voire les dresser tout court : ici se préfigure la « judiciarisation générale des rapports sociaux »(195) qui fait tant de dégâts aujourd’hui et transforme l’Homme en un être borné, tatillon, procédurier, chicaneur et rigide. Cependant, le droit ne doit pas être prescriptif, ne doit pas dire ce qu’il faut faire, mais se contenter d’être un simple « code de la route », l’expression est de Lippmann. La question que ne se pose en revanche pas Lippmann est de savoir si à force de dire ce qu’il ne faut pas faire, on n’en vient pas in fine à déterminer en creux ce qu’il faut faire. En somme, à force de baliser les voies à ne pas suivre, on finit par ne laisser qu’un seul chemin praticable. Voilà pour le droit.
Pour ce qui est des politiques publiques intrusives de réadaptation, il s’agit essentiellement de la santé et de l’éducation. Lippmann préconise des politiques fortes en matière de santé publique et de prévention – politiques sur bien des aspects très bénéfiques. Pour le journaliste américain, il faut non seulement traiter les conséquences de la pauvreté, mais aussi et surtout ses causes, par l’impôt, prélevé sur les plus riches. De même, Lippmann tient un discours que l’on qualifierai aujourd’hui d’écologiste avant l’heure en considérant l’environnement comme un bien commun à préserver, la condition de possibilité du capitalisme même. Cependant, dans le domaine de la santé, Lippmann va jusqu’à justifier un certain eugénisme, au nom du Darwinisme et de l’adaptation de l’espèce humaine. Afin d’améliorer toujours plus l’adaptation humaine, il prône l’amélioration de l’homme : « Ici s’esquissent les premières justifications politiques d’une « augmentation » illimitée des performances de l’espèce humaine »(258-259) : le transhumanisme se profile à l’horizon. De même en matière d’éducation, l’école ne doit plus viser l’émancipation, mais la polyvalence, la flexibilité et l’adaptabilité des individus, bref, leur « employabilité »(267).
Tout doit être mis en place pour redresser les masses, qui doivent être mises au service du capitalisme mondialisé et de la « division internationale du travail ». Quitte à utiliser des moyens disciplinaires au sens de Michel Foucault. Le gouvernement des experts doit apporter les solutions techniques aux problèmes posés, l’objectif étant celui de la compétition entre tous, à armes égales. C’est oublier que même à armes égales, il y a toujours des vainqueurs et des vaincus. Le néolibéralisme – suivant son ancêtre – leur oppose le mépris des winners : « malheur au vaincu ! » En effet, Lippmann ne semble pas se préoccuper du sort des losers, des perdants. Mais surtout, comment décider de qui gagne et qui perd ? Selon quels critères ? Qui décide de ce qu’il faut considérer comme « supérieur » ? Pourquoi valoriser la compétition et la rapacité et non l’entraide – dont Darwin lui-même dit qu’elle est un facteur d’évolution ? Au nom de quoi faudrait-il une « compétition qui permette d’établir des inégalités intrinsèques et légitimes entre les individus »(239) ? Tout cela relève du pur arbitraire, de présupposés contingents, les soustraire à la délibération collective, comme l’entend Lippmann, est absurde et mortifère.
Conclusion
Pour finir, quelques mots sur « Il faut s’adapter ». C’est un livre absolument passionnant, écrit avec un souci pédagogique évident, et surtout une grande honnêteté intellectuelle. Barbara Stiegler, dont on sent qu’elle-même ne porte pas le néolibéralisme dans son cœur, ne cherche jamais à faire de Lippmann un épouvantail, mais au contraire à restituer la complexité de sa pensée, son cheminement intime et montre ses ambiguïtés. « Il faut s’adapter » est aussi l’occasion de (re)découvrir la pensée de John Dewey et du pragmatisme américain. Un livre qui a les qualités d’un ouvrage universitaire : la précision, la rigueur, le respect des sources ; tout en gommant les aspects repoussants de la chose : pas de jargon, pas de références inaccessibles au non-expert, pas de ratiocinations infinies… Un livre bien écrit et au bon tempo. C’est un livre qui remet en cause la vision vulgaire que l’on peut se faire du néolibéralisme en le présentant comme une philosophie subtile et consistante. Stiegler termine en interrogeant le rôle historique de Lippmann et en rappelant que le néolibéralisme est lui-même multiple, fait de pensées diverses parfois contradictoires. Tenter de plaquer la pensée de Lippmann sur le monde contemporain en pensant avoir découvert le Saint Graal serait idiot, bien que les similitudes soient parfois grandes. On ne peut s’empêcher au long du livre de faire des allers-retours entre les années 30 du colloque Lippmann au cours duquel se joue le destin du néolibéralisme et le monde actuel. Un personnage en particulier apparaît comme un héritier troublant de Lippmann, Emmanuel Macron, dont les discours autant que les politiques semblent tellement correspondre aux préconisations du New-Yorkais. Ce qui, en fin de compte, ne peut que faire frémir.
[1] « Terme générique avec lequel je propose de désigner tout ce qui relève d’un effort des vivants pour ralentir ou stabiliser artificiellement le flux du devenir »(14-15).
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



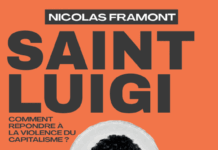




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)


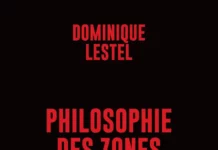





[…] l’université de Bordeaux-Montaigne spécialiste de Nietzsche. En 2019, paraît le retentissant « Il faut s’adapter », qui remet en cause la vision traditionnelle du néolibéralisme à partir de la figure de l’un […]
[…] une demande et une mise en concurrence des idées. Le paradigme du marché a infiltré, selon les projets des fondateurs du néolibéralisme, les institutions chargées de l’élaboration et de la diffusion de l’opinion publique. Mais […]
[…] sont capricieux, c’est que le peuple est capricieux. Pile je gagne, face tu perds. C’est l’argument néolibéral par excellence, celui qui ne considère le peuple jamais que comme une masse pulsionnelle, informe, incapable de […]