
Dans le précédent article, Science et écologie, le dialogue impossible ? nous pointions la nécessité de fonder l’écologie sur des bases avant tout philosophiques, politiques et morales. Nous avons essayé de montrer que, loin d’être inquiétée par la science, même quand celle-ci semble la contredire, l’écologie s’enrichit à son contact. Nous avons aussi dit la nécessité de fonder l’écologie sur des principes « ascientifiques » c’est-à-dire non pas opposés à la science, mais hors de son domaine. Non pas contre elle, mais sans elle. Voyons donc à présent les principes qui peuvent nous permettre d’élaborer un discours écologique, sur quelles prémices on peut s’appuyer, et au nom de quoi refuser un progrès attrayant mais parfois mortifère.
Principes philosophiques
1-Rester humain
L’écologie est avant tout une nécessité philosophique, esthétique, vitale. S’il faut être écologiste, c’est pour que notre monde reste habitable et que nous restions des « humains » – qu’une étymologie sans doute fantaisiste fait dériver du latin « humus », la terre, le sol. Nous sommes tous et toutes ces êtres profondément à l’image de notre créatrice, la Terre. Créatrice immanente, bien sûr, sans volonté ni projet, créatrice comme le sac et le ressac sont créateurs en sculptant les falaises, comme les nuages sont les créateurs de ces cristaux irisés aux formes uniques sophistiquées, harmonie au comble du sublime, mais fragiles et évanouissants. L’animal humain – comme tout être vivant – est indissociable de la planète qu’il habite et qui l’a forgé. Nous sommes, nous autres êtres humains, ces paysages, ces climats, nous sommes ces journées, ce rythme de vingt-quatre heures, nous sommes minéraux parmi les minéraux, plantes parmi les plantes, animaux parmi les animaux, nous sommes la Lune qui brille au-dessus de nos têtes et les ciels étoilés de l’été, nous sommes cette hygrométrie particulière, nous sommes cette lumière chaude d’il y a huit minutes, venue du Soleil, nous sommes les saisons – deux ou quatre peu importe –, nous somme l’odeur des roches, nous sommes le feutre du brouillard et le satin des ciels laiteux, nous sommes le fracas des cataractes, le murmure d’un courant d’air et l’écho des cimes, nous sommes la putréfaction de la vie qui engendre la vie, nous sommes, nous aussi, bleus comme une orange. Cela signifie que ce que nous sommes est intrinsèquement façonné par notre appartenance à la Terre. La physiologie, cela est évident, n’est telle que parce qu’elle fut confrontée à l’environnement terrestre, Darwin nous l’a appris. Mais notre psyché également, en tant que produit d’une physiologie particulière en situation dans un monde particulier : notre façon de penser n’est pas étrangère à la Terre que nous habitons. Dit autrement, il n’y a d’êtres humains que sur cette planète-là. Que nous venions à la quitter, ou à la détruire, et nous ne serions plus des êtres humains. Ainsi, l’écologie est avant tout une nécessité pour l’humanité en tant que telle.
Bouleverser le monde terrestre, donc notre rapport à celui-ci, a des conséquences très profondes sur l’humanité et plus largement, sur toute forme de vie. Le goût des aliments, frelaté par l’agriculture moderne et l’agroalimentaire, a un impact sur ce que nous sommes. Mais aussi les odeurs, auxquelles nous ne savons plus prêter attention : le vent n’est déjà plus qu’un relent. Et que dire de la pollution lumineuse, la nuit, qui prive 20% de l’humanité – et combien d’animaux et de plantes ? – de l’éclat des étoiles ? Qu’est-ce qu’une humanité incapable de lever les yeux, et de noyer son regard dans l’infini du cosmos ? Une humanité dépravée, à n’en point douter.
2-Ecologie du Beau
Allons plus loin. Si l’environnement fait partie intégrante des individus qu’il accueille, si donc nous sommes à ce point façonnés par notre milieu et les interactions que nous avons avec lui, il est évident que notre appréhension esthétique du monde est atteinte en son cœur par sa dégradation. Cet enjeu est d’importance capitale, car la Beauté, et plus largement le sentiment esthétique, est une libération. Ou plutôt, une promesse de liberté, un ailleurs ici-bas. Elle est la transcendance païenne, elle est, avec le sublime, ce « sentiment océanique » cher à Romain Rolland, par lequel nous expérimentons un autre monde au sein du monde. L’expérience esthétique est, d’une certaine manière, la colonne vertébrale de l’âme humaine, si tant est que la distinction de l’âme et du corps ait du sens, ce que je ne crois pas. Or, la nature, le spectacle grandiose du jour, les sommets accablants dont les cimes se perdent dans les nuages, les cirques aux parois rocheuses affûtées comme des lames ; voilà la beauté première, la beauté par excellence car elle nous touche tous et nous élève en même temps qu’elle nous écrase – nous faisant accéder aux deux infinis pascaliens – et alors notre condition, transitoire à jamais imparfaite d’êtres suspendus, nous terrasse. Bref, l’expérience esthétique est nécessaire à l’homme, tout particulièrement celle de la nature, car la plus directe et la plus universelle, la plus “gratuite” également, à tous les sens du terme.
Saccager les paysages c’est donc aussi saccager nos paysages intérieurs. Cette notion de paysage est fondamentale, et trop souvent négligée car improductive et non rentable. L’écologie doit s’en emparer. Il ne s’agit pas seulement de préserver les espèces animales ou végétales, mais aussi les paysages en tant que tels, c’est-à-dire ces espaces naturels (le plus souvent, semi-naturels) qui forgent l’identité visuelle d’une terre, et, oserais-je, d’un terroir. Ce qui faisait dire à Montaigne, revenant d’Italie en passant par les Alpes, « après être sorti tout-à-fait des montagnes, commençai d’entrer aux plaines à la française » : un je-ne-sais quoi de familier. Il y aurait ici fort à dire sur l’humanité hyper-citadine, et l’on pourrait s’interroger avec effroi sur le type d’êtres qu’une telle expérience du monde va produire. Que seront ces individus n’ayant jamais connu que l’odeur de la pollution, des caniveaux, des fumées en tous genres, de l’asphalte bouillant ; ne connaissant que les platanes gris, les pigeons aussi tristes que nous, les massifs mornes des parcs des centres villes, les rares insectes perdus là, et les clébards qui se soulagent sur la chaussée ? Nul ne peut prévoir ce que sera un être humain à ce point coupé de la nature – ou de ce qu’il en reste (coupure qui culmine dans le véganisme : ultime négation, haine parachevée de la nature et de l’animalité). La laideur occupe une place particulière dans le dispositif de la modernité : elle est partout. La laideur des villes aux constructions sans âmes, froides, difformes, anguleuses, aux couleurs improbables, une laideur mondialisée. Habiter ainsi la laideur a bien évidemment un impact sur le développement des individus, et c’est là une question éminemment politique. Aucune émancipation n’est véritablement possible quand la beauté n’existe plus. La question du philosophe Jaime Semprun prend alors une acuité glaçante : « Quand le citoyen-écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant : Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?, il évite de poser cette autre question, réellement inquiétante : A quels enfants allons-nous laisser le monde ? »
3-L’hybris
L’agriculture productiviste, pilier de la société libérale, entre dans la catégorie de ce que les grecs anciens appelaient la démesure, ou « hybris » en grec, c’est-à-dire l’incapacité de l’homme de tenir sa juste place. L’hybris nomme l’illimitation. La condition humaine est faite de limites, mais de limites floues, qui se dessinent en fuyant, comme l’horizon devant nous qui se dérobe à mesure qu’on l’approche. Ces limites ne sont jamais données, mais elles existent, et les transgresser c’est faire preuve d’hybris. Les conséquences, chez les grecs, sont mises en scène dans les tragédies. Il s’agit d’un pêché immanent, une justice sans justicier, un couperet sans bourreau (le dieu vengeur et irascible de la mythologie peut être vu comme une métaphore). La volonté de maîtrise absolue fait partie de l’hybris. L’écologie devrait être le discours qui nous rappelle constamment que nous sommes finis et limités, à l’image du monde dont nous sommes. Le philosophe Dominique Lestel pose la question « à quoi sert l’Homme ? ». Il y répond : « à tenir sa place d’Homme ». En apparence simpliste, cette phrase résume toute la recherche philosophique depuis sans doute l’aube de l’humanité. Elle recherche en effet la juste place de l’Homme.
L’hybris est une forme de transgression. Mais c’est la transgression de frontières intangibles et peut-être mouvantes. Quoi qu’il en soit, on ne sait qu’on les a franchies qu’au moment où il est déjà trop tard. Il existe pour ainsi dire une continuité entre ce qu’il est possible de faire, et ce qui relève de l’hybris : on ne tombe jamais dans la démesure, on glisse vers elle, par degrés insensibles. Il n’y a point de différence remarquable entre l’hybris et les états antérieurs, de même qu’un voyageur perdu dans la forêt s’y perd petit à petit sans que jamais il ne puisse se dire « je me perds », mais toujours « je me suis perdu ». On ne bascule pas dans l’égarement d’un coup : on ne se perd pas au détour d’un arbre, il n’existe aucun pas qui marque notre perte, juste une succession, un continuum. Cela explique la faculté qu’à l’Homme de se perdre sans s’en apercevoir et pire, tout en pensant aller dans la bonne direction. Les perditions écologiques ne se peuvent comprendre qu’ainsi. Car après tout, il existe un tel continuum dans notre rapport – ambivalent – à la nature. Nos ancêtres aussi fertilisaient leurs terres, luttaient contre tel parasite nuisible, parfois à l’aide de mixtures et de préparations particulières. Quelle différence avec nos intrants actuels ? Ne font-ils point autre chose que prolonger ces techniques avec les moyens de la science moderne ? Hybris. Nous avons glissé dans l’hybris, et s’il n’y a point de différence essentielle entre le purin d’orties et les néonicotinoïdes, ces deux substances relèvent bel et bien de deux mondes incommensurables. Lorsque l’on compare nos pratiques actuelles à celles d’il y a cent ans, en montrant qu’au fond, elles ne seraient pas si différentes, on commet une grave erreur. Comme de dire que la navette spatiale n’est que la traduction moderne de la diligence. Parfois, une différence quantitative (moteurs plus puissants, herbicides plus efficaces etc.) aboutit à un changement qualitatif, le fait est connu. De même que le Mal n’est que le prolongement du Bien. Pour le dire autrement, à vouloir aller plus loin, il arrive qu’on se retrouve ailleurs. La modernité, avec sa promesse du Progrès indéfini comme moteur de l’Histoire, nous a peut-être entraînés vers le Pire.
L’écologie comme impératif moral
1-La responsabilité
L’écologie doit aussi se saisir pleinement de la notion de responsabilité. Nous sommes responsables, de par notre potentiel destructeur, de notre Terre. Dans le film SpiderMan de Sam Raimi, on se souvient de cette phrase prononcée par l’oncle du jeune Peter Parker : « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Phrase magnifique, à laquelle je songe très souvent, car elle est d’une profondeur éternelle. Elle nous permet de comprendre que nous sommes responsables à proportion du pouvoir qui est le nôtre, et celui de l’homme moderne est immense. Plus on est puissant, plus l’utilisation de cette puissance peut amener à des conséquences imprévisibles et dévastatrices. Il y a donc un impératif moral : prendre soin de la Terre comme nous prendrions soin d’un parent. Nous avons une responsabilité envers les écosystèmes que nous détruisons : leur rendre autant qu’ils nous donnent en nous permettant de manger, de nous vêtir, parfois en nous prêtant leur force, ou en étant un abri. La responsabilité, pourtant la vertu des adultes, suppose une forme d’humilité, totalement étrangère à l’homme moderne. Etre responsable, c’est se mettre au service de ce que l’on pourrait écraser, massacrer ou détruire : mettre sa force au service du faible. Avoir le sens des responsabilités, c’est se soucier des conséquences de ses actes. L’homme moderne fait exactement l’inverse. Il utilise sa force pour asservir, abuser et manipuler sans vergogne. A ce compte, il est plus irresponsable qu’un enfant gâté. Par la notion de responsabilité, nous rejoignons celle, fondamentale, de devoir. L’on dit, dans les milieux écologistes, qu’il faudrait donner des droits aux animaux, voire à la Terre. C’est absurde. Si le droit provient d’une forme de contrat, nul animal et nul rocher ne peut signer un tel contrat. D’autant que le droit ne va pas sans devoirs : quels seraient les devoirs d’une feuille morte ? Non, il faut bien plutôt parler de devoirs des hommes envers la nature, la démarche est différente. Le devoir est une notion politique, mais aussi morale, telle qu’analysée par Kant dans Les fondements de la métaphysique des mœurs. Par lui, on peut faire le lien entre les fondements moraux et politiques de l’écologie.
On voit bien que dans cette perspective de responsabilité et dans l’optique de conserver cette humanité qui monte de « l’humus », l’utilisation « d’intrants » chimiques comme on les nomme pudiquement, c’est-à-dire de pesticides, d’herbicides et autres poisons, n’est pas qu’un enjeu de santé publique. Il en va d’un rapport particulier à l’agriculture, donc à la nature toute entière. Ces intrants sont le signe d’une agriculture productiviste et mondialisée. Donc d’une vision mercantile et instrumentale de la terre. Là où la paysannerie suppose de connaître les cycles naturels, de ne point les brusquer sous peine de perdre sa récolte, d’être au fait des subtilités des sols et des différentes semences, des qualités du climat local, de respecter, voire d’aimer ses bêtes et ses semences ; loin de tout cela, on tente, par l’utilisation de telles substances, de maîtriser ces cycles, d’enchaîner ces rythmes, de contrôler tous ces processus. Le glyphosate est ici un exemple terrible en tant qu’herbicide (dont, de surcroît, l’effet persiste dans le sol et l’empoisonne durablement), mais aussi et surtout en épargnant sélectivement les plantes modifiées génétiquement pour y résister. Monsanto crée l’herbicide et les OGM qui y résistent. Une double infamie : les intrants destructeurs et la manipulation du vivant. Bref : se couper de la terre, pour être en position de surplomb. S’arracher à la nature de la sorte, c’est déjà nier un peu de notre humanité. Et c’est aussi courir au-devant de la catastrophe. Ou, devrais-je dire, des catastrophes. Catastrophe climatique, les choses sont connues. Mais aussi catastrophe des écosystèmes et de la biodiversité qui s’effondrent. Or, toutes ces catastrophes nous toucherons de plein fouet ; car elles nous touchent déjà. Pour pallier ces catastrophes engendrées par la technique, nous sommes d’ores et déjà obligés de recourir à toujours plus de technique, en une fuite en avant qui ne pourra que se solder par l’advenue encore plus rapide de ces catastrophes : foncer droit dans le mur en accélérant. L’anthropocène nomme l’impact démesuré de l’Homme sur la planète. Nos sociétés d’hyperconsommation, bouleversent la planète, le climat, les écosystèmes naturels, et les déséquilibrent dangereusement. Voilà pourquoi la question des “intrants” n’est pas qu’une question de santé publique. Ils signent un rapport au monde mortifère dont il faut se déprendre.
2-Nous ne sommes pas seuls sur Terre
Le discours écologique va, on le voit, bien au-delà de la question de la toxicité potentielle du glyphosate ou de celle – bien réelle – des néonicotinoïdes. Nous détruisons notre propre santé, mais aussi celle des insectes, des animaux, des micro-organismes, des plantes qui vivent avec nous sur cette planète. Car nous partageons la Terre avec des milliards d’organismes tout aussi légitimes que nous. S’approprier de la sorte le monopole de la planète est un crime contre la vie animale, végétale ou microscopique. Comment accepter que l’homme dispose ainsi de la Terre comme s’il était seul à l’habiter ? Cette attitude de l’homme moderne est l’inflation à l’échelle planétaire de son orgueil et de sa prétention à la supériorité universelle. Qu’en tant qu’êtres vivants nous soyons pris dans un jeu complexe de relations avec une multitude d’espèces vivantes est une nécessité ; que ces relations soient de coopération, d’entraide ou de prédation. Notre relation aux êtres vivants a toujours été, et pour le mieux, une relation de réciprocité – subie ou voulue – car tels sont les rapports naturels. Vouloir abolir une telle réciprocité – projet exorbitant des végans entre autres – en plaçant l’Homme sur un Aventin moral d’où il toiserait la création entière pour la faire à son image, est le parachèvement fou de la haine de la nature et de la vie. Cette idée de réciprocité des rapports entre êtres vivants est fondamentale. L’homme ne peut se contenter de prendre, il lui faut rendre en retour. Le prédateur qui tue accepte de mettre sa vie en danger, il connaît le prix à payer pour ôter une vie et s’en repaître. L’herbivore qui broute l’herbe est aussi une proie. L’écologie doit nous faire comprendre que nous sommes sans cesse pris dans des jeux de nature, englués dans notre appartenance au monde animal, empêtrés dans notre condition de mammifères. C’est en effet la seule façon de sortir de ce cercle de domination de la planète qui aboutit aux catastrophes que nous connaissons. Acceptons de nous immerger corps et âme dans le flot des cycles vitaux et de la nature, retrouvons ce rapport primitif au monde.
Politique écologique
1-Marche arrière toute ?
Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à la modernité dans ses apports les plus appréciables ni qu’il nous faille redevenir des nomades vêtus de peaux de bêtes et éclairés à la seule lueur des flammes. On peut conjuguer un certain nombre d’instruments technologiques et cette immersion dans la nature. De même qu’on n’est pas condamné à passer par pertes et profits la politique et la démocratie pour retrouver la loi de la jungle. En ce sens, l’écologie n’est pas une idéologie réactionnaire qui considérerait que le salut serait derrière nous et qu’il s’agirait de retrouver cet éden perdu. Cependant, une chose est sûre, il nous faut nous défaire de l’imaginaire libéral progressiste. Il n’y a pas d’écologie possible dans un monde libéral. Monde de l’accumulation, du toujours plus, de la croissance indéfinie : le libéralisme s’effondre sans la croissance et la consommation irrépressible. Cette imaginaire qui nous pousse à produire pour consommer, produire encore pour consommer davantage. Mais aussi l’imaginaire nécessairement mondialiste – et multiculturel – du libéralisme qui génère des pollutions faramineuses. Il est évident qu’une écologie digne de ce nom ne peut qu’être anti-libérale et opposée à la mondialisation sous toutes ces formes. Promotion du local, de la paysannerie, des circuits-courts, de la réutilisation… Se nourrit-on moins bien lorsque nos aliments sont produits près de chez nous ? Bien sûr que non.
J’ai dit que l’écologie n’était pas réactionnaire, et au moins pour une raison très simple : sur le plan climatique, géologique, écosystémique, il est impossible de revenir en arrière : le pétrole consommé et consumé le sera à jamais. En revanche, l’écologie est conservatrice. Là aussi pour une raison simple : elle vise à préserver autant que faire se peut l’état du monde. Elle n’est donc pas une modalité du progressisme comme beaucoup d’écologistes patentés le croient. Il faut assumer pleinement le conservatisme de l’écologie. Dans son Discours de Suède, Camus prononce ces phrases définitives : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Empêcher que le monde ne se défasse, tel est l’impératif. Il semble en effet que les forces du progrès concourent à précipiter la ruine du monde, et de l’homme. L’idéologie du progrès est un avatar du libéralisme, ce que montre parfaitement bien le philosophe Jean-Claude Michéa dans Le complexe d’Orphée. Cela signifie que l’on ne peut pas découpler critique du libéralisme et en même temps apologie du progrès. C’est pourtant ce que beaucoup essaient de faire, notamment à gauche, mais cela est voué à l’échec, ce que montre Michéa. Etre antilibéral et progressiste, c’est toujours, in fine, rejoindre le camp libéral. Pour s’en convaincre, il suffit de voir tous les progressistes se rallier immanquablement aux libéraux quand les « circonstances l’exigent »…
2-Technique antilibérale
Il faut donc arriver à concilier la technique, la technologie et autres apports de la modernité, avec l’écologie, nécessairement conservatrice. L’enjeu est là, il en va de la crédibilité du discours écologiste. Cette synthèse n’est pas impossible. La technique n’est pas libérale en elle-même. Depuis l’aube de l’humanité où elle a fait son apparition, jusqu’à aujourd’hui, elle a toujours fait partie de l’histoire, contrairement au libéralisme, qui est beaucoup plus récent (XVIème, XVIIème ou XVIIIème siècle, peu importe). Une réflexion sur la place de la technique dans un monde antilibéral (ou « alibéral », c’est-à-dire faisant sans le libéralisme) nous emmènerait trop loin, c’est pourtant une réflexion fondamentale à mener. Il serait plus qu’urgent de mener ce débat. Refuser la technique n’aurait aucun sens, il faut bien plutôt réfléchir à son insertion dans un dispositif différent, et à la mettre au service de fins autres que l’accumulation, l’aliénation par la consommation et la satisfaction de besoins purement artificiels.
3-Inégalités
La promesse de l’agriculture productiviste, couplée à la grande distribution, est de fournir des quantités d’aliments bon marchés tout le temps et à tout le monde. Manger des fruits exotiques en plein hiver, consommer de la viande à tous les repas pour des sommes dérisoires… Le souci affiché est celui de l’égalité : belle façade. C’est un mensonge. Sous prétexte de démocratiser certains produits de luxe, on fait avaler aux plus modestes des produits sans goût ni texture, bourrés de produits chimiques, parfois mauvais pour la santé. Quant aux plus riches, ils disposent, bien sûr, d’aliments de qualité. On a fait croire au pauvre qu’il mangeait de la viande, des tomates. Mais ce n’est rien de tout cela. Les inégalités face à la nourriture sont immenses.
Les conséquences des désastres écologiques touchent en priorité les plus faibles, les plus modestes, c’est un fait. Parce qu’ils n’ont pas les moyens de s’en prémunir. Quelles que soient ces conséquences : alimentation, migrations climatiques, pollution, accès aux ressources qui se raréfient… Les catastrophes écologiques en cours amplifient les inégalités et s’y combinent. Les différentes crises économiques, les inégalités de revenus ou de condition de vie sont d’autant plus criantes qu’elles sont en regard de crises écologiques mondiales.
4-L’écologie politique
Enfin, un mot sur l’écologie politique. Les écolos officiels des différents partis politiques sont souvent de piètres défenseurs de leur cause. Ils se perdent dans des jeux d’appareil, courent après des postes, des mandats, font des alliances en se trahissant eux-mêmes… Sur le plan des idées, ils se sont fourvoyées dans le progressisme et l’absence de critique radicale du libéralisme et se laissent enfermer dans des débats stériles (cas du glyphosate, je ne reviens pas dessus). La situation n’est donc pas reluisante. Il faut élaborer un discours écolo qui prenne à bras le corps les questions soulevées tout au long de cet article, mais aussi et surtout celle, peu développée, de la mondialisation. En ce sens, un parti écologiste qui ne produirait pas de critique de l’Union Européenne ne pourrait pas être une alternative crédible. Le bras armé du libéralisme et de la mondialisation qu’est l’Union Européenne, instance antidémocratique et anti-écologiste au plus haut point est radicalement incompatible avec l’idéal écolo. Voilà le point fondamental : forger, en quelque sorte, une écologie souverainiste.
Tout cela est bien beau mais une question demeure : que faire ? La seule question qui vaille sans doute. Cependant, elle est prématurée si l’on n’a pas une claire idée des objectifs et des principes. Une fois les jalons de l’action posés, on peu décider des moyens à mettre en oeuvre. C’est à ces jalons que nous avons essayé de réfléchir – trop imparfaitement – dans ces deux articles. Si cet article semble amalgamer des idées disparates – un genre de patchwork – c’est qu’il n’aborde que des pistes. Chaque point abordé aurait mérité de longs développements.
On jugera sans doute ce texte anti-moderne, voire passéiste ou technophobe. Peut-être y a-t-il un peu de cela, mais ce n’est pas l’essentiel, loin s’en faut. Les principes de l’écologie que nous avons esquissés (car il ne s’agit que d’une esquisse) portent effectivement une critique virulente de la modernité. Mais le plus important est qu’ils sont aussi l’occasion d’une alternative. A défaut de cette alternative, notre monde – et non le monde, infiniment plus vaste – court à sa ruine. Ne soyons pas les artisans de cette ruine.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou mettre un « j’aime » !
Vous pouvez prolonger le débat dans les commentaires en bas de page ou simplement nous faire connaître votre avis sur l’article.


![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)


![[Bibliosphère] La terreur féministe – Irene](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/10/Terreur-feministe-La-218x150.jpg)
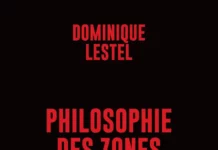





![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)


[…] rien de la sorte. Pour interpréter la position que je prône, je vous renvois à l’article Fragments d’un discours écolo qui tente d’expliquer au nom de quoi l’on peut admettre que certaines substances […]