
“Tout reprendre en 2027”
Le 18 avril, le média indépendant Quartier Général (QG TV) annonçait le départ d’une initiative politique ambitieuse : Quartier Populaire. Un rendez-vous en direct, bimensuel, dont l’objectif sera de préparer l’élection Présidentielle de 2027 en créant un bloc populaire en partant « de la base ». Pour cela, l’émission proposera d’inviter des personnes politiques, des intellectuels ou des citoyens afin de réfléchir, « tirer les leçons […], les conséquences de l’échec des différents mouvements sociaux, de tirer aussi les leçons acquises au sein des mouvements sociaux » et « créer collectivement […] l’envie de remonter au front et de reprendre le contrôle du destin du peuple français »[1]. La première ambition est celle de l’analyse froide, sans compromis, sans se la raconter. La seconde, au service de laquelle est mise la première : l’action. L’action politiquement située avec en ligne de mire l’élection de 2027 pour « reprendre le contrôle du pays ». Le reprendre à qui ? A Macron et son monde, celui du fric, de la morgue et du mépris, de l’autoritarisme – frôlant de plus en plus avec un certain pétainisme –, de la destruction de la République et des services publics, le monde de la corruption. Qui est concerné par ce projet ? « Les forces populaires hors partis, hors « orgas », hors syndicats, hors toutes les coteries rentables qui centralisent le pouvoir du peuple ». Quartier Populaire se propose de bâtir une force politique pour mettre sur pied un programme et proposer un candidat à l’élection Présidentielle de 2027. Sans vouloir trahir ou déformer les inspirations générales du projet, Quartier Populaire se place en continuité du mouvement des Gilets jaunes, de l’opposition à la réforme des retraites, de l’opposition au Pass vaccinal et au contrôle généralisé mis en valeur lors du COVID.
Trois intervenants pour ce faire : Aude Lancelin, journaliste et fondatrice de QG TV, Didier Maïsto, journaliste anciennement sur Sud Radio et Harold Bernat, professeur de philosophie – et auteur bien connu sur Phrénosphère[2].
N’allons pas par quatre chemins, cette initiative a tout mon intérêt et suscite beaucoup d’attente, voire d’espoir, malgré des points d’achoppement et de controverse. Cet article a donc deux fonctions : tout d’abord inciter le lecteur à regarder le live de présentation sur QG TV, et discuter les fameux points d’achoppement car ce n’est que comme cela que se construit un bloc populaire. Ces désaccords portent essentiellement sur le rôle de la violence et sur la question de l’élection et de l’intégration aux institutions dites démocratiques en faisant de la Présidentielle une sorte d’horizon. Ce sont ces points-là qui seront donc surtout discutés ici. D’ores et déjà, je salue l’initiative, que l’on ne peut percevoir que comme un grand bol d’air frais dans une atmosphère intellectuelle, politique et médiatique empuantie de flatuosités émétisantes.
Divisions les luttes et tyrannie de la minorité
Rapidement, Harold Bernat situe le constat de départ : « on est mis en minorité […] alors que nous sommes majoritaires ». Point fondamental, crucial de l’analyse. Le peuple est majoritaire (par définition), l’opposition à Macron est majoritaire – ce qu’ont superbement démontré le mouvement des Gilets jaunes (massivement soutenu) ainsi que le mouvement contre la réforme des retraites. Pourtant, « on » est globalement perdant. La minorité fait la loi là où la majorité est écrasée[3]. Comment expliquer cela ? Voilà l’une des questions qu’explorera Quartier Populaire.
De façon générale, aucune analyse sérieuse de nos échecs n’est faite. Après une mobilisation infructueuse, après un mouvement social déçu, on repart au charbon sans avoir tiré le moindre enseignement. On répète à l’infini les mêmes stratégies qui, leçon de mécanique sociale, aboutissent aux mêmes échecs. L’une des raisons principales, sur laquelle s’accordent les trois intervenants : la division interne. Chacun, et c’est particulièrement vrai des syndicats, défend son petit bout de gras, se rétracte sur son pré carré, qu’il conserve jalousement. Pourquoi refuse-t-on de discuter, de travailler avec celui qui ne partage pas 100% de nos positions ? Quelles sont les raisons qui font que l’on cherche à s’isoler dans des formations de plus en plus microscopiques et homogènes, afin de s’exonérer de toute contradiction ? Rejeter un camarade dont on partage 80% des idées au nom des 20% les moins importantes est la meilleure façon de perdre collectivement – tout en rejetant la faute de la défaite sur le camarade en question. Les postures morales font des ravages : on dénonce le camarade qui « ferait le jeu » d’untel, on excommunie cet autre qui « flirterait avec » untel… Cette censure des autres, qui s’apparente à une course à la pureté morale (du moins, à la morale qu’on croit détenir) prend aussi la forme d’une « auto-censure » dit Didier Maïsto. Ai-je intérêt à dire cela, à soutenir telle personne ? Que vont penser les autres si je défends cela ? Toutes ces (im)postures sont mortifères et conduisent tout droit à l’explosion de la majorité.
« Seul, nous n’arrivons à rien. » Pourquoi ? « Parce que le spectacle, la machine de guerre médiatique qui est en face prend, elle isole, elle cornérise, et c’est terminé. C’est fini. » La division interne correspond à une stratégie du Spectacle hégémonique, qui prospère en fragmentant ses oppositions. Le paradoxe est que l’avancée du Spectacle (l’un des noms de la machinerie (néo)libérale), comme pronostiqué par Marx et Schumpeter, génère effectivement de plus en plus de contradiction, d’opposition, de rejet, mais qu’en même temps et dans le même mouvement, toutes ces oppositions de plus en plus nombreuses sont immédiatement stérilisées par le Spectacle. Le Spectacle, c’est l’une des thèses fortes de Debord, unifie, il réunit, il crée une « réalité » homogène (le Spectacle nomme en fait le processus et son résultat) mais il le fait en morcelant l’expérience, en fragmentant la vie, le social, etc. de sorte qu’il ne reste plus qu’une chose : la marchandise et son monde. Finalement, après avoir tout cassé, tout bazardé, le Spectacle nous unit autour de la seule chose qui reste : la marchandise. Il en va de même des mouvements sociaux : ils sont eux-mêmes fragmentés, spectacularisés, pour finalement, une fois la tempête passée, rentrer dans le rang et rejoindre le doux cocon du monde marchand. Se produit dès lors « une oscillation maniaco-dépressive » entre le moment de la révolte paroxystique puis la décrue et enfin de compte l’apathie. Face à cela, comme le dit Bernat, « notre réponse, elle est collective, et cette force, il faut la construire ».
La question de l’élection et des institutions
Aude Lancelin met rapidement les pieds dans le plat en posant la question qui fâche : « pourquoi 2027 ? » Pourquoi prendre « comme date butoir une élection, c’est-à-dire un piège à cons ? » précise-t-elle avec lucidité. En effet, Lancelin pas plus que Bernat, et peut-être Maïsto, ne sont dupe de la supercherie, et c’est cela qui fait l’attrait de Quartier Populaire : nulle promesse messianique, nul espoir démesuré placé dans nos institutions, nul électoralisme béat. La réponse d’Aude Lancelin à cette question : « parce qu’aucun des mouvements sociaux […] n’a abouti. Ces mouvements sociaux nous ont emportés, ils ont parfois changé notre vie […] mais ils n’ont pas abouti sur une reprise de contrôle par le peuple, ils n’ont pas changé la vie quotidienne de millions de français ». La journaliste rappelle tous les échecs politiques à l’Assemblée nationale ainsi que la neutralisation des votes des parlementaires. Elle insiste a contrario sur le poids et les retentissements du mouvement des Gilets jaunes : « c’est le seul mouvement […] depuis les années 70 à avoir vraiment fait trembler le pouvoir français ». Non pas par sa violence, dit-elle, mais par son côté trans-partisan, par son honnêteté, par l’authenticité de ses figures locales et par des revendications qui ont très vite pris les problèmes à la racine sans transiger.
Le projet de Quartier Populaire est ainsi de bâtir un socle populaire, définir un ou des objectifs, puis un programme ou des idées à défendre, et enfin désigner un(e) candidat(e) pour 2027. C’est, à l’évidence, la seule stratégie vraiment démocratique si l’on veut prendre part au processus électoral. A contrario, toutes les autres formations politiques procèdent dans l’ordre inverse : un candidat ou parti échafaude un programme répondant à un objectif auquel et sommé d’adhérer une base de militants. Rien de démocratique là-dedans. Maïsto, Lancelin et Bernat le disent à plusieurs reprises : il s’agit d’un « processus d’auto-construction, d’auto-création ». La filiation avec Castoriadis est ici manifeste. Il s’agit de réaliser ce que Jean-Claude Michéa nomme le « ni droite ni gauche d’en bas », contre le « ni droite ni gauche d’en haut » promu par Macron et les siens pour dynamiter le champ politique et paralyser les oppositions. Là où le dépassement des clivages par le haut correspond en fait au triomphe du libéralisme enfin réconcilié avec lui-même[4], celui qui s’effectue par la base prend appui sur la vie quotidienne des petites gens, la décence des gens ordinaires – la common decency d’Orwell –, l’incarnation concrète d’une République vécue dans la chair et non invoquée abstraitement. Didier Maïsto le dit à sa manière, le clivage droite gauche est devenu un obstacle à la formation d’un collectif que Quartier Populaire appelle de ses vœux, et que les Gilets jaunes avaient un temps cristallisé.
Concernant les élections, Maïsto est lucide lorsqu’il dit que la question du financement est cruciale dans le jeu électoral. Peut-être a-t-il lu Le prix de la démocratie de Julia Cagé, qui démontre de façon implacable que les chances de succès à une élection – a fortiori présidentielle – sont proportionnelles aux fonds dont on dispose et au fric qu’on peut claquer en com’, en pub’, en couv’, en meetings, en spin doctors, en consulting.
« Voter c’est donner de la force à son ennemi » dit un spectateur. Ce à quoi Harold Bernat répond que bien sûr, le vote est un problème, mais « qu’il n’y a pas 36 solutions : soit on se retire du jeu, soit on est dans une contemplation esthétisante de notre défaite […], soit on prend les armes, on leur rentre dedans et on se fait défoncer, soit on essaie de les battre ». Les options sont posées, froidement, lucidement. Avoir prise politiquement sur le réel ne se fait qu’au prix d’une telle lucidité, d’une telle froideur d’analyse.
Cependant, je crois pour ma part malgré tout – même si aucun des trois intervenants n’est dupe du simulacre politique appelé « élection » – que présenter l’insertion dans le cirque électoral comme horizon indépassable est une erreur. Ce dont ne tiennent pas compte Lancelin, Bernat et Maïsto, c’est qu’il est rigoureusement impossible de gagner l’élection présidentielle. Les institutions sont précisément faites pour empêcher un mouvement populaire d’accéder au pouvoir, elles sont, au plus profond d’elles-mêmes, calibrées pour se perpétuer telles qu’elles et replacer indéfiniment le pouvoir dans les mains de l’oligarchie (néo)libérale. Il s’agit de l’essence même de ces institutions, non pas de propriétés secondaires ou accidentelles. Croire qu’un mouvement démocratique peut l’emporter revient à croire que de l’eau peut jaillir le feu – ou que de la cervelle de Pascal Praud peut jaillir l’intelligence. Les financements, on l’a dit, sont directement corrélés à la possibilité de l’emporter ; la couverture médiatique, indispensable, est truquée par les fameux « temps de parole » des candidats, mais aussi par le fait que tous les grands médias sont soit possédés par des milliardaires qui verrouillent l’opinion soit sont à la solde du pouvoir en place dans le cas du service public ; les 500 signatures, balayées hâtivement d’un revers de main, sont un obstacle de taille, durci par Macron lors de son premier mandat ; mais tout cela n’est rien comparé aux difficultés en cas de victoire : il faut encore remporter les législatives, et surtout purger les grandes administrations qui ont un poids absolument démentiel[5].
Par ailleurs, je partage l’opinion de ce spectateur anonyme : s’insérer dans le champ électoral, c’est effectivement renforcer l’ennemi, c’est se placer en état de faiblesse, jouer avec ses propres règles à un jeu qu’on ne peut gagner. C’est accréditer l’idée d’une démocratie qui fonctionne, c’est offrir sur un plateau la victoire et s’empêcher de critiquer le jeu lui-même. Comment pourrait-on affirmer que la France n’est pas une démocratie mais une oligarchie autoritaire tout en participant, bon gré mal gré, à ce que nos dirigeants présentent comme la démocratie ? Cela nous affaiblit considérablement et légitime la victoire de l’ennemi, d’autant qu’il aura gagné contre une vraie opposition – « la preuve que nous sommes démocrates, vous avez pu vous présenter », suivi de « nous sommes le seul rempart contre cette opposition populiste, fruit de l’union des extrêmes de tous bords, qui met en péril notre démocratie et nos valeurs » etc. Je me permets ici une mise en garde : il faudra que Quartier Populaire aille à la bataille avec lucidité, et ne cesse de dénoncer à chaque instant la supercherie électorale. Sinon, il se perdra et se fera gober tout cru.
Bref, on l’aura compris, les chances de succès ne sont pas simplement très faibles, elles sont rigoureusement nulles. J’espère que nos trois compères en sont conscients et ne comptent pas épuiser toutes leurs forces dans cette aventure, auquel cas l’énergie accumulé au fil des mois se dissipera en vain. Si j’ai parlé d’espoir à propos de l’initiative Quartier Général, ce n’est pas pour rien, et je le réitère. Il s’agit, me semble-t-il, du seul espace, encore à construire cela va de soi, qui allie une pensée critique vraiment structurée, conséquente et intellectuellement charpentée, l’authenticité d’un discours qui émane de la base (populiste au bon sens du terme), une ligne politique dans la continuité du mouvement des Gilets jaunes, une défense sans concession de la République au sens fort[6] de la République sociale, et surtout la volonté de moyens d’action concrets, situés et qui ne se paient pas de mots. Je pense qu’une initiative comme celle-là est nécessaire, irremplaçable. Mais tout l’intérêt de ce projet est précisément dans ce qu’il va tenter de construire indépendamment des élections : un socle social et populaire. Peu importe les élections, ce qui compte vraiment, c’est de parvenir à fédérer une force politique. Si Quartier Populaire y parvient, élections ou pas, un immense fossé aura été franchi. Malgré les désaccords que je peux avoir, je ne souhaite pas tomber dans le piège que tentent précisément de déjouer Aude Lancelin, Didier Maïsto et Harold Bernat : les 10% de divergences stratégiques ne doivent pas occulter les 90% de convergences sur le fond. Il faut de la contradiction, il faut de la critique, mais il faut surtout construire en commun – ce qui exige humilité et retenue. Comme le dit si justement Harold Bernat, « la course à la radicalité quand on perd, c’est absurde ». C’est la raison pour laquelle avec les petits moyens dont je dispose, il me semble fondamental de soutenir l’initiative Quartier Populaire.
Interlude : Totems et tabous
Construire une force populaire ancrée « à la base », et non en complète lévitation comme l’intégralité des partis de gauche (je ne parle pas de la droite pour qui la notion de peuple n’est de toute façon qu’un paravent) qui ne savent que parler à leurs militants et aux classes moyennes et intellectuelles urbaines, suppose de prendre à bras le corps des sujets clivants que Didier Maïsto identifie bien : « l’immigration, l’identité nationale, la souveraineté ». Ces thèmes ont été préemptés par la droite et en particulier l’extrême droite – parmi lesquelles on pourrait inclure le gouvernement. Cependant, bien qu’elles ne soient pas les préoccupations les plus déterminantes pour les gens, celles-ci sont importantes et font souvent office de repoussoir quand vient le moment de se décider. Bref, on ne peut ses laisser sous le boisseau.
Dans la même veine, on voit que la question européenne sera au cœur des préoccupations de Quartier Populaire. Le terme de « Frexit » est plusieurs fois prononcé, tout comme celui de « souverainisme ». On ne peut faire l’économie de ce type de réflexions, là encore, loin des postures et des moues de circonstances. Quelle autre force politique peut se targuer de s’emparer de ces sujets[7] ? Corrélativement, c’est l’idée de nation qui est réinvestie par nos trois intervenants.
La question internationale, en particulier par le prisme de guerre d’Ukraine, surgit à plusieurs reprises. A rebours des positions obligées, l’anti-atlantisme domine, tout comme la volonté d’une France indépendante sur la scène internationale. Une France émancipée qui refuse la vassalisation, en particulier des Etats-Unis. Macron est peut-être plus consternant encore sur les sujets internationaux que sur la politique intérieure. C’est un pitre tout juste bon à amuser la galerie, quand il n’est pas occupé à lancer des idées idiotes qui, pourtant, engagent la France et pourraient être lourdes de conséquences : alliance militaire au Proche Orient, envoie de forces à l’Ukraine, mutualisation de l’arme atomique, Europe de la défense pour noyer l’armée nationale, porte-avion Charles de Gaulle mis provisoirement sous pavillon de l’OTAN, démantèlement du corps diplomatique etc. On ne sait ce que ce type déteste le plus : la France ou les Français. Quoi qu’il en soit, Quartier Populaire semble se situer aux antipodes des bravades présidentielles.
Violence, effondrement et lendemains qui chantent
Un spectateur interpelle les orateurs : il faut « attendre que tout s’écroule ». La réponse du philosophe est alors d’une justesse et d’une acuité totale lorsqu’il dit que « le jour où tout s’écroule, c’est toute la base sociale […] qui va imploser et c’est certainement pas Macron et ses affiliés. Et ça sera une catastrophe. » Attendre que le capitalisme ait fini de tout ronger, provoquant un déchaînement de violence, de souffrance et menant aux barricades et finalement à la guerre civile n’est certainement pas la solution. Pour deux raisons : tout d’abord, « dans l’attente » pourrait-on dire, ce sont les petites gens qui verront leurs conditions de vie empirer jusqu’à l’insoutenable, et cela, on ne peut le souhaiter. Parier sur un pourrissement vers l’insupportable revient à demander aux petites gens de supporter toujours plus le saccage de leurs existences jusqu’à l’insupportable – jusqu’à la mort, ou du moins l’agonie. Est-ce là la position politique que l’on veut défendre ? En appeler à la douce attente de l’écroulement est une pure posture. Ceux qui s’y complaisent sont-ils, pour eux-mêmes et leurs proches, prêts à endurer l’insupportable jusqu’à l’écroulement final ? Et puis, il y a ce que dit Bernat : lorsque s’effondre une société sous la violence, lorsque prévaut le chaos et le renversement généralisé, toujours ce sont sur les petits que s’abattent les forces de la répression, les conséquences de la disparition des services publics, les disettes dues à la disparition des échanges, les pénuries et finalement la mort. Les riches, les puissants, y compris dans la chute, restent largement épargnés. Autrement dit, la violence indistincte de l’effondrement et de la guerre civile s’abat avant tout sur ceux qu’elle est censée libérer de leur joug.
Harold Bernat, ainsi que ses camarades de Quartier Populaire, rejettent la violence. Le mot de pacifisme est lâché par un intervenant. Cependant, la réflexion livrée est plus nuancée, plus intéressante qu’une simple condamnation de toute forme de violence. Bernat, comme toujours, est subtil. Cela dit, je voudrais m’arrêter un peu sur cette question qui marque l’un des points d’achoppement dont je parlais tout à l’heure. Quand le bordelais affirme que « c’est pas dans la rue qu’on va prendre le pouvoir », en particulier parce que le gouvernement s’est lancé dans une surenchère autoritaire, qu’il achète des armes, des munitions et des engins à tour de bras pour mater les manifestations, qu’il promulgue des lois liberticides, qu’il n’a pas peur de mutiler, de défigurer, voire du tuer, quand Harold Bernat dit cela, il a raison. Frontalement, nous ne sommes pas de taille, à moins d’accepter un déchainement policier et répressif sans précédent au terme duquel les blessés graves et les morts – de notre côté et pas du leur – s’entasseront comme autant de barricades macabres. Au-delà même de l’autoritarisme qui glisse de plus en plus vers un régime policier, pour ne pas dire plus, ce qui ne peut laisser d’inquiéter est la rapide dérive des discours et des imaginaires. De plus en plus les dominants (politiques, médiatiques etc.) préparent les esprits à la violence répressive, petit à petit, dans leur bouche, les grévistes deviennent des preneurs d’otage, les manifestants des séditieux, les militants des extrémistes et les activistes des terroristes. Peu à peu, ils dessinent les contours d’un Etat assiégé de l’intérieur, d’une démocratie mise en danger de mort, d’une République à défendre quoi qu’il en coûte. L’Etat macronien n’a plus en face de lui des opposants, c’est-à-dire des citoyens, mais des terroristes, qu’il convient de traiter comme tels : de la vermine. L’infléchissement progressif des discours et des imaginaires n’est jamais que le prélude à un durcissement accéléré et sans limite de la répression, il s’agit de préparer le terrain dans les esprits en attisant les ressentiments et les peurs. Une fois que les dernières digues morales auront sauté, le pouvoir pourra s’en donner à cœur joie. Et c’est bien cela qui fait le plus peur : au fur et à mesure que les actes, les lois, l’équipement des forces de l’ordre rattrapent les discours prononcés par la macronie ou ses soutiens, les discours se décalent toujours plus, entraînant dans leur sillage la hausse continue du niveau de violence, sans jamais chercher à la tempérer, encore moins à l’endiguer.
Aude Lancelin précise les choses : si Quartier Populaire insiste sur l’élection présidentielle comme horizon, « c’est pour éviter de genre de massacre ». Le pouvoir s’est « sur-armé » dit-elle à raison, à un niveau inédit. La crainte des trois intervenants est donc parfaitement justifiée.
Pour autant, Harold Bernat affirme qu’ « on ne peut pas statuer a priori sur la violence ». « La violence, dit-il, elle n’est pas du fait de ceux qui sont dans la rue. Elle est la conséquence d’une violence première. » On le voit, il ne s’agit pas pour le philosophe de distribuer des bons points, encore moins de communier dans un pacifisme béat de bisounours. Il ne rejette pas la violence pour elle-même, mais pour ses conséquences, parce qu’il sait que le pouvoir en face ne reculera devant rien et que c’est de notre côté qu’on comptera les morts – des morts réels, des éborgnés, des mutilés, des blessés, des gueules cassées. Loin de tout romantisme, il sait, il a vu ce qu’est une main arrachée. La chair qui dégouline, la peau en lambeaux, les tendons et les bouts de nerfs qui tressautent entre les muscles à vif, la douleur qui fait perdre connaissance. C’est ça la réalité, pas celle des livres d’histoire montrant une liberté allégorique guidant un peuple mythifié. S’il ne rejette pas la violence en soi, Bernat ne croit pas à la violence comme « solution en attendant le collapse final ». Il a raison, à mon sens, sur cette violence débridée, indistincte, chaotique ; cette violence présentée comme seule stratégie, voir comme objectif : cette violence désirée pour elle-même. Celle-ci ne produit rien d’autre que la mort – de notre côté.
Pour ma part, et c’est l’idée que je défendais dans Leur violence et la nôtre[8], je pense qu’il faut se réapproprier le concept de violence, la penser, pour l’intégrer et en faire quelque chose. Cela commence par affirmer que le niveau de violence est déterminé par le pouvoir, pas par nous. Cela suppose également de distinguer les différentes formes de violence, pour ne pas nous laisser intimider. La violence contre les choses et contre les personnes, ce n’est pas la même chose ; la violence d’en haut et celle d’en bas, ce n’est pas la même chose ; la violence offensive et défensive, ce n’est pas la même chose etc. Mon propos est simple : la violence – mais encore une fois : quelle violence ?, et, surtout contre qui ? – doit faire partie de l’arsenal de nos luttes, à côté d’autres armes, dont la création d’un espace public comme l’est Quartier Populaire. Il y a une « diversité des tactiques », il faut à tout prix arrêter de croire que la sienne propre est la seule possible. Des tactiques recourant à la violence (ce qui ne veut rien dire : des tactiques recourant à des modes d’action perçus comme violents[9]), ciblées, sur le mode de la « petite guerre » clausewitzienne, ont une place majeure, par exemple pour saboter tel dispositif antiécologique, pour arrêter tel projet mortifère, pour intimider ou menacer. Bien sûr, la violence révolutionnaire préparant un grand soir auquel souvent succède un petit matin en gueule de bois, n’est pas une solution envisageable, car elle relève d’un imaginaire prophétique, millénariste et messianique, passant les individus par pertes et profits. Mais les postures pacifistes nous réduisent à l’impuissance. Lorsque Harold Bernat moque les chars des syndicats sur lesquels se dandinent des Casimir hilares, il a raison : cela ne fait peur à personne, cela démobilise. Quelle différence entre la casse du système sociale et la Mickey Parade le soir à Disneyland ?
Les Gilets jaunes ont fait peur au pouvoir macronien, par sa détermination, certes, son unité, la vigueur de ses revendications, sa maturité politique. Mais ce ne fut pas tout : quoi qu’on en dise, Macron, comme Griveau en son temps, ont eu physiquement peur. Ils ont ressenti une trouille bleue. Et cette menace qu’ils ont ressentie n’a pas été pour rien dans la force du mouvement. Je pense, à la suite de Günther Anders, que la menace doit faire partie de l’arsenal de nos luttes. Face à l’impunité judiciaire ou à l’irresponsabilité politique[10] de nos « représentants », on n’a pas d’autre choix.
Conclusion
Sortir des postures, c’est l’ambition salutaire d’Aude Lancelin. La soirée de lancement de Quartier Populaire ne trahit pas cette ambition. Cela passe par le fait de ne pas se payer de mot, de ne pas se faire plaisir avec de grands slogans, avec une pureté morale brandie en étendard. Cela seul permettra de fédérer par en bas. Cela seul permettra de faire place à la contradiction au sein du « mouvement ». Je ne peux, malgré les réserves émises, me réjouir de l’émergence future de Quartier Populaire, qui s’annonce comme l’une des expériences politiques les plus riches depuis longtemps. La France Insoumise s’est retiré dans le sectarisme, la NUPES a explosé, les micropartis souverainistes tirent de plus en plus à droite… nous sommes orphelins d’une certaine idée de la République – une République radicale et sociale. Espérons que les mois et les années permettent à Aude Lancelin, Didier Maïsto et Harold Bernat de fédérer une force politique populaire mais qui ne fera pas de quartier !
[1] Les citations en italique sont extraites de l’émission, disponible sur QG TV. L’intervenant ayant prononcé la citation n’est pas systématiquement mentionné, afin de renforcer l’idée d’une pensée en mouvement, mouvante, collective, d’un “intellectuel collectif” pour paraphraser Pierre Bourdieu.
[2] Je renvois le lecteur aux trois ouvrages d’Harold Bernat chroniqués sur Bilbiosphère : Le néant et le politique. Critique de l’avènement Macron, l’Echappée, 2017, Asphyxie. Manuel de désenfumage pour notre temps, L’escargot, 2020, La défaite de la majorité, Atlantiques déchaînés, 2022.
[3] Ce qui, par parenthèse, invalide les analyses de Tocqueville sur la tyrannie de la majorité. Le philosophe voyait dans la démocratie triomphante – du moins ce qu’il croyait être la démocratie, alors qu’ils s’agissait d’une certaine forme (américaine en l’occurrence) de démocratie libérale – un danger potentiel car les masses font, d’après lui, la loi. La démocratie, prophétisait-il, entraînerait une uniformisation généralisée, un individualisme forcené mais aussi un écrasement des groupes minoritaires par une majorité conquérante et tyrannique. Ses analyses sont aujourd’hui reprises par des « petits toquevilliens » comme je les ai appelés naguère (Enthoven, Finkielkraut, Tavoillot etc.) qui ne cessent de fustiger la démocratie. A la suite de Tocqueville, ils confondent démocratie et libéralisme. La démocratie, en effet désigne un mode d’exercice du pouvoir or, force est de constater que c’est bien une minorité qui exerce le pouvoir à l’encontre de la majorité, qu’elle tyrannise.
[4] Pour Michéa, en effet, il existe un libéralisme économique et un libéralisme culturel, avers et revers d’une même médaille, qui reposent sur les mêmes prémices.
[5] Certains parlent d’ « Etat profond » (deep state) pour désigner le fait qu’aucune politique publique ne peut être mise en place contre la volonté des hauts fonctionnaires qui font la pluie et le beau temps dans les ministères et les administrations. Ceux-ci déterminent de façon majeure les orientations du pays, ils jouissent, par leur pouvoir, d’une certaine autonomie qui rend illusoire l’application de politiques qui seraient contraires à leurs intérêts et leur ligne idéologique, très largement acquise au (néo)libéralisme.
[6] Pas dans le sens utilisé par les tenants d’une ligne qu’on pourrait presque dire « pré-fasciste » : celle de Valls, du Printemps républicain, du gouvernement, de Raphaël Enthoven, d’une certaine extrême droite, d’une partie des communistes et des socialistes etc.
[7] Je ne vois guère que Front Populaire, la revue d’Onfray, pour occuper un champ similaire, à ceci près que celle-ci se situe désormais de plus en plus à droite, voire à l’extrême droite – ce qui fait une différence considérable. Mais voyez comme la mécanique de la division est puissante : alors que sur l’UE, sur la souveraineté, sur les Gilets jaunes, sur le Passe vaccinal, sur l’anti-macronisme, le Front et le Quartier sont proches, je m’empresse d’insister sur ce qui les distingue et les sépare. Pourquoi cela ? Est-ce justifié ? Cette remarque, taquine certes sur la forme, mais très importante sur le fond, montre à quel point nous sommes tous et toutes pris dans des postures de principes et avons du mal à dépasser nos propres antipathies personnelles. Un travail d’inventaire sérieux et honnête nous obligera à ravaler notre amertume – ce qui n’est jamais agréable…
[8] Ainsi que, dans une version très largement augmentée, dans Apologie de la violence, non publié.
[9] Bernat cite le cas Oudéa-Castéra, ancienne ministre de l’Éducation, obligée de démissionner face à la pression populaire. « On est allé la chercher » dit-il, et cela a payé. Stratégie en apparence non violente : « il faut les épingler systématiquement », ne pas les lâcher. Mais en apparence seulement : tous les médias, les défenseurs de Macron et de l’ordre établi ont hurlé à la violence dont était victime la ministre, ont dénoncé sans cesse les accusations violentes dont elle était la cible etc. Autrement dit, défendre une posture non-violente quand toute critique un petit peu vigoureuse est rejetée du côté de la violence revient à se livrer pieds et poings liés. Cela revient à nous laisser enfermer dans des modes d’action dont le périmètre est déterminé par l’ennemi.
[10] Au sens où les dirigeants ne sont tenus responsables de rien. Ils ne rendent aucun compte. Ce serait une autre affaire si l’on avait estimé que Castaner, alors ministre de l’Intérieur avait endossé la responsabilité des mutilations infligées aux Gilets jaunes comme conséquences indirectes de ses propres ordres. Il croupirait en prison. Ou si Agnès Buzyn avait été reconnue responsable de milliers de morts du COVID dans la mesure où elle, et le gouvernement, avaient délibérément minimisé la menace de la pandémie. Elle aussi devrait passer le restant de ses jours en prison.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !


![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)


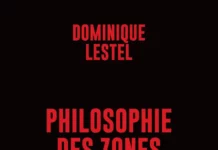






![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-100x70.jpeg)