Quand le monde devient gadget
ou,
L’obscénité de la marchandise à l’ère productiviste
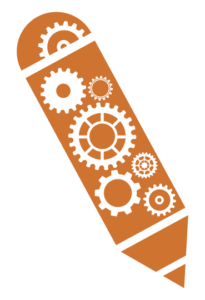
Vous êtes-vous déjà senti mal à l’aise dans un supermarché, en voyant les rayons dégueuler de produits suremballés, devant la surabondance d’objets débiles en plastiques ou confronté aux montagnes d’artefacts déjà obsolètes avant même d’avoir été ouverts ? Avez-vous déjà ressenti le vertige de l’inutilité en regardant tous ces produits ? Avez-vous déjà vacillé en prenant conscience de la destruction accélérée du monde croulant sous des milliards d’objets tous plus idiots les uns que les autres ? La modernité, quelles que soient les vertus qu’on y trouve, quels que soient les « progrès » dont on la crédite, finalement, se réduit à cela : « une immense accumulation de marchandise »[1]. Dans mon propre travail, j’ai pu parler du « devenir marchandise » du monde[2], insistant sur la forme générale de la marchandise, comme Guy Debord disant que la « forme-marchandise va vers sa réalisation absolue »[3]. Mais pour comprendre en quoi et comment ces marchandises détruisent le monde, et nous avec, il faut entrer dans le détail des objets produits. On se rend compte alors que le capitalisme mondialisé excrète de la marchandise comme un cholérique qui aurait bouffé trop de pruneaux. Mais pas n’importe quelle marchandise : littéralement, de la merde. Du machin en plastique débile, de truc obsolescent, de la chose inutile dont on ne se sert qu’une fois, du bidule qui tombe en rade à peine utilisé, du fourbi moche et pas pratique, de la babiole clinquante, des biens qu’on a honte d’acheter et de fabriquer, de l’atomixer, du ratatine-ordure, de la tourniquette pour faire la vinaigrette, du pistolet à gaufre[4]… Bref : du gadget, rien que de gadget. Plongeons donc dans la fange productiviste, tels des Inspecteurs Gadget de l’insignifiance. Gogo-Gadgeto-gadget !
Allez donc faire un tour en ville. Ou dans un quelconque hypermarché. Arpentez les allées, les rayons, entrez dans les boutiques, tâtez donc les produits aux textures veloutées qu’on vous colle sous le pif, humez les exhalaisons d’hydrocarbures et de peintures industrielles, écoutez les « pocs » mous et creux qu’ils font quand on les tapote et les « clics clics » indéterminés quand on les secoue, laissez leurs couleurs vulgaires imprimer vos rétines qui ne savent plus où donner de la pupille. Et maintenant, laissez-vous submerger par le désir insatiable qui monte en vous face à l’objet que, malgré vous, vous saisissez : « je le veux ». « Je ne savais pas que ça existait, mais j’en ai besoin » êtes-vous alors en tain de susurrer voluptueusement, presque en cachette, comme au creux d’une oreille prude. L’objet ne vous entend pas et pourtant, c’est comme s’il vous répondait, il semble frémir et vous promettre l’éternelle satisfaction de quelque désir inconnu. Mais la marchandise ne comble aucun désir, elle n’étanche aucune soif, c’est comme s’abreuver à une fontaine de sable. Car la marchandise moderne, clinquante et aux mille fonctionnalités, est parfaitement vide. Guy Debord l’explique bien, lorsqu’il dit que « la première phase de la domination de l’économie sur la vie sociale avait entraîné dans la définition de toute réalisation humaine une évidente dégradation de l’être en avoir. La phase présente de l’occupation totale de la vie sociale par les résultats accumulés de l’économie conduit à un glissement généralisé de l’avoir au paraître, dont tout « avoir » effectif doit tirer son prestige immédiat et sa fonction dernière »[5]. Le paraître de la marchandise, pure apparition au sens fantomatique, prend possession de nos désirs, il nous hante, pour reprendre un terme de Jacques Derrida, afin de créer en nous un manque qu’il promet de combler, mais tout ceci – le manque et son comblement – est simulacre. Virtuel le désir que la marchandise crée en nous, virtuelle la satisfaction qu’elle procure. La machine tourne à vide. On a dit qu’on était passé d’un capitalisme de la production à celui de la consommation. Ce n’est pas faux, mais il serait plus judicieux de remarquer plutôt que le glissement réel du capitalisme concerne ce qui est produit, autrement dit que la nouveauté est la production planétaire et quasi exclusive de gadgets, c’est-à-dire d’objets qui ne couvrent aucun usage préalable, ne remplissent aucune fonction préétablie ni ne répondent à aucune nécessité véritable. La production reste première, sauf que, pour accroître sans cesse les parts de marché, pour accroître l’existence même de marchés, et pour accroître dans le même temps l’emprise de la marchandise – donc la consommation, source de profits – le capitalisme nous fait fabriquer, pour les acheter ensuite, des monceaux d’objets inutiles, débilitants, de mauvaise facture, laids : des gadgets. Ces objets par milliards qui occupent l’essentiel de nos existences matérielles, que ce soit dans l’extraction de matières premières ou la production énergétique qui requièrent, puis leur production, leur consommation, leur « usage », leur destruction, la gestion de leurs déchets, voire leur critique ; ces objets donc, parce que chacun d’eux, chaque parcelle de chacun d’eux, résume à elle seule le capitalisme mondialisé, ces objets détruisent le monde. Au sens propre.
Mais retournons, si vous le voulez bien, aux allées bondées de notre hypermarché ou de notre rue commerçante. Voyez les gadgets qui s’accumulent partout, jusque dans les sacs que les mémères font porter aux pépères arthrosiques qui les suivent en maugréant. Voyez-les, ces trucs de merde, que des emballages de merde tentent de rendre attrayant. Nous vivons une époque qui aura érigé la scatophilie au rang d’occupation privilégiée. Nous sacrifions allègrement la Terre, notre seule planète, pour de la merde, encore et toujours de la merde. Pardonnez la grossièreté – qui n’est rien, toutefois, comparé à ce qu’elle décrit. Levez les yeux à hauteur d’horizon, concentrez vous et essayez de regarder ce qui vous entoure. Je veux dire, regardez vraiment, comme s’il s’agissait de la première fois. Immanquablement, vous serez assailli par l’obscénité de ces marchandises. Car la marchandise est le monde de l’obscène le plus cru. Là, une quelconque enseigne de jouets. Des milliers de robots en plastique, dont les yeux s’allument et des entrailles desquels des borborygmes grésillants se prennent pour autant de voix. Tous ces jouets par milliers que de faux Pères Noël promettent à des enfants capricieux pour qu’ils se tiennent sages… N’est-ce pas proprement obscène de voir tous ces trucs en plastique, vaguement articulés, passés de mode au moment même où on les met en rayon ? Tous ces poupons affreux, ces dinettes patriarcales, ces engins militaires virils, toutes ces merdes ludiques qu’on file à des gamins eux aussi en plastique bientôt… Avez-vous prêté attention véritablement à tous ces joujoux criards, dont la moitié au moins finira au rebus avant même le jour de l’An ? Ne sommes-nous pas des parents formidables ? Oh mais, ne serait-ce pas ici une boutique d’articles de cuisine ? Alors là, le gadget est roi. Vous y trouverez à l’envi une myriade de couteaux destinés à chaque usage possible et imaginable. Un pour couper les tomates, un pour la viande pas trop dure, un pour le poisson pas trop mou, un spécial pour éplucher les ananas, un autre qui fait fourchette en même temps, à côté, une bonne dizaine de modèles de presse ail, un ciseau à pizza, des taille-légumes de toute sorte, en plastique bien sûr, avec des tourniquettes, des manivelles, ou électriques, des coquetiers ronds, carrés, en forme de poule, avec un espace dédié pour la mouillette, des de toutes les couleurs, en spirale, en bois, en inox, en céramique, des cuillères à sauce avec un petit ressort sur le pourtour, des cuillères à riz, des machins pour écailler le poisson, trente-six sortes de bidules pour ouvrir les boîtes de conserve, là, dans un coin, un lisseur à ganache, une spatule plus siliconée qu’une descente de tapis rouge à Cannes, une autre avec un thermomètre intégré – ô joie –, plusieurs entonnoirs à piston, des fouets en plastique parfaitement inutilisables, des moulins à poivre avec un petit moteur intégré, et je ne parle même pas de l’infinité de poêles et de casseroles, au revêtement qui n’accroche pas – même pas à la poêle… – avec des poignées qui s’enlèvent, de qualité si médiocre qu’il faut quasiment les jeter à la première utilisation… Le monde de la cuisine a inventé une multitude d’usages, il a découpé en segments infinitésimaux chaque étape de cuisine ou de pâtisserie pour y faire corresponde un gadget débile à nous refourguer. Donc à produire, à valoriser en magasin, puis à gérer une fois jeté. Pas loin, vous voyez le coin de tous les appareils électriques qui vous font de l’œil. Les bras déjà chargés d’écumoires – celles en formes de rectangle à petites mailles – de roulettes à pizza – forcément antiadhérentes –, tous objets absolument indispensables à votre quotidien, vous vous précipitez. Quel indicible plaisir de contempler alors un cuiseur à riz. Pardon, je n’ai pu réprimer un ricanement. Un cuiseur à riz, oui. Oh, qui utilise encore une casserole pour faire cuire son riz ? Has been… Et là, ô summum de la honte prométhéenne, une touilleuse électrique pour émulsionner le café… Nous en sommes à ce niveau d’abjection technicienne. Le gadget est, d’une certaine manière, l’objet technique réduit à une dimension « d’esclave », pour reprendre le mot de Gilbert Simondon[6], c’est-à-dire qu’il n’est plus vu que « comme ustensile »[7] et même moins. Le philosophe affirmait alors que « l’objet technique doit être sauvé »[8] d’un techno-capitalisme qui aliène l’homme tout comme il aliène l’objet technique. La gadgetisation à laquelle nous assistons massacre également l’objet technique en gommant le plus possible toute technicité en lui, et en le réduisant quasi intégralement à une marchandise qui finit même par s’évaporer derrière le profit qu’elle permet. « La marchandise est un zombie, entendu qu’elle se réduit à sa valeur d’échange, qu’elle a été vidée – comme on vide une volaille pour qu’il n’en reste que la carcasse – de la valeur d’usage : elle n’est plus qu’un équivalent d’argent. »[9] Votre escapade commerçante vous en donne mille exemples. Des mixers à foison ; des trucs qui tournent tout seuls la sauce, parce qu’il serait insurmontable de la remuer soi-même ; à peu près un demi-million de friteuses qui n’utilisent pas d’huile, avec un hublot de contrôle ou une minuterie intégrée, des programmes prédéfinis parce qu’il existe sans doute vingt façons de faire frire des frites…, des ustensiles pour snacker, pour déshydrater, décongeler ou brasser de l’air chaud. Sur l’étagère d’en face : plusieurs modèles de presse-agrumes électriques. Mon Dieu, que sommes-nous devenus… Nous avons même des frigo « connectés », des appareils qui vous parlent, qui sont « intelligents », et le seront de plus en plus à mesure que nous nous abêtissons. Jacques Tati en aurait eu la berlue. Du gadget encore et toujours.
Il faut ici dire brièvement que le gadget découpe à l’infini tout acte en créant des usages et des fonctions nouvelles auxquelles il entend répondre – moyennant, il est vrai, une certaine somme d’argent. On a, par exemple, inventé des sèche-serviettes électriques, des lingettes nettoyantes jetables, des détecteurs d’endormissement dans les voitures, des moules à œuf au plat, des clips porte-verre à épingler au bord d’une table… Un verre ne peut se poser bêtement sur la table, il lui faut une merdouille dédiée, un œuf au plat ne peut pas être cuit stupidement dans une poêle, on a besoin d’une connerie en silicone pour lui donner une parfaite forme ronde. Nouvel usage, nouvelle fonction, nouveau besoin. Ce faisant, l’action humaine est morcelée, médiatisée par un gadget jusque dans les plus microscopiques détails, elle perd son unité, son plan d’ensemble pour n’être plus qu’une suite d’usages de gadgets séparés les uns des autres. Ce sont les savoir-faire qui sont peu à peu grignotés. Sous prétexte de nous libérer de tout un tas de contraintes techniques, les gadgets nous dépossèdent.
Il est temps d’écourter la visite de cette boutique, entrons dans la suivante, avant que vos bras ne croulent – vous n’auriez pas dû acheter la théière électrique à système d’infusion automatique. Nous découvrons maintenant l’univers chatoyant de l’habillement et de la parure. Bien sûr, là aussi, tout n’est que toc, bling-bling, mauvaise qualité, prêt-à-jeter bref : de la merde[10]. Comment ne pas citer, en emblème de l’ultra fast-fashion, Primark[11] ? Vous admirez ce qui se fait de pire en termes de vêtements. Des tonnes et des tonnes de tissus vaguement assemblés pour leur prêter un semblant de forme, on devine là un pantalon, ici un t-shirt. Qualité exécrable, tout sera jeté après quelques utilisations. Ou, dans le meilleur des cas – ce qui n’est qu’une façon de parler – sera oublié au fond d’un placard parce que la laideur et la vulgarité de ces produits nous sera devenue évidente. Regardez donc ces bandes de radasses surmaquillées faisant des selfies, la bouche en cul de poule pour avoir l’air de bimbos pulpeuses, en plaçant leur dernier coup de cœur, un quelconque top avec une phrase débile en anglais, par-dessus leur tenue, pour la poster ensuite sur « insta ». Comme quoi la vulgarité de la marchandise déteint sur les pseudos-individus qui ne se définissent plus que par rapport à elle. Pseudos-individus qui, tout comme elle, finiront jetables et dont on programme désormais l’obsolescence. A quelques pas, sur des présentoirs croulants, des milliers de « bijoux fantaisie » attirent l’œil. Encore une fois, tout ceci, qui demande des quantités ahurissantes de ressources (matières premières ou énergie), est destiné à être détruit sur le champ, l’acte de porter et de détruire étant presque concomitants. Du mauvais métal, du plastoc, de la pierre reconstituée, de la résine… des centaines de modèles de boucles d’oreilles ou de bracelets encombrent les rayons. On en a des étoiles plein les mirettes. C’est dans ce genre de magasins que l’on se sent pleinement libres : je choisi parmi les milliers d’objets celui qui me conviendra à la perfection. Je fais ce que je veux de mon argent. Je comble tous mes désirs. J’orne mon corps comme bon me semble. Tous les critères capitalistes de la liberté sont ici réunis. Libre arbitre, libre possession de son corps, libre usage de l’argent, illusion de volonté.[12] L’individu libéral ne se sent, nulle part ailleurs, plus singulier, plus original, plus lui-même. C’est, bien entendu, un mensonge total et absolu. Ca y est, vous vous êtes décidé pour trois ou quatre chemises – oups, elles tombent déjà en lambeaux… Sortons maintenant.
Bon, on ne va pas toutes se les faire, les boutiques. Votre dos et vos épaules, ainsi que ma santé mentale, n’y résisterons pas. Mais l’obscénité des gadgets s’étale largement, on va se contenter de faire du lèche-vitrine. Là : une librairie. Notre époque restera sans doute dans l’histoire comme celle qui a inventé et commercialisé le livre sous blister. Production industrielle et mondialisée de la destruction du monde… Que dire aussi, et je ne serai pas politiquement correct, de tous ces livres qui n’auraient jamais dû être écris ? Du moins, jamais être publiés… Je sais bien que s’attaquer aux livres, c’est mal, c’est même Le Mal. Mais soyons sérieux, toutes ces merdes imprimées et reliées, débilitantes, gerbantes d’insignifiance, ne sont pas vraiment des livres. Tous ces trucs de développement personnel, de coaching, qui fleurissent comme le front pustuleux d’un ado trop plein d’hormones, font honte à l’intelligence humaine. Et dire que des êtres vivants ont été sacrifiés pour les imprimer… Des milliers de livres, des romans idiots et mal écrits – Bruno Le Maire, écrivain, quelle blague – pour les adultes ou les plus jeunes, sans aucune forme d’originalité, de simples biens de consommation – lire ou relire Adorno et Horkheimer[13] –, des « essais » à foison, tous plus bêtes les uns que les autres et qui, pour la plupart, soutiennent d’une façon ou d’une autre l’ordre établi, la dizaine de milliers de récits et de témoignages personnels… On publie, à grand renfort de com’, l’autobiographie de Nicolas Sarkozy, rendez vous compte… Donner un chiffre serait forcément hasardeux mais disons qu’en première et généreuse approximation, moins d’un dixième de la production livresque vaut le coup. Tout le reste est à jeter sans scrupule. Personne ne lit ces livres de toutes façons. Les bibliothèques et les vide-greniers sont pleins de ces bouquins merdiques que personne n’a jamais lu. Le pire étant bien sûr d’imaginer que quelqu’un ait un jour lu de son plein gré, voire avec plaisir, un livre de Marlène Schiappa… « Et que c’est pas fini », dirait le grand Jacques, on pourrait en dire autant de la production musicale, tout aussi indigente mais surtout, au-delà de l’intérêt artistique nul, tout aussi dégradante et destructrice du monde. Car c’est le point principal de ma critique : toutes ces merdes détruisent matériellement le monde. Si l’impact environnemental et social était négligeable, je n’aurais à redire – chacun ses mauvais goûts – mais ce n’est pas le cas. Le gadget, car ce sont bien des gadgets culturels, participent de l’apocalypse qui vient.
Décollez votre nez de cette vitrine, voir toutes ces couvertures est en soi suffisamment avilissant– je rappelle que Sonia Mabrouk a été publiée et que son livre a été largement médiatisé, quelle injure au génie humain et aux arbres massacrés pour ça. Faites attention de ne pas bousculer vos coreligionnaires dans cette grand-messe de la consommation, ils sont au moins aussi chargés que vous, il ne faudrait pas qu’une titubation malheureusement vous entraîne dans une chute néfaste pour les biens fragiles qui vous avez achetés. Mais voilà une boutique de « bien-être ». Une occasion de plus d’admirer comme le gadget s’est emparé de chaque parcelle de l’existence humaine dans les pays dits « avancés ». Vous trouverez là une flopée de bougies parfumées, ces trucs sont, semble-t-il, devenus indispensables dans l’existence de l’homme moderne. Glorieusement exposés non loin, les nouvelles vapoteuses et puffs. Là, on touche vraiment le fond de l’obscénité et de l’ignominie marchande. Des cigarettes électroniques. Répétez lentement ces deux mots. Faites les tourner dans votre bouche jusqu’à ce qu’ils perdent leur sens. Des cigarettes électroniques. La cigarette d’antan, pour toxique qu’elle soit, était le truc le plus con du monde : du tabac roulé dans du papier. La « civilisation » moderne, ce que, arrêtons-nous là-dessus un instant, des intellectuels présentent comme le Progrès et son cortège d’innovations, ce que l’on décrit comme le faîte du développement humain à savoir la société techno-capitaliste, a trouvé le moyen de nous inventer des cigarettes électroniques. Quelle aberration. Pire, les toutes nouvelles puffs, si à la mode chez les jeunes, sont des cigarettes électroniques jetables. Ce que cela dit de notre société est terrifiant, mais ce que cela témoigne de la dégénérescence morale de tous ceux qui les utilisent est encore plus effroyable. Quel degré d’inhumanité, de pourrissement, de moisissure, de déjection existentielle faut-il avoir atteint pour en arriver là ? Cela pose une question très profonde : qu’est devenu l’humanité ? On ne peut alors que reprendre l’interrogation du philosophe Jean-Claude Michéa, qu’il reprend lui-même de Jaime Semprun : « Quand le citoyen-écologiste […] prétend poser la question la plus dérangeante en demandant : Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?, il évite de poser cette autre question, réellement inquiétante : À quels enfants allons-nous laisser le monde ? »[14] Dans la même veine, vous n’avez pu échapper à tous les programmes de télé-achat. Le gadget y tient une place toute particulière. En produits vedettes, bien sûr, l’attirail complet de toutes les merdes amaigrissantes. Ces ceintures chauffantes, d’autres qui vibrent, des patchs qui brûlent les graisses, des pommades, des crèmes, des justaucorps anti-peau d’orange, des culottes contre la cellulite… Est-ce que ce monde est sérieux ?[15] Notre belle boutique fourmille également de produits pour le corps : une cinquantaine de modèles de dentifrices, des déodorants à ne plus que savoir en faire, des centaines de savons ou shampoings… A-t-on réellement besoin d’une telle profusion ?
Le monde de l’alimentation n’est pas en reste en matière de merde écologique. On se félicite d’avoir mis fin aux sacs plastique, belle réussite qui permet de masquer la réalité d’un développement antiécologique accéléré. Rien que le gaspillage de denrées pourtant consommables est monstrueux. Mais ce n’est rien à côté du suremballage avec par exemple des biscuits individuellement emballés puis réemballés collectivement. On trouve aussi des quartiers de fruits vendus à l’unité, et bien sûr emballés dans du plastique, fraîcheur oblige. « Ils sont devenus fous ! » aurait pu s’exclamer Michel Sardou[16]. Des bananes dans des boites en carton, des tomates en hiver, du beurre en spray, vous avez bien lu… Maintenant, on trouve aussi dans les grandes villes des distributeurs à pizza, ce qui témoigne d’une société irrécupérable. Cela dit, un monde dans lequel il existe des bars à ongles ne mérite sans doute pas d’être sauvé. Dans l’univers de la gadgetisation du monde : les smartphones qui, bientôt, feront le café et repasseront les habits, sans oublier toutes leurs applis idiotes, tous les magazines qui encombrent les bureaux de tabac, des milliers de tonnes de papier glacé purement et simplement gaspillés pour produire ces merdes de magazines tous plus débiles et humiliants les uns que les autres, l’infinité de gadgets fabriqués en Chine et vendus à travers le monde sur Amazon[17]… Ce monde, quand on prend un peu de recul, est vraiment à vomir.
J’ai souligné plus haut que ce qu’on présente comme une mutation du moteur du capitalisme, à savoir le passage de la production à la consommation, est en fait une mutation dans le type des productions. Cela signifie que la production reste première, mais que la production quasi-exclusive de gadgets, parce que tous ces objets sont littéralement inutiles, demande de mettre en place des stratégies et des psychotechniques marketing pour encourager une consommation qui, sinon, n’aurait que faire de ces merdes. Cela a son importance. En effet, si l’on dit que le problème est celui de la consommation, c’est que le premier responsable est le consommateur. Ou plutôt, les milliards de consommateurs que nous sommes toutes et tous. Or, ce n’est qu’une partie du problème. La principale responsabilité vient en fait de ceux qui produisent ou font produire les gadgets et, pour écouler les stocks, ont également fabriqués des consommateurs. Il s’agit moins de réformer les désirs particuliers des consommateurs que de détruire le système productiviste. Car ce qui détruit concrètement le monde, ce sont bien tous les objets matériels, et ce que cela suppose d’extraction de matières premières et de production d’énergie. Avoir une consommation éco-responsable ne sert à rien si la production se poursuit telle quelle. On fait le pari de réorienter indirectement la production en passant d’abord par la réforme des comportements individuels, mais c’est une façon déguisée de ne pas toucher au système productiviste et de ne pas perturber le business as usual. Les consommateurs ont bien sûr un pouvoir, ils peuvent s’organiser pour boycotter certaines marchandises, mais cela a des limites. Tout d’abord, il faut une coopération généralisée des consommateurs, ce qui est pratiquement impossible – on voit bien un peu partout tel ou tel groupe boycotter tel ou tel produit, mais puisque ces boycotts sont partiels et touchent des produits différents, ils s’annulent les uns les autres –, mais surtout, les gens ont besoin de certaines marchandises, si on ne leur propose – à prix « raisonnable » – que de la merde, le choix se restreint singulièrement. Non, il faut frapper à la racine le système productiviste et extractiviste. L’autre impasse du fait de tout faire peser sur les choix individuels des consommateurs, c’est que cela reconduit la logique libérale de l’atomisation des individus et la croyance en un libre arbitre. Et surtout, cela entraîne une culpabilisation et une condamnation des dominés eux-mêmes[18]. Qui sont les consommateurs visés ? Les prolétaires, les exploités, les petites gens, les masses, les « sans-dents », « ceux qui ne sont rien », les « illettrés »… On les tient pour responsables de leur inertie et de leurs choix de consommation – tandis que les bourgeois, les riches, les capitalistes, eux, continuent de faire tourner la machine à merde. C’est moralement insupportable. C’est une façon de prendre chaque consommateur exploité, dominé, humilié, prolétarisé, écrasé, atomisé, isolé, et de rejeter toute responsabilité sur des maigres épaules déjà chargées d’injonctions contradictoires. Il faut au contraire, je le redis, frapper sans relâche le monde de la production – donc du travail – car c’est lui, en dernière instance, qui oriente la consommation, et non l’inverse, et surtout qui détruit littéralement la planète et les conditions de vie – sociales et environnementales.
Bien sûr, les gadgets sont partout, on n’a parlé ici que d’une fraction infinitésimale de ce que l’on peut subir au quotidien. Je n’ai, par exemple, pas parlé des services qui se gadgétisent de plus en plus également, pour me concentrer sur le monde de la marchandise. Le gadget, au final, c’est une marchandise zombie, dans le sens que je donne à ce mot dans Ce que le marché fait au monde. C’est à travers lui, entre autres, que le marché étend son emprise sur nous et transforme les sociétés et les individus, à leur tour, en gadgets, donc en zombies. Le seul espoir : s’attaquer sans relâche à toutes ces marchandises, et à leur production. Interdire leur production, leur vente, leur diffusion, les frapper d’infâmie, les boycotter, les saboter, les détruire. Nous n’avons pas le choix.
Notes :
[1] MARX Karl, Critique de l’économie politique (1859), repris dans Le Capital, livre 1 (1867)
[2] MERCIER Geoffrey, Ce que le marché fait au monde, L’Harmattan, 2020.
[3] DEBORD Guy, La société du spectacle, 1967.
[4] Vous aurez reconnu la fameuse Complainte du progrès (1956) du regretté Boris Vian.
[5] DEBORD Guy, op. cit.
[6] SIMONDON Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 2012 [1958], p. 12
[7] Ibid., p.336
[8] SIMONDON Gilbert, « Sauver l’objet technique. Entretien avec Gilbert Simondon », Esprit, avril 1983.
[9] MERCIER Geoffrey, op. cit.
[10] Je n’insisterai jamais assez, en plus des dégâts écologiques absolument dévastateurs, sur les dégâts sociaux : travail des enfants, esclavage moderne, conditions de travail déplorables, utilisation de produits chimiques (teintures ou autres) dangereux pour les travailleurs, dumping social etc. Il faut toujours avoir cet aspect déterminant de la gadgetisation du monde en tête : c’est aussi le devenir gadget du travail et donc des travailleurs. Produisant de plus en plus de la merde, nous tendons à être considérés, par les capitalistes, nous aussi et de plus en plus, comme de la merde.
[11] Il est évident qu’aucun progrès réel en matière d’écologie ne pourra être pris au sérieux tant qu’il existera des magasins de ce style. Il faudrait, naturellement, les interdire sans attendre.
[12] Je vous renvoie modestement à mon analyse de la liberté libérale, que j’appelle la « liberté de marché » dans Ce que le marché fait au monde.
[13] ADORNO Theodor, HORKHEIMER Max, Dialectique de la raison, 1944 entre autres.
[14] SEMPRUN Jaime, L’abîme se repeuple, cité in MICHEA Jean-Claude, L’enseignement de l’ignorance et ses conditions modernes, Climats, 1999, 2006.
[15] J’emprunte cette question à Francis Cabrel dans la si belle chanson La corrida.
[16] Dans Vladimir Ilitch, 1983. Le vers entier : « Lénine relève-toi, ils sont devenus fous ! ».
[17] On ne dira jamais assez à quel point cette société est responsable d’une part majeure du saccage écologique et de la déréliction modernes. Tout comme sa consœur asiatique, Alibaba, elle devrait être sur le champ pulvérisée, et tous ceux qui se sont gavés grâce à elle considéré comme des ennemis de l’humanité et du monde vivant.
[18] Soyons clairs, changer autant que faire se peut ses propres modes de consommation est très important, il ne s’agit surtout pas de dire que l’on peut acheter tout et n’importe quoi, n’importe comment, au prétexte que cela n’entame pas à la racine le système productif. Ne serait-ce que pour des raisons morales, on ne peut rester penauds et les bras ballants devant son caddie rempli de gadgets destructeurs. Mais plus profondément, cette dichotomie fait oublier que les consommateurs sont en partie producteurs des objets qu’ils consomment. Par leur travail, ils sont partie intégrante du système productif qui les opprime doublement : par le travail et par la consommation.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)








![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)


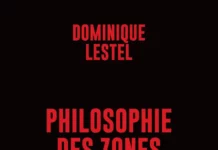



[…] https://twitter.com/sandrousseau/status/1764331015605023080 [11] Je vous renvoie à mon article « La gadgetisation du monde » pour cerner ce que j’entends par « merde », c’est-à-dire cet avatar du gadget, dont […]