FONDEMENTS DE LA DEMOCRATIE
ETUDE DE LA POLITIQUE D’ARISTOTE
C’est simple : démocratie = demos + kratos. « Le pouvoir du peuple ». Convenez que cette définition est somme toute fort simple, mais assez juste. Comme tout ce qui est simple, on pourrait passer une vie à en parler, à le déplier à l’infini. Mais comme souvent aussi, revenir aux origines d’une notion, c’est lui redonner son éclat premier – mais aussi mesurer la distance qui nous sépare d’elle. La politique est une vieille chose. L’un des premiers penseurs de notre civilisation qui se soit spécifiquement penché sur la question est sans doute Aristote dans son ouvrage majeur La politique, au IVème siècle avant notre ère. Le stagirite formule une pensée politique qui, près de 2500 ans plus tard, demeure d’une profondeur éblouissante. La réflexion qui suit, à propos de la notion de politique et, plus particulièrement, de démocratie, est un voyage dans le temps.
1-Communauté politique
Il est bien évident que la démocratie est un mode d’exercice du pouvoir politique, au sens où l’on dit communément de la politique qu’elle est la science de l’organisation de la cité. L’analyse de la démocratie implique donc de remonter un peu en amont et de dire un mot de la politique. Pour y voir plus clair, Aristote nous sera d’une aide précieuse, qui, dans un ouvrage majeur, La politique, éclaire la notion de communauté politique.
En effet, la politique est nécessairement une affaire de communauté, mais, rappelle Aristote, de communauté d’un genre particulier. Il distingue :
- la communauté despotique fondée sur le rapport de domination maître/esclave ;
- la famille qui est une communauté mettant en rapport des individus inégaux entre eux (les parents et les enfants) ;
- et la communauté politique qui, elle, est composée d’individus égaux. Il écrit : « le pouvoir politique s’applique à des hommes libres et égaux. »
La communauté politique a pour cadre la cité, qui est pour Aristote, loin de se réduire à une construction simplement géographique. En effet, la cité, et donc la politique qui la structure, n’existe que par le but qu’elle se donne, la fin qu’elle vise : « Une cité est la communauté de la vie heureuse, c’est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique. » Les choses sont très claires, la politique n’a de sens qui si elle a pour objectif le bonheur des membres de la cité, elle ne se résume pas à une gestion froide ni à une sorte de contrat minimal de coexistence pacifique[1].
La cité est souveraine, c’est-à-dire que son pouvoir n’est limité par nul autre que lui-même. C’est ce que dit Aristote dès le début de sa Politique : « La communauté politique est celle qui est souveraine entre toutes et inclut toutes les autres ». La communauté politique inclut donc d’autres communautés plus petites (familles, clubs, églises, associations diverses…), elle est la plus large par la taille, et s’impose à ces micro-communautés, car son pouvoir prévaut sur elles. Cette remarque relève du simple bon sens et de la logique la plus élémentaire : si une communauté plus petite venait à prendre le pas sur la cité, cette dernière ne serait pas souveraine et ses membres ne seraient pas égaux. Si au contraire, une communauté plus vaste venait à l’absorber, elle perdrait l’indépendance qui lui permet de conduire elle-même sa politique propre (c’est pourquoi Aristote parle d’autarcie : l’autarcie désigne l’indépendance).
2-Le langage comme fondement de la politique
Si l’Homme est un « animal politique », selon la formule célèbre d’Aristote, ce n’est pas simplement parce qu’il est un animal grégaire ou social. Le fait qu’il ait besoin de vivre en groupe ne suffit pas. En d’autres termes, la politique ne se réduit pas à la meute. Mais c’est parce qu’il est essentiellement et naturellement un être de langage. Insistons un instant sur la portée de cette idée : la politique est constitutive de l’être humain, elle n’est pas qu’un accident. A tel point qu’on pourrait sans doute dire que l’absence ou la dégénérescence du politique impliquerait une dégénérescence de l’humanité. Le langage lui permet d’accéder au « conflit symbolique » dirait-on de nos jours ; c’est-à-dire que par le langage, l’Homme accède à une forme de conflictualité non violente : la contradiction, le débat, le logos. Seul le langage permet la contradiction, cette forme d’opposition qui n’implique pas de détruire physiquement son adversaire. Et c’est bien ce qui fonde la possibilité même de la communauté politique. Ainsi, le « dissensus » et la contradiction sont à la base de l’activité politique, on ne fait pas de politique si l’on est d’accord sur tout, ni si l’on n’accepte pas la possibilité d’être d’accord sur quelque chose. De sorte qu’il faut inverser la formule fameuse de Clausewitz et dire que « la politique, c’est la continuation de la guerre par d’autres moyens ».[2]
Ainsi, la polis et le logos sont étroitement liés en Grèce. Comme le souligne Jean-Pierre Vernant dans son précieux ouvrage Les origines de la pensée grecque, la parole, divinisée sous les traits de Peithos, la persuasion, « devient l’outil politique par excellence ». Toutefois, le langage ne saurait se borner à l’oralité, pourtant si importante en Grèce antique – songeons aux sophistes, aux rhéteurs, aux déambulations des philosophes sur l’agora, à la délibération et aux discours dans les assemblées… – ; l’écriture rend possible une véritable révolution politique, à la base même de la démocratie : la publication de la loi. Le philosophe Bernard Stiegler insiste à raison sur le rôle fondamental de cette tekhnè (technique) qu’est l’écriture en permettant la publicité, au sens de mise dans l’espace public de la loi, ou même des connaissances. Cela seul permet que tous les citoyens s’emparent de la chose publique.
3-Des différents régimes
Aristote propose une typologie des régimes politiques qu’il distingue d’une part en fonction du nombre de gouvernants et d’autre part en fonction du bien visé : gouvernement d’un seul homme, d’un groupe, ou de tous ; visant le bien de celui ou ceux qui exercent le pouvoir, ou le bien de tous. Il existe 6 types de régimes, ou plutôt 3 couples :
- gouvernement d’un seul : monarchie (vise le bien de tous) / tyrannie (vise le bien d’un seul) ;
- gouvernement d’un groupe : aristocratie (vise de le bien de tous) / oligarchie (vise le biens des riches) ;
- gouvernement de tous : gouvernement constitutionnel ou république (vise le bien de tous)/ démocratie ou démagogie (vise le bien de la « populace »).
Le meilleur régime est donc celui dans lequel le pouvoir est détenu par tous au profit de tous. C’est ce que nous nommons aujourd’hui démocratie, bien que du temps d’Aristote, ce mot ait une connotation négative et polémique (le « démos » désignait plutôt la « populace » que le peuple)[3]. Ainsi, en démocratie (au sens moderne), le pouvoir est exercé par tous les citoyens pour le bien de tous les citoyens, ou bien commun. Cette idée-là est vraiment une formidable invention grecque, que l’on voit se déployer progressivement dès le VIIIème et le VIIème siècle avant l’ère commune. « On peut même dire que la polis existe dans la mesure seulement où s’est dégagé un domaine public, aux deux sens, différents mais solidaires, du terme : un secteur d’intérêt commun, s’opposant aux affaires privées ; des pratiques ouvertes, établies au grand jour, s’opposant à des procédures secrètes » (JP. Vernant, Les origines de la pensée grecque).
Le régime dans lequel les citoyens les plus fortunés détiennent le monopole de l’exercice du pouvoir porte un nom : l’oligarchie. Aristote précise les choses au livre VI de la Politique : « Certes il est bien plus exact de dire qu’il y a démocratie là où la souveraineté est attribuée à tous les hommes libres[4], oligarchie là où elle appartient exclusivement aux riches. » On ne peut s’exprimer plus clairement. L’oligarchie ne désigne pas le fait que le pouvoir soit détenu par un petit nombre d’individus, mais que ces individus soient riches et gouvernent pour leur propre intérêt.
Aristote distingue en effet l’oligarchie, pouvoir d’une minorité de riches, de l’aristocratie qui est le pouvoir d’une minorité d’hommes vertueux soucieux du bien commun. « Le principe essentiel de l’aristocratie paraît être d’attribuer la prédominance politique à la vertu; car le caractère spécial de l’aristocratie, c’est la vertu, comme la richesse est celui de l’oligarchie, et la liberté, celui de la démocratie. Toutes trois admettent d’ailleurs la suprématie de la majorité, puisque, dans les unes comme dans les autres, la décision prononcée par le plus grand nombre des membres du corps politique, a toujours force de loi. »
Voilà une phrase essentielle, en ce qu’elle résume la typologie des modes de gouvernements (bien qu’il ne parle pas ici de ce qu’il nomme monarchie, tyrannie et république) mais surtout, en ce qu’elle nous alerte sur un fait absolument crucial : tous les types de gouvernement cités reposent sur la décision de la majorité (par le truchement du vote et de la délibération). Ainsi, le vote n’est en rien la garantie d’un système démocratique. Le plus important est bel et bien la composition du « corps politique » c’est-à-dire que ce qui compte c’est de déterminer qui peut voter et exercer réellement le pouvoir. Or, aujourd’hui, toute remise en question de ce qui est présenté comme « démocratie » se voit disqualifier au motif qu’il existe un droit de vote : « nous sommes en démocratie, la preuve : on vote ». Nous ne sommes plus capables de penser collectivement la démocratie qu’en termes de vote, il y a une équivalence, dans le discours dominant, entre vote et démocratie. C’est oublier que le droit de vote n’est pas le propre de la démocratie et que voter ça n’est pas « exercer le pouvoir »… Réduire ainsi la démocratie au vote revient à l’atrophier singulièrement, à la rabougrir et finalement, à l’annihiler. Mais c’est une annihilation subtile.
Notons en passant que l’Athènes antique recourrait fréquemment au tirage au sort en plus du vote pour désigner les membres de la Boulê, cette assemblée chargée entre autre de préparer les lois soumises au vote des citoyens.
4-Qu’est-ce qu’un citoyen ?
Un mot de ce qu’Aristote nomme les citoyens, les détenteurs du pouvoir politique. On l’a dit, une communauté sera dite « politique » si elle vise le bien de ceux sur qui s’exerce le pouvoir et qui sont égaux entre eux ; à la différence de la communauté « despotique » qui ne vise que le bien du despote lui-même (ou des oligarques). Les citoyens sont nécessairement égaux, car si certains jouissaient de droits supérieurs à ceux des autres, ils seraient à même de confisquer le pouvoir à leur seul profit, privant les autres de leur citoyenneté ; on retomberait donc dans un régime de moindre perfection où seule une fraction du peuple aurait le pouvoir (l’« aristocratie » ou, dans sa forme dévoyée, l’« oligarchie »). L’égalité ds citoyens est à l’origine de la Philia, cette sorte d’amitié si chère à Aristote. Une amitié qui est le « ciment » de la communauté politique, comme l’amour serait le « ciment » de la communauté familiale. Les citoyens disposent donc de droits égaux, au sein d’une communauté politique souveraine visant à satisfaire l’intérêt général. Dans cette communauté, le citoyen, selon la formule d’Aristote, « participe au pouvoir de la cité ». Il précise : « Quiconque a la possibilité de participer au pouvoir délibératif ou judiciaire, nous disons dès lors qu’il est citoyen de cette cité ».
Il est fondamental de remarquer qu’à Athènes, et cela est vrai dans La politique, il n’existe de citoyens que parce qu’il existe une cité ; les deux sont absolument indissociables. Plus que cela même, comme le fait remarquer le philosophe Cornélius Castoriadis, la cité n’est pas une entité géographique mais purement politique. De sorte que qu’il est impensable de parler de « la cité d’Athènes », mais « des athéniens » : le peuple, c’est la cité. On ne peut penser de citoyens en dehors d’une communauté politique. Au passage, on comprend ainsi pourquoi l’expression « citoyen du monde » est une pure fantaisie, aussi creuse que stupide.
Un citoyen n’est pas tenu d’exercer effectivement le pouvoir tout le temps, par contre, il faut qu’il puisse l’exercer : celui qui ne peut pas exercer le pouvoir n’est pas citoyen. Les choses sont donc très simples : exercer le pouvoir ou pouvoir l’exercer. Dans la communauté idéale (qu’Aristote nomme « gouvernement constitutionnel » mais qui correspond à ce que nous entendons par démocratie), ceux sur qui s’exerce le pouvoir, et ceux qui l’exercent sont les mêmes (à l’exception, dans l’Athènes antique, des métèques, des étrangers et des femmes, ce qui fait certes beaucoup…), « de telle sorte que commander et obéir, au lieu de s’opposer comme deux absolus, deviennent les deux termes inséparables d’un même rapport réversible » (JP. Vernant, Les origines de la pensée grecque). C’est d’ailleurs ce qui fonde le consentement au pouvoir. Je consens à un pouvoir qui s’exerce sur moi car je sais qu’il œuvre au bien commun et que je puis être à même de l’exercer à mon tour. Voilà en somme la formule de la démocratie.
A nouveau, remarquons un fait particulièrement inspirant de la démocratie athénienne : le citoyen qui avait proposé un loi adoptée par l’assemblée des citoyens (l’Ecclésia) était responsable de cette loi, il pouvait être condamné si cette loi s’avérait néfaste. Cette notion de responsabilité est fondamentale dans la mesure où elle fait de la loi une construction humaine. La loi ne tombe pas du ciel, elle est proposée par des hommes, parfois avec des arrières-pensées, des intérêts plus ou moins cachés bref, des hommes incarnés. Les athéniens considéraient être responsables des lois qu’ils faisaient, au contraire de notre monde, où le législateur n’est jamais responsable même en cas d’échec ou de tromperie.
5-La démocratie, toujours instable
Pour finir, ajoutons que la démocratie est un régime en perpétuel équilibre instable. Elle se tient comme sur une ligne de crête sans cesse branlante et chancelante. Elle menace de basculer d’un instant à l’autre, si l’on n’y prend garde, et de rouler à bas de la montagne pour se précipiter dans les profondeurs des abîmes ; elle est à l’image de ce rocher que Sisyphe fut condamné, en d’autres temps, à déplacer en vain. La démocratie, une fois installée, ne doit jamais être livrée à elle-même, sous peine de mort.
Aristote avait déjà vu cela : sa théorie des différents régimes politiques n’est point figée, mais toujours dynamique. Les régimes sont le fruit d’une subtile composition, ils ne sont que rarement purs : telle constitution est le résultat d’un peu de démocratie ici, un peu d’oligarchie là, un soupçon de tyrannie ailleurs. La politique est vivante, Aristote ne le savait que trop bien, lui qui écrivit La politique au moment même où la république qu’il défendait était déclinante. Sur cette notion d’équilibre instable, Aristote, au livre VI écrit : « Il faut toutefois ajouter ici une observation importante : c’est que souvent, sans que la constitution soit démocratique, le gouvernement, par la tendance des mœurs et des esprits, est populaire; et réciproquement en d’autres cas, bien que la constitution légale soit plutôt démocratique, la tendance des mœurs et des esprits est oligarchique. Mais cette discordance est presque toujours le résultat d’une révolution. C’est qu’on se garde de brusquer les innovations ; on préfère se contenter d’abord d’empiétements progressifs et peu considérables ; on laisse bien subsister les lois antérieures ; mais les chefs de la révolution n’en sont pas moins les maîtres de l’État. » Il montre donc que la constitution démocratique d’une cité ne garantit pas, à elle seule, que ladite cité soit effectivement démocratique. Il faut regarder plus loin ce qui se passe effectivement dans la cité. En particulier la constitution sociologique de la cité fait l’objet de nombreux développements chez Aristote. Le précepteur d’Alexandre le Grand dit que le régime effectif dépend en grande partie de la proportion de riches (qui auront tendance à privilégier l’oligarchie) ou de pauvres (qui préféreront la démagogie), de laboureurs ou de marchands. La stabilité politique vient de la classe moyenne, qui doit être la plus nombreuse : « La constitution n’est solide que là où la classe moyenne l’emporte en nombre sur les deux classes extrêmes » (livre VI) affirme sans ambiguïté Aristote. La pensée d’Aristote, que l’on a qualifié de précurseur du pragmatisme, permet de comprendre dans quelle mesure c’est la cité concrète dans son ensemble qui doit faire l’objet des soins du législateur sous peine de corruption.
6-Pas de démocratie sans éducation
La notion des « mœurs et des esprits » des citoyens est tout-à-fait fondamentale, car elle insiste sur le fait que la politique n’est point étrangère au caractère et aux vertus morales des citoyens et plus précisément, en parlant ainsi, Aristote nous alerte sur la nécessité impérieuse pour la stabilité de la cité de la bonne formation et éducation de ces derniers. Voilà pourquoi l’éducation fait l’objet de tant de paragraphes et de développements, au livre V en particulier: « Personne ne contestera donc que l’éducation des jeunes gens ne doive être l’un des principaux objets des soins du législateur ; car tous les Etats[5] qui l’ont négligée en ont éprouvés un grand dommage. »
La première des instructions est sans conteste l’écriture, puisqu’elle est le fondement de la démocratie. D’ailleurs, la Grèce antique après avoir l’abandonné pendant des siècles, et l’avoir redécouverte grâce aux Phéniciens, a accompli un véritable tour de force en la matière en démocratisant comme jamais auparavant l’écriture. Les jeunes gens doivent en outre être éduqués à la vertu et aux mœurs démocratiques, aux sciences, mais aussi, Aristote en fait un point important de sa théorie de l’éducation, aux choses de l’esprit et à celles permettant « un noble emploi de nos loisirs » (livre V). L’éducation ne doit en aucun cas se contenter d’inculquer aux jeunes esprits des savoirs « utiles », ou, dirait-on aujourd’hui, permettant leur « insertion sur le marché de l’emploi ». En d’autres termes, la bonne éducation ne prépare pas à l’exercice d’un métier, mais à celui de la citoyenneté. C’est pourquoi Aristote insiste sur l’apprentissage de la musique. L’éducation doit élever l’esprit, elle doit permettre à chacun d’occuper dignement ses temps de loisirs au lieu d’en faire un individu n’ayant que des « compétences » utiles à leur emploi futur[6]. Pour élire les meilleurs, pour juger des stratégies politiques, pour participer soi-même à l’exercice du pouvoir, il faut nécessairement être éduqué, et bien éduqué. Un citoyen non éduqué, dépourvu de connaissances solides et d’une capacité de jugement ne peut que se laisser abuser par le premier « expert » ou le premier démagogue venu. Bref, il ne peut être pleinement citoyen. Cette vision de l’éducation est celle des penseurs des Lumières. Toute la pensée des Lumières insiste sur le pouvoir émancipateur du savoir, de l’éducation. Les penseurs du XVIIIème avaient une confiance, sûrement excessive, en une mécanique allant du savoir au progrès politique et moral.
7-Contre-pouvoirs
L’éducation fait partie de ce qu’on l’on appelle des « contre-pouvoirs », aux côtés notamment, de l’information et du journalisme – qui sont, d’une certaine manière, une autre forme d’éducation. Beaucoup de grandes figures de la Révolution Française créèrent leur journal ou collaborèrent à ceux des autres, ce fut une époque où la presse écrite connut une ascension fulgurante et probablement sans égale à ce jour. L’activité journalistique se doit d’être subversive à l’égard des pouvoirs établis afin de tenir son rôle et donc elle n’existe qu’afin d’interroger sans cesse le pouvoir en place, le « bousculer », mais en aucun cas elle ne peut se borner à accompagner son mouvement de manière passive. Les contre-pouvoirs sont censés « réguler » la vie démocratique pour la préserver de l’emballement populiste au sens péjoratif du terme (substitution du peuple par la populace) autant que de la tentation oligarchique. Ce sont des contrepoids d’une certaine manière.
Ces deux points sont d’une importance capitale. L’emballement populiste qui nous menace correspond à ce qu’Aristote appelait « démocratie », mais que l’on traduit parfois par « démagogie » et qui est une version dévoyée de la véritable démocratie (au sens moderne). Dans un tel type de régime politique, les masses ont le pouvoir et l’exercent à leur unique profit, au détriment des classes supérieures – pour employer un vocabulaire anachronique. Cela serait en somme le pouvoir donné au ressentiment, une version de la Terreur de 1793 ou du maoïsme : mort aux intellectuels, mort aux aristocrates. On peut aussi placer du côté de l’emballement populiste cette tendance qu’a la démocratie à vouloir araser les comportements, bannir, au nom de l’égalité, toute forme de grandeur, « couper les têtes qui dépassent ». On rejoint là ce que le penseur Alexis de Tocqueville nommait la « tyrannie de la majorité ». Ce ne peut en aucun cas être un idéal à poursuivre. Quant à la tentation oligarchique, c’est la menace qui pèse en permanence sur la démocratie : l’ivresse du pouvoir, ou encore la tentation que pourrait avoir le peuple de s’en remettre à un homme providentiel et de se livrer pieds et poings liés à lui, ou comme c’est plutôt le cas aujourd’hui, à des « experts » et des technocrates. Cette dérive désigne l’état dans lequel le peuple, sans doute sous l’effet d’une peur ou d’une défiance vis-à-vis de lui-même, renonce à son pouvoir pour le confier à ceux qui prétendent mieux savoir que lui. Voilà les deux dangers qui nous guettent en l’absence de contre-pouvoirs.
8-Aristote vs Platon : la démocratie des experts ?
Enfin, on ne pourrait conclure sans évoquer la controverse entre Platon et son disciple Aristote sur la démocratie. Le premier était le promoteur d’une organisation aristocratique de la politique, qui considérait que chaque citoyen avait une juste place à tenir et qu’une hiérarchie d’airain devait les assigner à cette juste place. Les meilleurs (aristoi en grec, qui donne l’aristocratie) doivent gouverner, cependant que les autres doivent être commandés et obéir. Le philosophe-catcheur (Platon fut champion aux Jeux Olympiques de lutte) établit en effet, dans La République, une sévère tripartition de la société : les paysans à la base, les magistrats au sommet, les gardiens (c’est-à-dire les policiers) au milieu. Quant au pouvoir, il est exercé par un philosophe-roi. Ce modèle de cité idéale repose sur l’idée selon laquelle la politique est un objet de savoir, et que certains en sont pourvu, mais pas d’autres. Cela tient à ce qu’il existe une vérité en matière politique. Il faut donc « laisser le pouvoir à ceux qui savent ». Cette idée a traversé les millénaires, on la retrouve telle quelle dans le néolibéralisme qui promeut un « gouvernement des experts » : les citoyens, la masse, le peuple, sont passionnés, moutonniers, grégaires, agressifs, impulsifs, bêtes… ils ne sont bons qu’à être conduits par des bergers qui savent ce qui est bon pour eux.
Ce à quoi Aristote opposait que la politique n’est pas affaire de savoir mais d’opinion, de doxa, dit-il. Bien qu’il y ait des individus supérieurs en terme de vertu, ou de compétence dans tel ou tel domaine, Aristote argue de l’existence d’une intelligence collective émergente pour justifier la participation des citoyens aux affaires de la polis. Il écrit : « Attribuer la souveraineté à la multitude plutôt qu’aux hommes distingués […] peut sembler une solution équitable et vraie de la question, quoiqu’elle ne tranche pas encore toutes les difficultés. On peut admettre en effet que la majorité, dont chaque membre pris à part n’est pas un homme remarquable, est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon individuellement, du moins en masse […]. Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse; et tous en se rassemblant forment, on peut dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence en proportion. Ainsi, la foule porte des jugements exquis sur les œuvres de musique, de poésie; celui-ci juge un point, celui-là un autre, et l’assemblée entière juge l’ensemble de l’ouvrage. » Aristote formule une idée que les penseurs aristocratiques et néolibéraux n’eurent de cesse de combattre, et sans laquelle la démocratie s’effondrerait. L’intelligence collective en question ne s’obtient que parce que les citoyens sont instruits et éduqués et ont une forme d’expertise particulière qui s’assemble à toutes les autres. En effet, il n’existe pas d’expert en tout, seul à même se saisir toute la complexité de la cité, voilà l’argument d’Aristote [7]. Et même si cela était possible, ces experts ne seraient pas nécessairement inspirés par la vertu, qui doit présider à l’administration de la cité dans bien des domaines. Un stratège, nous dit Aristote, doit être un expert de la stratégie – une compétence fort rare. Alors qu’un trésorier public devra faire preuve d’une probité à toute épreuve, il se devra d’être un « expert en probité ». Autrement dit, Aristote nous conduit à penser que l’expertise requise par l’exercice du pouvoir dépasse largement celle du savoir, mais s’étend en de nombreux cas à la vertu. Ce qui rend nécessaire une prise de décision collective, de délibération, mais aussi d’élection. On a un donc double principe : aristocratie des meilleurs et des vertueux, grâce à l’élection, en même temps qu’une égalité démocratique totale devant la loi et son élaboration (isonomia) afin de faire émerger une intelligence collective. Autrement dit, la bonne république combine le meilleur de l’aristocratie et le meilleur de la démocratie.
[1] Aristote s’oppose aux théories « contractualistes » de la politique, que l’on retrouve chez Epicure, puis au XVIème chez Hobbes, puis Rousseau qui supposent que la politique serait le fruit d’un « contrat » passé entre les hommes. Pour Aristote, la politique est une disposition naturelle de l’homme.
[2] Sur le sujet du conflit en politique, Le néant et le politique, d’Harold Bernat, dont nous avons déjà parlé ici.
[3] Il y a un quiproquo possible qu’il faut s’empresser de dissiper. J’emploie le mot démocratie au sens moderne, c’est-à-dire le pouvoir du peuple souverain. Sous la plume d’Aristote, le mot « démocratie » avait un usage polémique, certains traducteurs, pour éviter la confusion, préférèrent le traduire par « démagogie ». Mais redisons-le, le régime idéal prôné par Aristote (dans La politique) est assez proche de la démocratie moderne.
[4] En effet, Aristote ne remet pas en question l’existence de l’esclavage. Les esclavages n’étant pas libres, ils ne participent pas à la démocratie.attribuée à tous les hommes libres, oligarchie là où elle appartient exclusivement aux riches
[5] Comme le fait remarquer le philosophe Cornélius Castoriadis, le mot Etat doit être traduit par « cité ». Les anciennes traductions, inspirées de la philosophie allemande, traduisaient « polis » par Etat, ce qui est une erreur. « Polis », la cité, désigne bien plutôt le peuple.
[6] N’éduquer les jeunes qu’à ce qui est « utile dans la vie », ou ce qui permet de trouver un travail, c’est nier une dimension fondamentale de l’être humain, et surtout, arrimer les individus au travail, ne leur donner aucun espoir d’émancipation. Il est évident que de tels individus ne peuvent qu’occuper leur temps libre devant la télévision ou dans les industries « culturelles » de masse – qui sont de parfaits instruments du libéralisme. Voilà pourquoi apprendre des chose « inutiles » (c’est-à-dire inutiles pour le libéralisme) est en soi un acte de résistance.
[7] J’ai bien conscience du caractère caricatural de ce paragraphe. Aristote est très nuancé sur le sujet, très prudent – sa vertu cardinale – il ne cesse de rappeler qu’une bonne constitution n’est pas bonne dans l’absolu ni de façon abstraite, mais toujours relativement à la composition sociologique de la cité, à son environnement, etc. De même, il pointe en permanence les dangers d’une cité administrée uniquement par des principes démocratiques, ou aristocratiques, il est partisan d’une hybridation des régimes. Je ne saurai que trop vous recommander de lire Les Politiques, en particulier les livres VI et VIII sur ce sujet.
Concluons avec Cornélius Castoriadis. Le penseur franco-grec, glissant ses pas dans ceux d’Aristote, reprend la question de la démocratie à la base et en cherche les « germes » dans les cités antiques. Dès les années 90, il nous mettait en garde contre une vision purement « procédurale » de la démocratie, disait-il dans La montée de l’insignifiance. Cette conception « trouve son origine dans la crise des significations imaginaires concernant les finalités de la vie collective et vise à recouvrir cette crise en dissociant toute discussion relative à ces finalités de la « forme de régime » politique, à la limite même en supprimant l’idée même de telles finalités ». Ce que dit Castoriadis est crucial : nous ne pensons plus la démocratie qu’en termes de procédures, d’ajustements technocratiques totalement déconnectés de l’idée de démocratie. Toutes les réformes de la pseudo vie démocratique ne visent qu’à jouer sur des curseurs : tant de députés, tels seuils, plus ou moins de transparence ici ou là, un peu plus de contrôle parlementaire… Mais jamais on ne s’interroge sur ce qu’est la démocratie au fond, ni les fins qu’elle poursuit. Qu’est-ce que la démocratie ? Pourquoi la préférer aux autres régimes ? Quel et son but ? Et après cela, comment s’incarne-t-elle ? Or, ne pose plus ces questions, on fait croire que l’on sait ce qu’est la démocratie, charge ensuite au législateur de lui donner forme. En clair : on met la charrue avant les bœufs pour masquer le fait qu’il n’y a plus de bœufs. Et surtout, on s’imagine qu’il suffit que nos procédures soient teintées de démocratie pour que nous soyons dans une démocratie véritable. Funeste confusion – sans doute entretenue à dessein. La démocratie, qui n’existe déjà plus en France, si tant est qu’elle existât jamais un jour, est plus que jamais en danger de disparition totale et peut-être définitive.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou mettre un « j’aime » !
Vous pouvez prolonger le débat dans les commentaires en bas de page ou simplement nous faire connaître votre avis sur l’article.



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



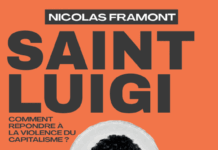




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)









[…] démocratie et vote, ce qui déjà ne va pas de soi[2]. J’ai essayé de proposer quelques réflexions sur la démocratie, pour nourrir le débat et montrer que cette idée est grosse de mille richesses qui ne se […]
[…] et de l’inconvénient de l’histoire pour la vie. [3] Idem. [4] Je vous renvoie à notre article Réflexions sur la démocratie, mais aussi Pourquoi il faut refuser le débat […]
[…] au débat. Elle est avant tout un mode d’exercice du pouvoir ! Je vous renvoie à notre article Réflexions sur la démocratie qui approfondit le sujet. En démocratie, le peuple ne débat pas sans fin des décisions que […]
[…] à leur seul profit. C’est bien la situation actuelle. [8] Je vous renvoie à notre article Réflexions sur la démocratie. [9] Par « susceptibilité » je désigne l’extension du domaine de l’insulte et de la […]
[…] à leur seul profit. C’est bien la situation actuelle. [8] Je vous renvoie à notre article Réflexions sur la démocratie. [9] Par « susceptibilité » je désigne l’extension du domaine de l’insulte et de la […]