Heurs et malheurs de l’intersectionnalité
L’intersectionnalité contre elle-même : repenser les luttes
Les luttes pour l’émancipation connaissent depuis quelques années de profonds bouleversements. Elles ont eu dans l’histoire de multiples visages, que l’on songe par exemple à la riche tradition socialiste, puis communiste ou anarchiste, mais aussi, à sa manière, à la pensée libérale – qui s’est construite, ne l’oublions pas, comme un remède à la société d’Ancien Régime. Dans l’imaginaire qui structurait ces luttes, il faut bien l’avouer, la pensée marxiste a joué un rôle à part, à la fois en termes de puissance théorique que de stratégie concrète. La lutte des classes a pendant très longtemps constitué le cadre dans lequel prenaient place ces combats pour l’émancipation : sociale, féministe, anticolonialiste etc. Depuis une quarantaine d’années, et plus encore ces vingt dernières années, on assiste, dans le champ des sciences sociales – censées décrire et analyser, entre autres, les processus de domination – comme dans celui des mouvements militants, l’apparition de nouveaux concepts et de nouvelles pratiques de lutte contre les discriminations et pour l’émancipation. La notion d’intersectionnalité en fait partie. Souvent brandie comme un étendard par les militantes et militants féministes, antiracistes, décoloniaux, queers ou d’extrême gauche, l’intersectionnalité est, a contrario, perçue comme un repoussoir dans les milieux dits « républicains », laïcs, ou encore marxistes. Elle serait le cheval de Troie de l’« indigénisme », de l’antirépublicanisme forcené, de même que la négation de valeurs fondamentales du féminisme ou de l’humanisme au sens large, la porte ouverte au communautarisme débridé, la fragmentation du corps social et la fin du « vivre-ensemble ». Dans ce brouillard conceptuel, nous allons essayer d’y voir un peu plus clair.
Qu’est-ce que l’intersectionnalité ?
L’intersectionnalité est un concept apparu aux Etats-Unis à partir des années 1970 dans le sillage du Black Feminism et du Black Power Movement. Au sein des sciences sociales, l’idée s’élabore à la fin des années 1980 sous la plume de la juriste Kimberle Crenshaw dans un article célèbre : « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics ». Le terme d’intersection est posé dès le titre de l’article, manifestant son rôle central dans la nouvelle approche proposée – bien que les problématiques mêlant race et genre aient déjà été explorées auparavant par des militantes, le concept leur faisait défaut pour les systématiser. L’intersectionnalité est ainsi, sur le plan historique, un concept avant d’être une pratique, un outil forgé par une juriste pour décrire et comprendre le monde social. Kimberle Crenshaw observe que les femmes noires victimes de discriminations ont du mal à faire reconnaître leur préjudice devant les tribunaux, en raison du fait qu’elles sont victimes de discriminations pensées comme distinctes : le sexisme d’un côté et le racisme de l’autre, alors qu’en réalité, celles-ci se combinent, se pénètrent et se renforcent. Le système judiciaire ne reconnaissait que les discriminations ciblant l’une ou l’autre de ces catégories. Les tribunaux ne pouvaient penser qu’une femme noire pût être victime, précisément, en tant que femme noire et non en tant que femme ou que noire. « Dans les cas de discriminations raciales, écrit Crenshaw, la discrimination tend à être interprétée en termes de privilège de sexe ou de classe chez les noirs ; dans les cas de discriminations sexistes, l’accent est mis sur les femmes privilégiées par leur race ou leur classe »[1], ce qui, au final, aboutit à ne pas toujours reconnaître le préjudice subit, faute de catégories adéquates pour le penser. Les femmes noires se retrouvent ainsi dans une sorte de « vide juridique », ou plutôt de « vide conceptuel » : leurs discriminations, complexes et composites, ne pouvant être pensées, elles ne sont pas juridiquement reconnues. Voilà le point de départ de Kimberle Crenshaw.
La juriste marque dès le début de son article sa volonté de « mettre en contraste l’expérience multidimensionnelle des femmes noires et les analyses unidimensionnelles [single axis analysis] qui déforment ces expérience »[2]. Elle démontre que les analyses unidimensionnelles, qui ne prennent en compte que le sexe ou la race sans essayer de les combiner, non seulement échouent à rendre compte de l’expérience réelle des femmes noires, mais en plus « contribu[ent] à marginaliser les femmes noires dans la théorie féministe aussi bien que dans les politiques antiracistes »[3]. L’intersectionnalité pourrait tout aussi bien être appelée : théorie multidimensionnelle de l’expérience de la subordination. Crenshaw s’adresse aux antiracistes et aux féministes pour leur faire toucher du doigt des réalités complexes que leur approche monodimensionnelle ignore. Ainsi, l’intersectionnalité ouvre une béance en premier lieu au sein des mouvements d’émancipations eux-mêmes, pour montrer qu’ils ne sont pas exempts de jeux de dominations internes. « Les luttes intersectionnelles sont forcément des luttes internes : l’intersectionnalité n’est pas une organisation mais une question qui se pose à toutes les organisations. »[4]
Les situations décrites par Crenshaw illustrent le fait que les femmes noires ne subissent pas d’un côté le racisme et de l’autre le sexisme, mais une synthèse des deux – voire plus –, c’est-à-dire qu’elles se situent à l’intersection des différentes dominations. La juriste donne alors une définition possible de l’intersectionnalité : « Ces problèmes d’exclusion ne peuvent être résolus simplement en incluant les femmes noires à un cadre analytique préexistant. Parce que l’expérience intersectionnelle est supérieure à la somme du racisme et du sexisme, aucune analyse ne tenant pas compte de l’intersectionnalité ne peut expliquer de manière adéquate le type particulier de subordination des femmes noires »[5]. Ainsi, le concept d’intersectionnalité permet de comprendre que les dominations ne s’ajoutent pas mais qu’elles se renforcent mutuellement. Le produit de ce phénomène est alors nommé par Crenshaw « l’expérience intersectionnelle » : ni racisme, ni sexisme, ni simple mélange des deux, il s’agit d’une catégorie à part, dont les sciences sociales se doivent de rendre compte.
Avec son article pionnier, Crenshaw a ouvert la voie à de très nombreuses recherches en sciences sociales portant sur les modes de domination, s’inscrivant dans le vaste champ de ce que l’on appelle les subaltern studies. Le concept d’intersectionnalité s’est enrichi au fil des années, puisqu’il a débordé le cadre de l’étude du racisme et du sexisme. On l’utilise abondamment pour décrire l’expérience homosexuelle, queer, l’oppression de classe, la domination fondée sur l’âge ou les capacités physiques etc. L’idée de l’intersectionnalité est en somme qu’il existe un continuum des dominations, qui ne sont pas séparables les unes des autres dans l’expérience qu’en font les individus. Une personne noire est nécessairement homme, femme ou trans, homosexuel, hétérosexuel, vieux, jeune, riche ou pauvre, valide ou porteur d’un handicap. L’individu se situe donc à l’intersection des différents jeux de pouvoir et de domination, ce que Michel Foucault nomme « biopouvoir » – autrement dit, la puissance normative de la société. En effet, Crenshaw pose que la domination n’est pas qu’un processus intentionnel car elle est aussi inscrite dans une multitude de rapports sociaux, d’attitudes, de discours, d’habitus au sens de Pierre Bourdieu. Les dominants imposent, de façon inconsciente, leurs propres normes au corps social, normes qui deviennent d’une certaine façon « naturelles » pour ses membres. Telles façons de faire, de se comporter, tels stéréotypes, telles conventions sociales semblent aller de soi, nous n’y prêtons plus attention alors qu’ils véhiculent, malgré nous, des rapports de domination. C’est notamment le cas des stéréotypes de genre ou de race. La norme sociale (quel qu’en soit finalement le domaine : juridique, esthétique, langagier, etc.) semble n’être pas autre chose que les us et coutumes des dominants. C’est du moins le postulat qui apparaît en filigrane dans les subaltern studies. Mais cette représentation de la norme sociale est très incomplète, car elle oublie que les façons de s’insérer et d’évoluer dans l’espace social sont largement guidées par ce que Marcel Mauss appelle le « don/contre-don », c’est-à-dire la « triple obligation de donner, recevoir et rendre »[6]. Or, le don/contre-don, qui engendre le social en tant que tel, est à l’origine d’une forme de moralité spontanée, une « éthique minimale de la vie quotidienne » pour utiliser cette belle formule de Bruce Bégout, la common decency, si chère à George Orwell. La common decency est elle-même normative, quoi que négativement, « sous la forme d’une interdiction : « il y a des choses qui ne se font pas » »[7]. Or, les subaltern studies sont imperméables à cette dimension fondamentale de la société, sauf, bien sûr, à dire que la common decency serait elle-même une manifestation de l’inconscient raciste, sexiste et oppressif de la société.
Ces structures inconscientes de domination ont depuis longtemps déjà été décrites. Les féministes n’ont pas attendu les années 80 pour décrire le rôle du patriarcat. L’intersectionnalité permet de faire le lien entre les différentes structures de domination sociale. Mais l’intérêt du travail de Kimberle Crenshaw va plus loin. Non content de forger un nouveau concept, elle le développe dans toutes ses dimensions. Elle parle bien sûr de l’invisibilisation des discriminations raciales au sein des mouvements féministes et dénonce le fait que ceux-ci, croyant parler au nom des femmes, en réalité portent la voix des femmes dominantes, c’est-à-dire les femmes blanches. Ces mouvements véhiculent des stéréotypes inconscients et s’imaginent défendre la condition féminine universelle et abstraite alors qu’ils défendent la condition des femmes blanches. Crenshaw rejoint alors la dénonciation de prétendues « valeurs universelles » qui ne seraient rien d’autre que l’universalisation des valeurs dominantes (masculines et blanches en l’occurrence). Cette idée d’un universalisme comme faux-nez de l’oppression et de la domination a largement été développée par les philosophies dites « de la déconstruction », celles de Foucault ou Derrida en premier lieu. Déconstruction des universaux, de ce que l’on prend pour naturel : le genre, l’organisation sociale, les valeurs morales, l’esthétique… tout y passe… Faisant référence aux valeurs « universelles » mises en avant par les féministes, Crenshaw écrit : « La parole universaliste qui fait autorité – la plupart du temps la subjectivité masculine blanche travestie en objectivité sans race et sans genre – est simplement plaquée sur ceux qui, mis à part le genre, partagent la plupart des caractéristiques culturelles, économiques et sociales »[8].
Mais Crenshaw ne se contente pas de dénoncer le racisme potentiel des organisations féministes et du concept d’universalité, ce qui serait une mise en pratique borgne et unilatérale de l’intersectionnalité – précisément ce contre quoi lutte le concept même d’intersectionnalité. Elle met en lumière également le sexisme présent au sein des communautés noires (on dirait aujourd’hui, plus largement, « racisées »). S’il faut adopter une démarche intersectionnelle, donc multidimensionnelle, multipolaire, multiaxiale, cela implique de débusquer les pratiques de dominations souterraines dans tous les groupes sociaux. En effet, l’expérience des femmes noires, à laquelle s’intéresse Crenshaw, est l’intersection[9] du racisme et du sexisme. Si le racisme est majoritairement le fait des dominants, c’est-à-dire les blancs[10], hommes ou femmes, le sexisme est, symétriquement, le fait des dominants, c’est-à-dire les hommes, blancs ou noirs. Voilà l’une des leçons de l’intersectionnalité – que Crenshaw illustre mais que ceux qui reprennent son concept essaient à toute force d’occulter. Kimberle Crenshaw parle par exemple de « domination de genre au sein de la communauté noire »[11], plus loin, elle ajoute que « parce que les définitions idéologiques et descriptives du patriarcat se basent habituellement sur l’expérience des femmes blanches, les féministes […] courent le risque de supposer à tort que puisque le rôle des femmes noires dans la familles et les autres institutions noires ne ressemble pas toujours aux manifestations familières du patriarcat de la communauté blanche, les femmes noires n’ont pas à subir de normes patriarcales »[12]. La juriste explique clairement qu’il existe un patriarcat noir, auquel les approches non intersectionnelles demeurent aveugles car celui-ci prend une forme différente du patriarcat blanc. Voilà le genre de constat que seule une approche intersectionnelle – c’est-à-dire décentrée – permet de formuler. Nous y reviendrons. L’article fondateur de la juriste américaine développe l’intersectionnalité dans toutes ses dimensions, et montre véritablement ce que signifie, pour une femme noire, être à l’intersection du racisme et du sexisme, c’est-à-dire subir les jeux de domination dans les différentes communautés.
Les travaux de Kimberle Crenshaw, en mettant en avant la notion d’intersectionnalité, constituent un apport conceptuel remarquable à la compréhension des phénomènes de domination – que l’on soit par ailleurs partisan ou non de cette approche. « Une sociologie réflexive peut donc s’inspirer du discours critique de l’intersectionnalité non pour affirmer l’existence de situations plus complexes mais pour constituer toute situation comme complexe, notamment en rendant problématiques des propriétés invisibles parce que dominantes telles que la blancheur ou l’hétérosexualité. Un rapport social ne s’incarne jamais de manière générique ; il n’y a que des cas particuliers : c’est le premier message critique de l’intersectionnalité. »[13] En tant que concept théorique, l’intersectionnalité est une pierre importante à l’édifice des sciences sociales. Puisque leur ambition est de décrire la société et tout particulièrement les rapports de force qui y prennent place, ainsi que d’analyser les interactions concrètes entre les individus et « le social » au sens large, elles sont avant tout une démarche de connaissance, les concepts qu’elles utilisent sont donc en premier lieu des outils pour une meilleure compréhension du monde. Mais « du fait que leur objet, donc ce qu’elles disent à son propos, est un enjeu politique – ce qui les met en concurrence avec tous ceux qui prétendent parler avec autorité sur le monde social, écrivains, journalistes, hommes politiques, personnel religieux, etc .– elles sont particulièrement exposées au danger de “politisation” »[14]. Or, l’intersectionnalité est aujourd’hui devenu un enjeu majeur de politisation, qu’elle soit le fait de certains sociologues eux-mêmes, qui rejettent l’autonomie des sciences sociales par rapport à la politique, ou de militants. Il faut en effet bien voir que l’intersectionnalité inspire des pratiques militantes ainsi que des interprétations politiques pour le moins critiquables. Mais critiquer cette récupération, ce qui va nous occuper à présent, ce n’est pas rejeter tout de go le concept même d’intersectionnalité. Nous verrons l’usage que l’on peut en faire, dans une perspective socialiste.
Les mirages de l’intersectionnalité
Les luttes contre les discriminations actuelles clament haut et fort leurs revendications intersectionnelles. La « convergence des luttes » est devenu le mantra obligé de tous les mouvements antiracistes, féministes ou LGBT+[15] modernes. Dans les discours des militantes et des militants, les travaux de Kimberle Crenshaw sont souvent cités comme des références. Pourtant, force est de constater qu’ils lui sont particulièrement infidèles, quand ils n’en trahissent pas purement et simplement le contenu.
De nombreux mouvements se réclament de l’intersectionnalité ont vu le jour en France, en important le plus souvent des théories, des thématiques voire des enjeux étatsuniens. L’afroféminisme en fait partie – l’une de ses figures les plus médiatiques étant la journaliste et militante Rokhaya Diallo. Ce n’est pas le seul, puisque le paradigme intersectionnel irrigue en profondeur les recherches académiques. De nombreuses critiques se sont alors faites entendre pour le dénoncer. Les débats font d’autant plus rage que ce concept est, on l’a dit, sorti du cadre universitaire de la recherche en science sociale pour être instrumentalisé par des militants qui, trop souvent, se confondent avec les chercheurs eux-mêmes. Il se fait, on l’a vu, que la théorie intersectionnelle est née historiquement au sein du mouvement féministe, les préoccupations raciales sont donc venues ronger le féminisme de l’intérieur. Ce concept a joué le rôle de cheval de Troie pour saper le vieil universalisme occidental hérité des Lumières[16] et servir l’agenda d’associations ou d’organisations de « racisés ». Ce faisant, un pan entier de l’intersectionnalité a été passé sous silence voire rejeté, celui de la critique du patriarcat non blanc. Les militants ou chercheurs qui citent l’article de Kimberle Crenshaw prennent grand soi d’éviter de parler de cet aspect, pourtant loin d’être marginal, de son travail[17]. Ce que je veux dire là est fort simple. En réalité, l’intersectionnalité permet, dans l’univers militant, de parer des atours de la scientificité et d’un habillage conceptuel au départ rigoureux la hiérarchisation des luttes. C’est un renversement complet de l’intersectionnalité.
En effet, si l’on admet que le féminisme (ou les femmes) peut être – malgré lui – raciste car aveugle à ses propres stéréotypes, mais que l’on n’admet pas que l’antiracisme (ou les personnes « racisées ») peut être sexiste, alors, on soulage les femmes racisées d’un part de racisme, mais pour mieux les jeter dans les bras de tous les patriarcats « racisés », tout aussi oppressifs que le patriarcat blanc – voire plus car on refuse de les considérer comme tels. Cet intersectionnalité « borgne » en fait trahit l’intersectionnalité véritable, mais pire, trahit les femmes, en particulier les femmes « racisées ».
Le problème de la hiérarchisation des luttes, dans ce cadre, est manifeste. En effet, la défense du féminisme se fait au nom de certaines valeurs, mais la défense des « racisés » appelle des systèmes de valeurs qui peuvent être contradictoires avec les valeurs féministes. Pour être plus clair, que faire lorsque l’on défend des personnes racisées dont la communauté est structurellement patriarcale – ce que montre Crenshaw ? Les afroféministes ont vite fait de répondre : on sacrifie les femmes au nom de l’antiracisme. L’islam, majoritairement pratiqué par des « racisés », est-il structurellement misogyne, faisant de la femme la moitié d’un homme, infantilisant les femmes, les installant dans la minorité au sens de Kant[18]… ? Peu importe, l’important est de défendre les musulmans, quant aux femmes musulmanes, elles peuvent bien passer par pertes et profits. Où l’on voit comment on détruit totalement l’approche intersectionnelle, qui au contraire exigerait de mettre à jour les mécanismes de domination et de soumission des femmes musulmanes au sein de leur propre communauté ! En bref, pour nos intersectionnels en peau de lapin : périssent les femmes, pourvu que l’antiracisme soit sauf.
« La primauté politique et la saillance sociale de la race ont […] protégé le monopole de représentation des leaders du mouvement de libération noir là où elles avaient permis de contester efficacement le privilège représentatif des femmes blanches de la classe moyenne dans le mouvement féministe. Les revendications des femmes noires du Black Power Movement ont été accusées d’affaiblir la lutte collective des Africains-Américains, trouvant un écho chez les militantes elles-mêmes dont l’adhésion au mouvement féministe pouvait être vécue comme une trahison de leurs appartenances familiales. »[19] Les militantes noires ont été prises dans un conflit de valeur et même un conflit d’appartenance, et c’est la question raciale qui l’a emporté. Être féministe, c’était, et c’est toujours dans les milieux dits intersectionnels, soutenir l’oppression raciste et capitaliste des blancs. C’est la thèse de l’historienne Françoise Vergès – qui elle-même réfute l’intersectionnalité, accusée de « découper race, sexualité et classe en catégories mutuellement exclusives »[20], au profit d’une approche « multidimensionnelle » – dans son ouvrage Pour un féminisme décolonial. Comment défendre les patriarcats « racisés », y compris les plus manifestes et oppressifs[21] ? La première idée est que seules les femmes racisées appartenant à une communauté peuvent juger de ce qui est relève ou nom du sexisme à l’intérieur de leur communauté. Cela rejoint la rhétorique des « non-concernés » que nous analysions dans un précédent article. L’argument ici est subtil : une femme musulmane peut se prononcer sur le patriarcat français d’une part, et d’autre part, elle seule peut dire si l’islam, ou les pratiques de sa communauté, relèvent de l’oppression. En revanche, une femme « non racisée » n’a aucune légitimité pour juger du caractère oppressif de l’islam. Autrement dit, il faut être membre d’une communauté de racisés pour juger du sexisme de ladite communauté. Cela signifie qu’on ne peut déterminer ni de l’extérieur ni de l’intérieur s’il existe un patriarcat des communautés « racisées ». Alors que l’on peut déterminer sans problème de l’intérieur comme de l’extérieur qu’il existe un patriarcat blanc archi-oppressif. En fin de compte : les femmes « racisées » n’ont qu’à se débrouiller toutes seules avec leur patriarcat. C’est bien ce que vante la politiste Syliane Larcher : « [l’afroféminisme] établit une relation polémique explicite avec la géographie d’un féminisme prétendument universaliste et abstrait, défini selon des frontières nationales, voire nationalistes, aveugles »[22]. Ce qui se joue là est une régression théorique, puisqu’il s’agit de nier l’existence de structures inconscientes de domination au sein des groupes racisés. Si c’est aux personnes racisées de déterminer quelles oppressions elles subissent à l’intérieur de leur communauté, c’est l’idée même de domination socialement construite qui disparaît.
Du bon usage de l’intersectionnalité
Le fait est que la déconstruction de l’universalité s’est faite dans les termes de l’hégémonie libérale : faire exploser toutes les valeurs communes, dissoudre les critères de jugement collectifs, pour que seuls prévalent les valeurs communautaires puis les critères individuels. Pire, elle réinvestit la rhétorique libérale de la liberté absolue et a priori en niant, à l’intérieur groupes « racisés », l’existence de structures inconscientes de domination – alors que c’était l’un des acquis sur lequel se fondait l’intersectionnalité. Mais comment défendre l’antiracisme si ce n’est au nom d’une conception de l’Homme et d’une certaine idée de l’égalité et de la justice ? Tout l’enjeu est pour nous de reformuler des valeurs en dehors du cadre anomique du libéralisme – pas forcément pour réinstaurer un universalisme normatif abstrait. Paradoxalement, l’intersectionnalité donne des pistes pour aller en ce sens. Si tous les individus sont pris dans un complexe réseau de dominations et de subordinations subies ou infligées, si chacun est finalement le point nodal d’un jeu de normes et de pouvoirs, il ne peut exister deux expériences similaires de la domination. Pour le dire autrement, l’intersectionnalité, en posant que l’expérience de l’oppression est une sorte de synthèse singulière, oblige à dépasser les catégories sociales pour recréer du commun. Et ce qui transcende les catégories sociales de genre, de race, de sexualité, de classe, c’est précisément ce qu’on pourrait appeler, à la suite du mouvement convivialiste, l’idée d’une « commune humanité »[23]. On reconstruit de l’universel, mais en partant des subjectivités diffractées, éclatées, prises dans le social – au sens où l’on est pris dans des sables mouvants. C’est recréer de l’universel non pas en partant du ciel des idées humanistes, mais « au ras du social ». Le concept d’intersectionnalité permet en ce sens d’articuler le singulier et l’universel, les individus et la société. Il permet de construire une subjectivité dans et par le social, qui se construit avec et parfois contre lui. En mettant les rapports de domination au centre, certes il oriente l’analyse et ne prend pas en compte tous les aspects du processus à l’œuvre – processus « par lequel les êtres humains « s’individuent », c’est-à-dire deviennent des individus dans et par le collectif, qu’ils contribuent à informer en retour »[24], que je nomme, après Bernard Stiegler, « transindividuation » – mais en même temps, il affirme que le sujet est d’emblée et irrémédiablement situé dans un champ social conflictuel, c’est-à-dire que l’individuation est nécessairement un processus politique.
Dans Ce que le marché fait au monde, j’écrivais que les querelles actuelles autour du féminisme et de l’antiracisme, querelles dans lesquelles le concept d’intersectionnalité prend une place prépondérante, doivent impérativement « conduire à bâtir à nouveaux frais un véritable féminisme ainsi qu’un véritable antiracisme »[25] et ce, ajouterais-je, dans une perspective socialiste. L’intersectionnalité peut nous y aider. On l’a vu, ce concept peut permettre de penser la subjectivité humaine comme produit jamais figé d’un rapport politique, comme un processus en perpétuelle dynamique. Il articule ce sujet politique, nécessairement situé dans le champ de force social, à une vision dudit champ de force social. « L’analyse intersectionnelle opère à deux niveaux. Au niveau microsocial, par sa considération des catégories sociales imbriquées et des sources multiples de pouvoir et de privilège, elle permet de cerner les effets des structures d’inégalités sur les vies individuelles et les manières dont ces croisements produisent des configurations uniques. Au niveau macrosocial, elle interroge les manières dont les systèmes de pouvoir sont impliqués dans la production, l’organisation et le maintien des inégalités »[26]. On voit bien alors la portée subversive de l’intersectionnalité à l’égard du système libéral – subversion pourtant en grande partie annulée par les récupérations critiquées plus haut, tout à fait compatibles avec la logique libérale, sous couvert de la dénoncer[27]. Ce concept permet d’intégrer les différentes luttes sociales dans le cadre de la lutte anti-libérale, et permet surtout de comprendre que ces luttes sont en grande partie irréductibles les unes aux autres, et qu’il ne suffira pas de nous débarrasser du capitalisme pour que les dominations raciales, sexuelles, etc. soient abolies comme par magie. « Les oppressions qui se trouvent mises en jeu dans ces luttes valent pour elles-mêmes, sans pouvoir être intégralement réduites, comme produits dérivés, à une oppression matricielle qui serait celle du capitalisme. [Mais], si elle n’est pas matricielle, la domination capitaliste n’en occupe pas moins la place supérieure dans la hiérarchie structurale des dominations […]. De tous les rapports de domination dont la société contemporaine est traversée, le rapport capitaliste est celui qui est en position de se maintenir quand tous les autres seraient attaqués, voire réduits. »[28] En interrogeant les pratiques inconscientes de domination qui existent à l’intérieur même des mouvements d’émancipation, l’intersectionnalité oblige à constamment se poser la question des sujétions potentielles que l’émancipation que l’on promeut serait susceptibles de créer ou de reconduire. En clair, elle empêche de s’endormir sur ses lauriers, ou d’évacuer les luttes antiracistes, féministes, LGBT+ et autres en pensant que la sortie du capitalisme règlera tous les problèmes. Réciproquement, la lutte antilibérale, dans la mesure où elle s’en prend au système hégémonique aujourd’hui, permet de complexifier l’intersectionnalité en l’ouvrant, précisément, à la question de l’hégémonie.
Le concept d’intersectionnalité souffre malheureusement de récupérations militantes qui en affaiblissent singulièrement la portée subversive et critique. Malgré cela, on ne peut le rejeter sans autre forme de procès. Si l’objectif du combat politique est d’améliorer la vie des gens ordinaires, on ne peut qu’être animé par un idéal de justice – idéal nécessairement universel. L’intersectionnalité permet alors de prendre conscience que l’expérience de la domination est un processus complexe, multidimensionnel et parfois paradoxal. Elle est en cela un outil d’émancipation. Si les dominations sont complexes, entremêlées, si les oppressions se pénètrent et se renforcent les unes les autres, alors les luttes doivent elles aussi être complexes, articulées, foisonnantes. Voilà à quoi nous ouvre l’intersectionnalité.
[1] Crenshaw, Kimberle « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, » University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8. C’est moi qui traduis les extraits de cet article.
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] Chauvin, Sébastien, et Alexandre Jaunait. « L’intersectionnalité contre l’intersection », Raisons politiques, vol. 58, no. 2, 2015, pp. 55-74.
[5] Idem.
[6] Je vous renvoie, pour creuser cette piste fondamentale, à mon propre ouvrage, Ce que le marché fait au monde, L’Harmattan, 2020 ; ainsi qu’aux travaux très importants d’Alain Caillé, dont l’Anthropologie du don, La découverte, 1998.
[7] Mercier, Geoffrey, Ce que le marché fait au monde, L’Harmattan, 2020.
[8] Crenshaw, Kimberle, art. cité.
[9] Méfions-nous de la métaphore topographique de l’intersection. Il s’agit bien plutôt d’un mélange au sens chromatique : le vert n’est ni du bleu, ni du jaune.
[10] C’est en tous cas la lecture des subaltern studies, et ce n’est évidemment pas la mienne. Car même en évacuant la composante psychologique du racisme et en admettant qu’il soit un processus de domination (alors qu’il est aussi, selon moi, une expression personnelle de haine), il est étonnant que ces études s’acharnent à nier le « racisme anti-blanc » alors que dans une communauté majoritairement noire par exemple (un quartier, un lycée, un club de sport etc.), les noirs étant dominants, ce sont les blancs qui sont « racisés ». Cela, les études en question refusent de l’admettre et le rejettent avec la dernière violence. Que des théories qui empruntent tant à Michel Foucault demeurent obstinément imperméables à sa théorie du « micro-pouvoir » ne peut que laisser perplexe…
[11] Crenshaw, Kimberle, art. cité. C’est moi qui souligne.
[12] Idem.
[13] Chauvin, Sébastien, et Alexandre Jaunait art. cité.
[14] Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil, 1997, p. 134, cité par Stéphane Beaud, Gérard Noiriel, « Pour une éthique de la discussion – Réponse à Didier Fassin », AOC média, 2021.
[15] Lesbien, Gay, Bi, Trans. L’appellation s’est aujourd’hui enrichie d’une kyrielle d’autres qualificatifs : transgender, queer, questioning, intersex, asexual, allies, pansexuels, others, de sorte qu’il faudrait parler de LGBTTQQIAAPO pour être un minimum exhaustif. Bien sûr, je m’épargnerai ce ridicule.
[16] Bien sûr, l’universalisme renferme de nombreux présupposés, des biais, et sur de nombreux points, recycle la pensée libérale et son vieux fond judéo-chrétien en la faisant passer pour universelle.
[17] Après avoir lu de nombreux articles académiques sur l’intersectionnalité, de même que de nombreux textes militants, je n’en ai trouvé aucune mention, même superficielle.
[18] Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?
[19] Chauvin, Sébastien, et Alexandre Jaunait art. cité.
[20] Debauche, Alice. « VERGÈS Françoise, 2019, Pour un féminisme décolonial, Paris, La Fabrique, 208 p. », Population, vol. vol. 75, no. 2-3, 2020, pp. 445-447.
[21] Il va de soi qu’il vaut mieux être une femme sous des cieux patriarcaux français en 2021 que sous ceux du patriarcat musulman, où que l’on soit sur la planète.
[22] Larcher, Silyane. « « Nos vies sont politiques ! » L’afroféminisme en France ou la riposte des petites-filles de l’Empire », Participations, vol. 19, no. 3, 2017, pp. 97-127.
[23] Manifeste convivialiste, Le Bord de l’eau, 2013.
[24] Mercier, Geoffrey, op. cité.
[25] Idem.
[26] Bilge, Sirma. « Théorisations féministes de l’intersectionnalité », Diogène, vol. 225, no. 1, 2009, pp. 70-88
[27] Alors que, pourtant, les militants ne cessent d’intégrer une virulente critique du capitalisme à leurs luttes antiracistes, féministes ou queer. Françoise Vergès : « Le féminisme décolonial interroge le système capitaliste dans son ensemble » ; Angela Davis : « Les féministes les plus vivantes et les plus vibrantes aujourd’hui sont celles qui luttent contre le racisme, le capitalisme et l’homophobie, et qui sont internationalistes ou de tendance marxiste. » (Le Dem, Gildas. « L’intersectionnalité, enquête sur une notion qui dérange. Les usages d’un concept fécond accusé d’être abscons », Revue du Crieur, vol. 7, no. 2, 2017, pp. 66-81.) Mais c’est un anticapitalisme rhétorique, creux, de façade. Car il ne suffit pas de dénoncer le sexisme ou l’oppression des blancs pour détruire le libéralisme. Ces militants nagent en pleine confusion : ce n’est pas parce que le libéralisme est né dans des sociétés blanches et patriarcales qu’il est lui-même patriarcal et blanc…
[28] Frédéric Lordon, « Pour favoriser une entente des luttes », Le Monde Diplomatique, mars 2021.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



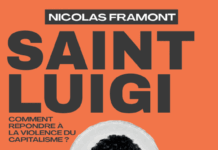




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)
![[Bibliosphère] La terreur féministe – Irene](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/10/Terreur-feministe-La-218x150.jpg)



