
Les besoins artificiels
Comment sortir du consumérisme
Razmig Keucheyan
La découverte, 2023 [2019]
Le monde est en voie de destruction, l’effondrement – ou la « crise écologique » comme on dit pudiquement – est déjà en cours bien qu’il n’en soit qu’à ses prémices. Qu’est-ce donc qui détruit le monde ? On le sait bien : l’impact de l’Homme sur son environnement, massif et dévastateur. De quelque manière qu’on retourne le problème on aboutit toujours au même constat : le capitalisme implique une prédation illimitée sur l’environnement, les sources d’énergie, la biodiversité, les ressources minérales, les métaux… Tout cela pour faire fonctionner la machine à profits – donc à inégalités – en alimentant le moteur de la production de marchandises, elle-même destinée à mettre action la consommation sans borne. Le problème, in fine, et toujours éminemment matériel. Production et consommation, censées satisfaire des besoins. Ainsi, comme le dit si justement Razmig Keucheyan, « toute critique de la marchandise commence donc par une critique du besoin qu’elle prétend assouvir » (p.57). C’est cette critique des besoins que tente de mener Les besoins artificiels.
Docteur en sociologie, professeur de sociologie à l’université Paris-Cité, Razmig Keucheyan propose dans Les besoins artificiels une réflexion critique, teintée de marxisme, du consumérisme capitaliste. Le fait nouveau du consumérisme depuis quelques décennies est la production de marchandises adossées à la production de besoins. En effet, nul ne consomme par pure envie de dilapider son argent. Il s’agit, la plupart du temps, de parvenir à une certaine satisfaction matérielle, déjà très largement assouvie par la production la plus basique. On pourrait se contenter d’un confort généralisé – dans les pays riches – d’un niveau déjà tout à fait inédit dans l’histoire de l’humanité. Mais voilà personne d’achèterait alors le dernier iPhone ni le dernier plaid chauffant, ni une touilleuse électrique à café, ni aucune des innombrables conneries plastiques qui inondent les grandes surfaces. Le capitalisme, y compris dans sa version financiarisée, doit nous faire consommer sans arrêt, tout et n’importe quoi. Il a, pour cela, eu besoin que la société s’organise autour de la marchandise et d’elle seule, c’est cela la société de consommation. « La consommation devenant un but en soi, structurant la vie sociale, déterminer à quels besoins elle répond (ou non) se pose de façon pressante à la pensée critique et aux mouvements contestataires. » (p. 33-34) Keucheyan a parfaitement raison, la question des besoins fabriqués par le capitalisme et son imaginaire est déterminante – qui a besoin de frigos connectés, besoin de cigarettes électriques jetables, de bombes de bain avec bijoux cachés à l’intérieur, d’un micro karaoké bluetooth avec veilleuse intégrée, d’un jeu de morpion en verre avec des shooters à la place des pions… ? Cette question soulève en creux une autre, tout aussi terrifiante, celle de savoir ce que le capitalisme fait de nous, quel degré d’inhumanité il nous a infligé pour qu’un tapis de souris lumineux nous apparaisse comme un bien indispensable.
Mais dès qu’on s’interroge sur les besoins, on est obligé de trouver des critères permettant de « distinguer les besoins légitimes qui pourront être satisfaits dans la démocratique écologique future, des besoins égoïstes et insoutenables, qu’il faudra renoncer à assouvir » (p.28). Toute une partie du livre est consacrée à ce sujet. Le sociologue mobiliste deux courants marxistes à la rescousse, l’un représenté par Gramsci et Nicos Poultantzas l’autre par Gorz et Agnès Heller, à l’origine de la « théorie critique des besoins » (p.33). Les besoins artificiels s’interroge sur ce qui distingue des besoins primaires, « biologiques », mais aussi plus largement des besoins que Gorz appelle « besoins qualitatifs » (p.50) ou Agnès Heller des « besoins radicaux » (p.50) que sont par exemple la culture, l’éducation, l’amour, la citoyenneté, la sexualité… et des besoins inauthentiques, « factices, qui ensevelissent les premiers » (p.51). Il existe une étrange dialectique, montre Keucheyan, entre ces différents besoins, authentiques et inauthentiques. « Pour que des besoins qualitatifs émergent, un surplus économique doit être engendré » (p.50) dit-il, ce qui signifie qu’un certain degré de développement de l’économie capitaliste a permis l’apparition de besoins a première vue « superflus » mais qui font, pour reprendre la formule de Bernard Stiegler, que « la vie vaut la peine d’être vécue », comme la culture ou l’éducation. Le capitalisme a indéniablement enrichi certaines catégories de population[1] qui ont pu accéder à des loisirs, des marchandises inaccessibles avant etc. donc à des besoins radicaux au sens d’Heller. Néanmoins, à « mesure que ces besoins montent en puissance, le capitalisme empêche leur pleine réalisation » (p.51). C’est alors que surgit l’aliénation : le capitalisme nous fait miroiter l’assouvissement de besoins radicaux tout en nous en empêchant. Ainsi, les besoins radicaux « sont rendus possibles par le capitalisme mais ne sont pas satisfaits par lui » (p.53)[2]. On voit dès lors quelle portée critique ils peuvent avoir. Ils sont radicaux en ce sens qu’ils attaquent à la racine le capitalisme, à savoir la production elle-même. Comme le dit en effet très justement Razmig Keucheyan, « dans la mesure où l’objet consommé est d’abord produit, c’est en dernière instance la production […] qui détermine les besoins » (p.43).
La production est première par rapport à la consommation, c’est un point crucial de l’analyse critique, et c’est précisément ce point qui est aujourd’hui si difficile à penser tant la société de consommation est devenue une grille de lecture omniprésente et envahissante. La production produit des objets, des marchandises, des biens matériels qui, pour être consommés, doivent satisfaire un besoin. Le besoin apparaît alors comme l’intermédiaire entre production et consommation, la pierre angulaire. « Si toute marchandise a une valeur d’usage et que tout usage répond à un besoin, c’est que le besoin est le fondement de la marchandise. » (p.57) Mais quand il y a décorrélation entre les deux, quand il y a trop de marchandises, cet excès engendre la nécessité de produire des besoins… qui deviennent alors eux-mêmes des marchandises[3]. Dès lors, « la marchandise cesse d’être uniquement une entité séparée de la personne. L’individu lui-même, son corps, sa subjectivité, sa sociabilité, se transforment en marchandises » (p.70). Voilà comment le capitalisme agit sur nous, comment, comme on l’a dit plus haut, il nous transforme en zombies qui foncent vers le premier pistolet décapsuleur en plastique ou le premier lot de porte-couverts en forme de bonnets de Noël comme des assoiffés devant une eau pure. Ainsi, les besoins radicaux, émancipateurs, ne pouvant être satisfaits, l’individu se contente de besoins frelatés, artificiels, assouvis par des « marchandises standardisées » (p.59). Il se produit alors « un appauvrissement des besoins et des manières de les satisfaire » (p.57), à rebours de toutes les promesses de confort et d’émancipation. Paradoxalement, la surabondance nous appauvrit. C’est pour cela que, pour être émancipatrice, « l’abondance suppose la sobriété » (p.62).
Accumuler du capital implique de produire des marchandises, donc des besoins qu’elles pourraient satisfaire. Cela nécessite alors de basculer, on l’a dit, dans le monde de la consommation, en transformant le producteur – salarié et exploité – en consommateur – libre et émancipé. Marx a cette formule saisissante, citée dans Les besoins artificiels : « la production crée donc le consommateur » (p.44). La figure du travailleur (ou de l’ouvrier comme on disait jadis, au temps de l’Association Internationale des Travailleurs[4]) est ainsi remplacée par celle du consommateur, qui doit se battre pour son pouvoir d’achat. Razmig Keucheyan raconte l’apparition des organisations de défense des consommateurs, la structuration du mouvement consumériste et ses rapports avec les pouvoirs. « Le consommateur, c’est l’acheteur en tant qu’il est protégé, en tant, plus précisément, que la protection devient un enjeu de lutte entre forces sociales : industriels, Etat, syndicat, mouvements sociaux… » (p.128) C’est dans ce contexte qu’apparaît la notion de garantie que Razmig Keucheyan analyse dans son ouvrage. La garantie protège le consommateur, grâce un lourd appareil juridique de normes et de droits. Mais elle devient également, peu à peu « une arme dans la concurrence entre producteurs » (p.129) en étant un argument de vente supplémentaire : il s’agit d’offrir une meilleure garantie que son voisin sur le bien que l’on vend. De la sorte, il se produit une marchandisation de la garantie – on tourne en rond. Le consommateur doit être protégé des fraudes, des malfaçons, mais aussi des fausses promesses et des publicités mensongères. Il doit être protégé des marchandises elles-mêmes (qui pourraient le mettre en danger) et des discours au sujet des marchandises. Il se situe au carrefour d’intérêts et de puissances contradictoires qui s’affrontent parfois, en particulier au sujet des normes censées garantir au consommateur une certaine sécurité et certaines exigences quant à la production des marchandises. Ainsi, s’opère un renversement : la production est pensée après la consommation et en regard d’elle uniquement. C’est le consommateur[5] qui, ose-t-on nous faire croire, oriente la production. Pourtant, comme le rappelle Razmig Keucheyan, l’une des premières associations de consommateurs américaines affirmait, déjà dans les années 1930, que « le consommateur est un travailleur » (p.172). Une leçon qu’il serait grand temps de reprendre à notre compte afin de « faire converger les consommateurs et les producteurs » (p.172).
Les besoins artificiels explore, outre la production de besoins frelatés au service des intérêts capitalistes, certains aspects de notre rapport aux marchandises modifié par notre devenir-consommateur. Si l’humain générique se définit par sa capacité à consommer, celle-ci devient alors partie intégrante de son identité[6]. Peut en résulter un certain nombre de pathologies nouvelles, à l’instar de l’« oniomanie » (p.85), cette addiction à la marchandise, ou plus exactement à l’acte d’achat. Des thérapies se sont multipliées afin de guérir ou du moins d’atténuer les symptômes et les conséquences individuelles de cette forme d’addiction : des médicaments aux groupes de paroles de « debtors anonymous » (p.91), ou débiteurs anonymes, en passant par des stratégies diverses pour limiter les possibilités d’achat… Ces pathologies du consumérisme, à titre personnel, font écho à la pathologie collective qui s’est emparé de nous, une addiction au « toujours plus » qui, littéralement, détruit le monde.
Razmig Keucheyan essaie, au fil des pages, de donner des pistes pour atténuer notre dépendance à la marchandise et nous reconnecter avec les besoins radicaux qui émancipent à titre personnel et collectif. Il insiste notamment sur la nécessité d’étendre les garanties obligatoires, qui forceront les producteurs à concevoir des biens de meilleure qualité, plus durables, et réduiront le flux de marchandises. Il plaide également, on l’a dit, pour une intégration de la production dans la consommation, et inversement. Ne plus séparer consommateurs et producteurs, mais comprendre que la production détermine tout, et que le consommateur est doublement aliéné : en tant que consommateur de biens standardisés répondant à des besoins artificiels et en tant que producteur exploité avec des conditions de travail dégradantes et abrutissantes. Il faut en arriver à la production de ce qu’il nomme des « biens émancipés » (p.155) qui ont quatre caractéristiques : robustes de leur production à leur utilisation, démontables pour une plus grande réparabilité, interopérables c’est-à-dire compatibles d’une marque à l’autre, et enfin évolutifs, c’est-à-dire qu’ils « intègre[nt] dans [leur] conception les évolutions technologiques futures » (p159). L’émancipation de la marchandise pourrait produire une émancipation des individus et aboutir à un « communisme du luxe » (p.160) qui lui-même redéfinit la notion même de luxe. Enfin, pour définir les besoins authentiques que les biens émancipés devront satisfaire, pour évaluer le « luxe » nouveau auquel on devrait avoir légitimement accès, Les besoins artificiels en appelle à la délibération commune. « Distinguer entre des besoins authentiques et superflus est crucial dans le contexte de la transition écologique. La seule façon de maintenir cette distinction sans la rabattre sur une détermination abusive est de considérer qu’elle doit être le fuit d’une délibération collective permanente. » (p.204) Keucheyan de conclure : « il faut socialiser le consumérisme et ainsi le combattre » (p.220).
Les besoins artificiels est un essai dense, riche, et qui pose clairement la question cruciale des besoins, par lesquels le capitalisme assied sa domination – matérielle et symbolique – sur nous. Beaucoup d’éléments d’analyse sont posés, ainsi que des pistes pour retrouver le chemin de besoins authentiques. Bien sûr, il n’existe aucune réponse simple à des problèmes aussi complexes, néanmoins, Razmig Keucheyan nous livre ici une réflexion éclairante sur tous ces enjeux. Un essai très intéressant et sans doute nécessaire, bonne lecture !
[1] Dont il faut toujours dire qu’elles sont très limitées dans le temps et l’espace- grosso modo les classes moyennes occidentales de la seconde moitié du XXème siècle – et que leur enrichissement s’est fait grâce à l’exploitation intensifiée du « Tiers monde » ainsi que grâce à la destruction de la planète.
[2] C’est la dynamique que je décrivais dans MERCIER Geoffrey, Ce que le marché fait au monde, L’Harmattan, 2020, en empruntant le concept de pharmakon a Bernard Stiegler : chaque « progrès » capitaliste a une face sombre plus terrible encore. Chaque « remède » est aussi un « poison » plus nocif que le mal qu’il combat – car précisément il est nié en tant que poison.
[3] La marchandisation des besoins porte un nom : la publicité.
[4] Car tel est le nom complet de ce qu’on appelle par raccourci l’Internationale. Le travailleur est la figure centrale du mouvement, avec toute la charge subversive dont elle est porteuse. En évacuant les travailleurs, les mouvements dits de gauche radicale ont évacué deux choses essentielles : le travail lui-même et les conditions de travail.
[5] Du moins toutes les instances qui parlent pour lui (associations, industriels, Etat, forces impersonnelles du marché etc.), car le consommateur n’a jamais la parole directement. Ainsi, l’idée selon laquelle la demande aurait un quelconque impact sur l’offre est, la plupart du temps, une grossièrement fiction.
[6] Terme que je n’aime pas, je lui préfère celui de singularité, cf MERCIER Geoffrey, Ce que le marché fait au monde, op. cit., chapitre neuvième.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



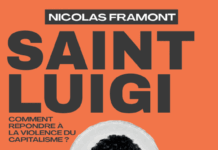




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)




