Vivre sans ?
Institutions, police, travail, argent…
Frédéric Lordon
La Fabrique éditions, 2019
Déconstruire des mythes, pulvériser les illusions rassurantes, déchiqueter les fables, tordre le cou aux erreurs auxquelles on a envie de croire… le faire avec d’autant plus de soin et de méticulosité que mythes, illusions, fables et erreurs sont portés par son propre camp voire ses amis. Les dessiller à toute force au risque de passer pour un ennemi. Telle est la lourde tâche de Frédéric Lordon (économiste et philosophe incontournable issu de la gauche radicale) dans son dernier ouvrage, Vivre sans ? A quoi s’attaque-t-il avec tant d’application ? Au mythe, qui donne son livre au livre, du « vivre sans ». De très nombreux discours, en particulier à gauche, invitent à fracasser les institutions pour nous en libérer et nous enjoignent à « vivre sans », sans institutions, sans police, sans travail, sans argent…. Détruire l’Etat et toutes ses émanations institutionnelles, pour que les hommes vivent hors de toute attache instituée. Voilà le mythe. Et voici la réponse de Frédéric Lordon.

On pourrait, donc, se passer d’institutions, leur tourner le dos, leur faire et la nique et s’en détacher pour de bon. Le Comité Invisible, Giorgio Agamben, Alain Badiou, Gilles Deleuze et Félix Guattari, parmi tant et tant d’autres, affirment que la vie dans les institutions est nécessairement une vie mutilée, une vie dégradée, une vie soumise, « une demi-vie, une vie maudite » pour paraphraser le centaure Firenze dans Harry Potter. Ce que Lordon résume, lapidaire : « les institutions, c’est l’enfer »(p.15). Solution logique : pour recouvrer la pleine possession de sa vie, se défaire des institutions, faire voler le carcan étatique en éclat. S’en aller vivre dans les forêts, se réfugier dans des cabanes, s’enfuir de l’enfer institué et instituant. La ZAD comme idéal. Simple – simpliste. Or, tout le livre se propose de démonter pièce par pièce ces discours anti-institutionnels qui pullulent à gauche – alors que Lordon est lui-même une figure éminente de la gauche française.
Pour ce faire, il commence par accorder qu’effectivement, « les institutions, c’est l’enfer », et pour des raisons qui ne sont pas que conjoncturelles. Intrinsèquement, ontologiquement les institutions ont un potentiel infernal qu’il s’agit de cerner. Elles sont écrasantes, formatent les individus, grèvent leur liberté, les assaillent ou les assimilent, puis les digèrent ou les excrètent… Mais la réflexion ne peut s’arrêter là, car toute la question est la suivante : peut-on se passer d’institutions ? Frédéric Lordon répond clairement : non. Et tout d’abord : qu’est-ce qu’une institution ? Voilà la question centrale de tout le livre. « J’appelle génériquement « institution » tout effet, toute manifestation de la puissance de la multitude »(p.105). Définition claire mais profonde, dont Vivre sans ? est pour ainsi dire le dépliage méthodique et appliqué.
Formuler une telle définition suppose, de la part de Frédéric Lordon, un long mais nécessaire détour par la métaphysique spinoziste de la puissance. Depuis des années, l’économiste a entrepris une lecture de l’œuvre du philosophe néerlandais afin d’y puiser les matériaux conceptuels les plus raffinés et les plus solides afin de forger avec des armes politiques et philosophiques du dernier tranchant. Proclamer qu’il faudrait mettre à bas les institutions repose sur une métaphysique inavouée que Lordon combat rigoureusement. Une métaphysique qui méconnaît radicalement que tout collectif génère endogènement de l’institution du seul fait qu’il est un collectif. « L’institution, ou l’institutionnel, est le mode d’être même du collectif »(p.107). Autrement dit, il n’existe aucun collectif sans institution, entendez, sans norme, sans autorité. Détruire la norme, l’autorité, l’institution, c’est donc détruire par le même mouvement le collectif. Tout être manifeste sa puissance, toute sa puissance, sans réserve, et conformément à son essence – ce qui fait qu’il est ceci et non cela. Ainsi, la multitude (les êtres humains assemblés) parce qu’elle est, manifeste sa puissance d’être : « le collectif se manifeste nécessairement comme institution et comme autorité »(p.128). En conséquence, l’institution est l’effet de la multitude ; comme la dissipation de l’énergie électrique sous forme de chaleur est l’effet de la loi de Joule. On n’y peut rien, quelque application qu’on mette à le nier. Ce que l’on peut en revanche, est c’est immense : faire varier à l’infini les formes institutionnelles. Car s’il est nécessaire qu’il y ait des institutions (de l’Etat, de la police, des normes, des us et coutumes…) rien n’oblige à ce qu’elles soient comme ceci plutôt que comme cela – si ce n’est la configuration passionnelle ponctuelle des hommes qui leur ont donné le jour.
L’œuvre de Spinoza constitue une architecture philosophique d’une extrême puissance. Son immanence radicale la prémunit, comme elle prémunit le lecteur appliqué qu’est Lordon, du fantasme d’expliquer le social et la société par des forces supérieures et occultes. La puissance normative du social vient du social, donc des hommes donc, au bout du bout, de la puissance des affects – en particulier des affects communs. Car la grande originalité, et en même temps ce qui garantit sa robustesse, de la démonstration de Frédéric Lordon vient de ce qu’il l’adosse en dernière instance aux affects humains – aux désirs, aux pulsions, aux passions. La « puissance de la multitude » est avant tout une affaire « d’affects communs ». L’architecture conceptuelle permise par le recours à Spinoza se retrouve dès lors au plus près de l’homme tel qu’il est, et non, comme c’est trop souvent le cas, tel qu’on voudrait qu’il fût. Il faut composer avec l’homme concret, désirant, désireux, passionné, pulsionnel, affecté et affectant. A mille lieux des utopies de gauche et de l’utopie libérale – qui sur ce point se rejoignent.
Mais Spinoza n’est pas le seul auteur avec qui Lordon entre en dialogue. Il y a, on l’a dit, tous les auteurs qui promeuvent, plus ou moins clairement, le « vivre sans ». Lordon montre d’une manière très convaincante qu’ils s’inscrivent dans un mouvement large de refoulement du politique, ce qu’il nomme « l’antipolitique »(p.51). « L’antipolitique, c’est d’enfermer toute la politique dans les singularités. Le régulier n’intéresse personne. »(p.51) Autrement dit, Lordon s’oppose à ceux qui considèrent que la politique authentique est affaire de rareté, d’évènements exceptionnels, de conduites exemplaires ou encore d’hommes sublimes et habités intégralement – des « virtuoses ». A ce compte-là, la politique est tellement extraordinaire qu’on se demanderait presque si elle existe véritablement. Or, nous dit Lordon, il faut tenir bon et au contraire « repolitiser » le monde. Car l’imaginaire du « vivre sans » propose justement de liquider la politique au profit de la fuite, de la pure singularité, des expérimentations locales qui se retirent du monde et ne s’en préoccupent pas.
Au-delà des considérations théoriques les plus rigoureuses, Vivre sans ? dessine des perspectives stratégiques immédiates. Sans jamais délégitimer les expériences concrètes auxquelles le « vivre sans » donne lieu (les ZAD, les cabanes, les micro-communautés etc.), Lordon montre néanmoins qu’elles ne peuvent suffire à changer la société et à mettre à bas le capitalisme, fût-ce par leur agrégation. L’économiste-philosophe resitue la lutte à son juste niveau : la « gigantomachie »(p.199). C’est-à-dire l’affrontement « macroscopique » au capitalisme : se réfugier dans une cabane ne suffira pas, il faudra terrasser la bête capitaliste en lui opposant une force au moins aussi colossale qu’elle – force qu’on ne peut puiser que dans la force des forces : la puissance de la multitude. Où l’on retrouve toutes les considérations théoriques initiales. Le capitalisme, et en particulier le néo-libéralisme, est en effet parvenu à un point d’hégémonie tel qu’il n’a plus besoin d’aucun compromis pour régner sans partage sur le monde. Il n’a plus à s’embarrasser de ménager des espaces de vie décente, il est devenu tellement puissant qu’il peut écraser tout réfractaire purement et simplement : estropier, éborgner, mutiler, fracasser, édenter, écraser, gazer, énucléer, démembrer, arracher, puis finalement tuer, voilà ce dont est capable l’hégémonie capitaliste achevée. La cruauté nue, la bestialité affichée, la « dérive psychiatrique du capital »(p.185) (dont la figure de Macron, insensible aux morts et aux mutilés que sa politique autoritaire génère, est l’emblème paroxystique) est telle que l’affrontement devra être général.
Frédéric Lordon alterne entre l’analyse pointue des points doctrinaux chez Spinoza, Agamben, Rancière ou encore Deleuze et le portrait impressionniste du Grand Soir à venir – du moins selon ses vœux – entrecoupés de saillies ironiques mordantes ou de points de vue historiques. Le tout fait de Vivre sans ? une sorte de compendium de la philosophie lordonienne fort utile. Car il faut dire que Frédéric Lordon est sans doute l’un des philosophes les plus puissants d’aujourd’hui dans la sphère antilibérale. Ses positions politiques concrètes – discutables au demeurant – ne doivent pas occulter les apports théoriques cruciaux de sa pensée, apports confirmés par ce livre.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)


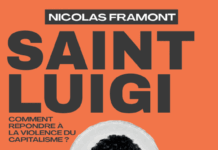





![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)





Comme d’habitude, une analyse pertinente qui permet de penser un peu plus loin que le bout de son nez (aussi grand soit-il 😉
J’aime particulièrement ce: « tout collectif génère endogènement de l’institution du seul fait qu’il est un collectif. »
Alors n’hésitez pas à lire le livre ! C’est un plaisir d’intelligence, nous ne serez pas déçu !