Le temps du paysage
Aux origines de la révolution esthétique
Jacques Rancière
La Fabrique éditions, 2020
Représenter un paysage ne va pas de soi. Le trouver beau non plus. Plus fondamentalement, la désignation d’un paysage comme tel ne va pas de soi. Travailler les produits de la nature de sorte à ce qu’ils s’agencent en paysage n’a rien d’évident. Art, beauté, peinture, art des jardins, nature, paysage : voilà les grandes idées que travaille le philosophe Jacques Rancière dans Le temps du paysage. Cet opus s’inscrit dans le projet de Rancière de décrire et analyser une révolution – contemporaine de la Révolution française et des bouleversements esthétiques du XVIIIème au XIXème – politique et artistique qui touche au plus profond “les formes mêmes de l’expérience sensible”(p.10). Ici, il s’agira, d’une certaine manière, de déplier dans toutes ses dimensions une idée d’Emmanuel Kant issue de la Critique de la faculté de juger : selon lui, l’art du jardin ferait partie des Beaux-Arts et serait comme le frère de la peinture.
Au XVIIIème, les arts bouillonnent et sont en pleine effervescence. L’esthétique fait son apparition avec Baugmarten, des théoriciens et praticiens des arts bousculent les grandes catégories classiques. Il est un domaine qui acquiert ses lettres de noblesse : l’art des jardins – l’art, selon les mots de Kant, d’arranger les produits de la nature. On représente des paysages : on les peint où on les arrange. Mais le temps du paysage dont il est question dans ce livre est plus large, il correspond au temps où, plus qu’un objet de représentation, le paysage “s’est imposé comme un objet de pensée spécifique”(p.9). On a donc bien affaire à un authentique livre de philosophie plus que d’histoire des arts. En fait, le temps où l’on pense le paysage en même temps qu’on le représente – en peinture ou dans le jardin – ne peut qu’être un bouleversement global de notre rapport au monde.
Cette histoire se déroule essentiellement en Angleterre et en Allemagne ; les jardins à la française, avec leurs arrangements géométriques, symétriques et parfaitement ordonnés, étant très éloignés de ces nouvelles façons d’appréhender l’art des jardins et la nature. Voilà qui constitue, d’ailleurs, l’un des attraits du Temps du paysage : celui, justement, du dépaysement. L’on rencontre des figures pour la plupart assez méconnues : Uvedale Price, Richard Payne Knight, William Gilpin ; le tout en arpentant les landes anglaises ou en contemplant les lochs écossais. C’est que le jardin “à l’anglaise” valorise la ligne courbe, l’absence d’angle droit, la smoothness…
L’art des jardins, donc, est hissé au rang prestigieux des Beaux-Arts, au même titre que la peinture. Mais pas dans n’importe quelles conditions. Pour devenir un art, le jardin doit “se mettre à l’école des scènes que la nature compose elle-même”(p.40) et devenir, le mot est d’importance, “pittoresque”. Il y a donc, à ce qu’il semble, la volonté d’imiter la nature, à la manière des grands anciens qui considéraient que la perfection d’une représentation tenait dans la plus grande proximité avec son modèle. Or, Jacques Rancière le montre bien, la révolution du paysage consiste, entre autres, à redéfinir complètement la notion d’imitation de même que celle de nature. La nature ne constitue pas un ensemble “extra-humain” pur de toute empreinte laissée par l’action de l’homme. Elle est, disons, un processus à même de ressaisir n’importe quoi pour en faire son produit propre. La nature est parée d’une forme de beauté supérieure, à laquelle les autres sont désormais subordonnées – ce qui est là encore une idée qui ne va pas de soi. A quoi cette beauté tient-elle ? A “l’accident et la négligence”(p.46). Rancière s’explique : “la nature se reconnaît à ceci qu’elle ne sélectionne pas, elle ne distingue pas, elle laisse coexister toutes sortes d’objets, toutes variétés de formes, de couleurs, de lumière et d’ombre.”(p.46) La gageure, pour l’art des jardins, sera de créer, en toute intentionnalité, des agencements qui n’auront pas l’air d’avoir été voulus en tant que tels. Cela dit, la beauté naturelle n’est pas le règne du désordre ni du disparate : grâce à l’accident et à la négligence dont elle fait preuve “les éléments de la nature se trouvent liés entre eux sous notre regard”(p.48) : il existe une unité de toute cette diversité.
L’enjeu est de saisir cette unité. Ainsi, “il s’agit moins de définir les critères d’une perfection artistique que les critères d’une éducation esthétique”(p.63). La portée de ce que Rancière nomme le temps du paysage est donc énorme. La nature se diffracte, mais elle est véritablement une ; elle est donc toujours plus vaste que ce que l’on peut en voir. Sa vastitude est infinie pour ainsi dire – or, une telle infinitude ne peut jamais être représentée. La peinture est donc imparfaite en comparaison de son modèle, la nature. En ce sens, la notion de copie est donc à entrevoir sous un jour nouveau : le but n’est pas de copier fidèlement chaque détail microscopique, mais de donner à sentir l’unité infinie de la nature, sa puissance toujours excédentaire. “Cette impuissance [de la peinture] suscite elle-même a puissance qui la compense. Celle-ci se nomme imagination.”(p.66) De la sorte, la mimesis s’est renversée : il s’agit d’élargir le regard du spectateur – qui devient actif via l’imagination – vers une totalité intotalisable.
“Unité dans la variété. Tel est le critère classique de la beauté auquel l’art des jardins est sans cesse rappelé.”(p.71) La variété suppose un constant mouvement de va-et-vient entre le détail singulier et l’ensemble unifié, entre le particulier et le général. Une dialectique que l’on saura retrouver lorsque les implications politiques seront abordées. Au-delà des considérations théoriques, Rancière décrit l’effet que produit la beauté de la nature sur nous ; il mobilise pour cela les concepts classiques de beauté et sublime, mais aussi ceux, propres au temps du paysage, de grandeur et de pittoresque. La palette du sentir s’est élargie. Comment représenter cette beauté, cette grandeur ? En suggérant, en montrant sans montrer, en laissant deviner, en confrontant l’homme à des paysages qui le saisissent, en représentant les tromperies de la nature, les effets d’eau, en brouillant les distances et les mesures, en mettant en relief les rugosités et les discontinuités… Toute cette grammaire picturale, on la retrouve dans les œuvres étudiées par Rancière, peintures ou jardins.
Mais Le temps du paysage prend une toute autre tournure lorsque Rancière s’attelle à la seconde révolution en lien avec cet esprit nouveau : la Révolution française. En effet, toutes ces expérimentations artistiques prennent place dans un monde perturbé : la France est sur le point de faire sa Révolution. Les nouveaux jardins sont comme les décors de fond des bouleversements politiques à l’oeuvre. Ce que remarque néanmoins Rancière, c’est que la façon d’organiser le jardin consonne étroitement avec le régime politique : les anglais libéraux ont des jardins eux-aussi empreints de libéralité, les français monarchistes divins n’aiment rien moins tant que les jardins ordonnés, droits, “géométrique et sans ombre”(p.97). “Un paysage, résume Rancière, est le reflet politique d’un ordre social et politique. Un ordre social et politique peut se décrire comme un paysage.”(p.95) Mais cela va plus loin que ça, le jardin n’est pas qu’une métaphore politique, le paysage n’est pas qu’une illustration de la société. D’une part, le paysage témoigne de l’organisation concrète et imaginaire d’un territoire. D’autre part, la façon dont on pense la peinture ou l’art des jardins influe sur la manière d’organiser la cité.
La Révolution française n’est pas la seule force politique qui trouble le XVIIIème siècle. En Angleterre cette fois, les enclosures produisent leurs méfaits sur la société. Ce vaste mouvement de privatisation des terrains communaux, auparavant mis à la disposition des plus désoeuvrés pour leur subsistance, où ils pratiquaient le glanage, récoltaient quelques denrées où qu’ils arpentaient lors de leurs déplacements, ces terrains auparavant collectifs sont petit à petit attribués aux propriétaires terriens, ils deviennent privés – c’est-à-dire qu’ils privent les petites gens, non propriétaires, de moyens de subsistances et détruisent l’idée même de bien commun. C’est là l’un des événements les plus importants de la genèse du libéralisme brutal – pléonasme – qui détruit les solidarités et fait de la propriété un bien supérieur à la vie. Or, enclore les champs, valoriser la discontinuité des propriétés, voilà qui s’oppose radicalement au pittoresque du paysage tel qu’il était défini et rêvé par les tenants de l’art des jardins. Il ne s’agit plus d’unir le disparate, mais de séparer, de diviser. “Les maîtres mots d’une société harmonieuse sont les mêmes qui définissent l’idéal des jardins pittoresques: l’intricacy et la connectivity.”(p105-06) Ainsi, il faut refuser “l’uniformité des espaces dégagés” mais aussi la “raideur des clôtures” qui défont l’unité dans la diversité.
Mais 40 ans plus tard, et Le temps du paysage s’achève là-dessus, un autre géant de la philosophie va détruire tout cet héritage résolument tourné vers la nature. Hegel va dénier radicalement toute beauté à la nature, il va délégitimer l’art des jardins au profit de la supériorité de l’activité humaine, de l’intentionnalité du concept et de la raison. Mais ce faisant, le vers introduit par le temps du paysage restera dans le fruit de l’art occidental, désormais, la frontière entre “l’art et le non-art« (p.112) restera brouillée à jamais. Nous y sommes encore.
Un petit livre passionnant en plus d’être un bel objet. Une très grande clarté d’exposition, un plaisir de découvrir des œuvres et un moment de l’histoire de l’art et de la philosophie peu connu. Bonne lecture !
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



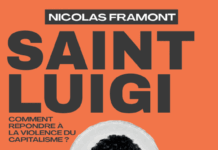




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)




