Notre ennemi, le capital
Notes sur la fin des jours tranquilles
Jean-Claude Michéa
Editions Climats, 2017

Le dernier essai de Jean-Claude Michéa, l’un des penseurs les plus consistants de la critique libérale à l’heure actuelle. Ce professeur agrégé de philosophie né en 1950, professeur de lycée à Montpellier, trace son sillon, livre après livre, tranquillement, loin de l’agitation médiatique et des mondanités éditoriales et des « indignés professionnels ». Notre ennemi le capital, approfondi ce sillon, qui est avant tout socialiste. Bien sûr, un socialisme à des années-lumière de celui dont un parti portait naguère le nom avant de sombrer pathétiquement tel un rafiot vermoulu dans un marécage fangeux et plein de crapauds replets. Le travail de Michéa consiste en grande partie à retrouver le sens originaire de ce mot, forgé par Pierre Leroux au XIXème siècle. Pour cela, il faut revenir aux sources du socialisme et de la critique du libéralisme, donner à nouveau la parole aux grands ancêtres de cette tradition aujourd’hui en décrépitude totale, ou plutôt, en débandade.
Le socialisme n’est pas de gauche
L’ambition de redonner un sens au socialisme passe par une critique sans concession, voire violente, de la gauche. Il faut arracher le socialisme des griffes de la gauche. Pour ce faire, à nouveau, se plonger dans l’histoire. Michéa montre que l’association du socialisme à la gauche ne va pas de soi, et qu’originellement, et ce pendant des dizaines d’années, ces concepts politiques divergent largement. D’ailleurs, Marx et les socialistes du XIXème siècle ne se disent jamais « de gauche ». Cette union se fera avec l’affaire Dreyfus, et signera l’arrêt de mort du socialisme : il est tombé dans un piège et ne s’en est jamais remis. Car ce dernier est avant tout une critique radiale du libéralisme, ce que n’est pas la gauche. En se laissant absorber par elle, il ne pouvait qu’abdiquer la critique du libéralisme. Voilà pourquoi aujourd’hui, gauche et droite ne sont que des variations libérales. Le grand apport de Michéa est de montrer que même l’extrême gauche actuelle (celle de Besancenot par exemple) s’inscrit dans le nuancier libéral en défendant l’internationalisme, ou plutôt l’« antinationalisme », la dissolution des structures traditionnelles, le mépris du peuple enraciné et ce qu’il appelle le « libéralisme culturel », non moins nécessaire au déploiement du libéralisme que son versant purement économique. Cela explique pourquoi la gauche se concentre sur des politiques purement sociétales (Michéa moque avec beaucoup d’humour et d’ironie cette gauche qui se vit rebelle et subversive en voulant dépénaliser le cannabis et imposer l’écriture inclusive. N’est pas rebelle qui veut…) qui s’inscrivent elles-aussi dans le projet libéral. Le libéralisme avance donc bel et bien sur une jambe droite (l’économie) et une jambe gauche (la société).
Michéa mobilise avec brio et pédagogie l’histoire du mouvement ouvrier et du socialisme de sa naissance au XIXème à aujourd’hui.
Renouer avec la critique du libéralisme
La critique radicale du libéralisme est nécessaire. Indispensable même. Son besoin ne s’est jamais fait sentir avec autant d’urgence. Les périls sont nombreux et imminents, et il n’est plus possible de se les cacher ou de refuser de les voir. Or, le paradoxe est que malgré cela, « il est plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme ». Il faut prendre cette phrase au sérieux, l’analyser et essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. C’est, entre autre, l’un des axes de Notre ennemi, le capital. Jean-Claude Michéa est sans doute le philosophe français qui analyse le plus en profondeur la pensée libérale et ses infinies déclinaisons à droite et à gauche. Le libéralisme est un « fait social total » nous dit-il en reprenant le concept de Marcel Mauss. C’est-à-dire, pour le dire autrement, qu’il est omniprésent, omnipotent, qu’il façonne la société comme il nous façonne, qu’il est comme l’air que nous respirons : il sait se faire oublier alors qu’il est partout. En économie, les choses sont claires. Mais Michéa va jusqu’à le dénicher chez nombre de ceux qui se présentent eux-mêmes comme antilibéraux ou anticapitalistes. S’inscrivant dans la continuité de ses précédents ouvrages, Notre ennemi, le capital dégage la cohérence du libéralisme, il en montre la logique interne. C’est un travail de mosaïste, car il faut, à partir d’éclats, de fragments disparates, reconstituer la fresque et la donner à voir.
Logique du libéralisme
La logique du libéralisme est visible dans l’idée de « Progrès », notamment héritée des Lumières : un cours de l’histoire inéluctable et nécessairement ascendant. Les choses ne peuvent qu’aller en s’arrangeant, ou comme le dit Michéa : « tout pas en avant est un pas dans la bonne direction ». Dès lors, il faut avancer, sans cesse, avancer. C’est le mot d’ordre macronien par excellence : En Marche ! Tout regard vers le passé est donc suspect, toute interrogation sur le bien-fondé de cet impératif à aller de l’avant, toute critique de cette marche inexorable est le signe d’une nostalgie intolérable, d’un passéisme à combattre. « Réactionnaire », voilà l’insulte. Criminalisation du « c’était mieux avant ». Or, Michéa cite cette phrase de David Harvey : « Le capitalisme n’est rien s’il ne bouge pas ». Un certain conservatisme est nécessaire, ne serait-ce que sur les question d’écologie : il s’agit de préserver la planète, de la conserver.
La logique libérale entend promouvoir le profit maximal, la rentabilité la plus optimale, l’accroissement du capital encore et encore, l’enrichissement des plus riches. Pour cela, il doit se débarrasser de tout ce qui pourrait faire obstacle à son avancée irrésistible. A commencer par la politique et les structures traditionnelles qui échappent à la logique marchande et comptable. La morale (au sens non religieux du terme) est reléguée à l’espace privé, elle ne doit pas intervenir dans les affaires politiques et économiques. Le libéralisme se construit donc par la destruction des valeurs préétablies, des critères de jugement moraux, des structures collectives pour ne laisser la place qu’à des purs individus autistes et sans liens, et donc ne peut qu’avancer en anéantissant toute possibilité de faire de la politique. Car la politique suppose de choisir selon les critères du bon et du mauvais pour la société et pour les citoyens, et non le simple critère de l’efficacité – autre grand phantasme macronien. Michéa écrit : « En conduisant à subordonner toute production de biens ou de services à l’exigence prioritaire du « retour sur investissement » (quand bien même la plupart des marchandises ainsi produites se révéleraient tout à fait inutiles, voire toxiques ou nuisible pour le climat et la santé humaine) elle encourage simultanément le rêve positiviste d’un monde « axiologiquement neutre » – dont l’ultime impératif catégorique serait business is business – contribuant ainsi à noyer progressivement les vertus humaines les plus précieuses (celles qui fondent, par exemple, la civilité quotidienne et les pratiques de réciprocité et d’entraide) dans « les eaux glacées du calcul égoïste » (Marx). »(p.20-21) Cette neutralité axiologique affichée (le libéralisme se présente comme dépourvu de valeurs à défendre, de morale commune etc.) masque le fait qu’il impose sournoisement ses propres valeurs : égoïsme, recherche du profit, atomisation du monde (mot cher à Michéa), individualisme forcené, consumérisme etc.
Car le libéralisme propose une vision anthropologique de l’homme fondée sur la compétition, l’intérêt, la domination. Or, pour Michéa, il existe aussi une anthropologie du don, de l’entraide (mise au point notamment par Marcel Mauss). Pour risquer un jugement personnel, il me semble que les deux ne sont pas incompatibles, au contraire, et qu’on ne peut penser l’homme sans ces deux aspects : intérêt et entraide. Darwin nous serait d’une aide précieuse pour penser cela. L’erreur, ou plutôt la supercherie du libéralisme, est faire de la compétition la réalité universelle de l’homme à l’exclusion de tout le reste.
« Socialisme d’en bas »
Pour Michéa, il faut partir de la vie des « gens ordinaires ». Ceux, justement, que la gauche a appris à détester, à conspuer, à rejeter, à insulter, à traiter de « facho », de « sous-éduqués », de « Bidochons »… Or c’est pour eux que Michéa se bat. Partir donc de la base, partir de ceux « d’en bas ». Non pas, comme les politiques, « écouter » ce qu’ils ont à dire pour les amadouer et ensuite mépriser leurs aspirations en leur faisant comprendre qu’ils sont dans « le repli » et qu’ils ne comprennent rien au monde. Michéa, dans Notre ennemi, le capital, comme depuis son premier livre, s’inscrit dans le sillage d’Orwell. Il consacre de magnifiques développements au concept de « common decency » crée par Orwell. Michéa parle de la « décence commune des gens ordinaires », ces gens qu’il fréquente dans son petit village du sud de la France, ces gens dont il est, lui le prof de lycée. Orwell qui compte énormément dans la pensée de Michéa. S’il emprunte à Marx ses analyses et ses critiques prophétiques du libéralisme, c’est vers Orwell qu’il se tourne pour penser le rapport du peuple aux élites et élaborer son « socialisme d’en bas ». On sent l’affection que Jean-Claude Michéa porte aux petites gens, à leur vie simple et décente. Ces gens qui ont pour toute ambition de « vivre et travailler au pays », parmi les leurs, sans vouloir à tout prix écraser les autres, s’enrichir jusqu’à perdre le sens des réalités. Or, cette aspiration est assimilée à du repli, du nationalisme. Parler à ces gens, et essayer de répondre à leurs désirs simples, c’est « faire le jeu du Front National » et être populiste. Michéa réhabilite précisément ce socialisme populiste car populaire.
La forme
Pour finir, je dirai un mot de la forme de ce livre, qui peut dérouter. Michéa part d’un entretien accordé au site Le Comptoir. Il développe les 4 questions qui lui étaient adressées, puis, par un jeu de notes, de scolies, de renvois, il construit un livre dont le développement brise la construction linéaire habituelle. On pourrait parler de philosophie buissonnière. L’avantage est de pouvoir développer plus longuement tel ou tel point abordé incidemment sans avoir à rompre le fil de la discussion. Cependant, cette construction complexe reste très fluide à la lecture. Le style de Michéa est d’ailleurs lui aussi buissonnant, avec des parenthèses, des tirets, des citations, des incises. Cela peut donner le tournis au début, mais passées les premières pages, on se rend compte de la richesse d’une telle méthode. Cela permet à Michéa d’aller vraiment au fond des arguments.
Livre passionnant d’un philosophe non moins passionnant. Ce courant philosophique et politique n’a pas de visibilité médiatique, et on comprend pourquoi : sa force de subversion et sa puissance de frappe. Notre ennemi, le capital reprend un certain nombre d’idées et de thèmes développés par Michéa dans le reste de son œuvre, ce qui en fait un livre précieux. Bonne lecture !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



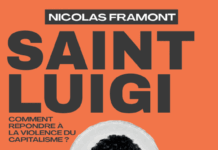




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)




