Le Chef-d’oeuvre inconnu
Honoré de Balzac
1831-1837
Ce cycle Balzac : les romans courts s’ouvre donc avec sans doute le plus connu d’entre eux : Le Chef-d’œuvre inconnu. L’oeuvre idéale pour mettre un pied dans le monde de Balzac !
Publié une première fois en deux parties dans la revue l’Artiste en 1831 (moyennant une rémunération de 1 000 francs, ce qui achève alors de convaincre l’artiste – mais homme avant tout – de répondre favorablement à la commande), ce court roman d’une petite quarantaine de pages est ensuite retravaillé et enrichi par son auteur et republié en 1837. En 1845, il intègre l’œuvre proprement monumentale de Balzac La Comédie Humaine au tome XIV parmi les Etudes Philosophiques. Balzac a 32 ans en 1831, sa réputation va grandissante, son génie s’exprime déjà. Voilà rapidement pour le contexte de ce roman. Maintenant, passons aux choses sérieuses !
Une affaire de style.
Les choses sérieuses, c’est avant tout le style. Pas de grand roman sans un grand style. Comment caractériser l’écriture de Balzac ? Voici une question à laquelle je serais bien en peine de répondre… Car comme toutes les grandes choses, elle est en partie indicible. Quelques mots cependant. Il y a bien sûr chez lui un naturalisme indéniable, et pourtant, le sous-titre initial du Chef-d’œuvre inconnu était : « conte fantastique ». Et il y a une part de fantastique dans l’écriture même de Balzac : cette propension à étirer le temps, le suspendre, pour arracher à son cours un détail insignifiant, évanescent, et le faire enfler dans le récit, cette capacité à s’appesantir sur ce qui nous semble de l’ordre de l’accessoire, de l’inessentiel, de l’accidentel, et à rentrer dans l’intimité de monde et à la restituer ; et en même temps, une façon presque surnaturelle de nous donner à voir les choses, comme si Balzac était une sorte de miroir déformant du monde, amplifiant çà et là tel élément ou atténuant tel autre par un jeu d’étranges perspectives mouvantes. L’écriture de Balzac est faite de tourbillons. Ainsi, loin d’être ce méticuleux descripteur, ce laborieux tâcheron qui aurait pour les détails une obsession quasi maladive, Honoré de Balzac est bien plutôt un écrivain qui nous raconte les choses du dedans. Il y a dans le style balzacien quelque chose de ce que pouvait dire le philosophe français Henry Bergson à propos de la durée. Ou, ce qui revient au même, des sentiments : « Le sentiment lui-même est un être qui vit, qui se développe, qui change par conséquent sans cesse ; sinon, on ne comprendrait pas qu’il nous acheminât peu à peu à une résolution : notre résolution serait immédiatement prise. Mais il vit parce que la durée où il se développe est une durée dont les moments se pénètrent » (Essai sur les données immédiates de la conscience).
Le paradoxe est qu’en apparence, le romancier ait besoin de suspendre la durée pour en décrire les chatoiements infinis, comme si le temps ne pouvait être saisi que sur le mode de l’instantané – au sens photographique. Il semble qu’il faille abolir le cours du temps pour le comprendre un tant soit peu ; ce serait la fonction de la description chez Balzac : suspendre le temps du récit. Mais le paradoxe peut être vite levé lorsqu’on remarque que le roman, comme toute oeuvre, déploie deux temporalités, ou plutôt, il déploie une temporalité dans une autre : celle du roman dans celle du lecteur. La première est pour ainsi dire « empruntée » à la seconde. Dès lors, lorsqu’on suspend le cours temporel du roman, celui du lecteur n’est point modifié. Cette éclipse du temps qu’est la description balzacienne est donc bien plutôt une « mise en scène du temps ». « Un vitrage ouvert dans la voûte éclairait l’atelier de maître Porbus. Concentré sur une toile accrochée au chevalet, et qui n’était encore touchée que de trois ou quatre traits blancs, le jour n’atteignait pas jusqu’aux noires profondeurs des angles de cette vaste pièce ; mais quelques reflets égarés allumaient dans cette ombre rousse une paillette argentée au ventre d’une cuirasse de reître suspendue à la muraille, rayaient d’un brusque sillon de lumière la corniche sculptée et cirée d’un antique dressoir chargé de vaisselles curieuses, ou piquaient de points éclatants la trame grenue de quelques vieux rideaux de brocart d’or, aux grands plis cassés, jetés là comme modèles. Des écorchés de plâtre, des fragments et des torses de déesses antiques, amoureusement polis par les baisers des siècles, jonchaient les tablettes et les consoles. »
Voyez comme Balzac ne décrit pas un atelier, il décrit la lumière qui s’y développe : tantôt elle est une caresse, tantôt une griffure. Une telle virtuosité est magnifique et bouleversante. Le style ici est au service de l’œuvre, car Balzac nous montre l’impalpable : la lumière et ses effets ; la lumière est ce qui donne corps aux choses sur lesquelles elle s’accroche. Or, c’est exactement le propos de maître Frenhofer, l’un des personnages du roman – « la distribution du jour donne seule l’apparence au corps ! » Ainsi, plus que jamais le style s’unit au fond du discours donnant raison à Victor Hugo disant que « L’idée, c’est le style ; le style, c’est l’idée » (L’utilité du Beau). Ou, comment matière et manière ne font qu’un. Le style de Balzac est donc l’union merveilleuse du naturalisme et de l’impressionnisme : c’est l’impression que nous avons des choses qui nous permettent d’en saisir l’essence même. Il n’y a pas de monde hors des apparences.
De là vient, chez Balzac, cette égalité entre l’apparence physique et sa psychologie des personnages. Tenue vestimentaire, faciès et attitude corporelle en disent plus long sur quelqu’un que la plus fouillée des introspections. C’est la raison pour laquelle Balzac, dans ses œuvres, a un tel souci de la description physique et s’attarde tant sur les dehors des personnages : la physionomie résume l’être. Ainsi de Maître Frenhofer : « Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de Socrate ; une bouche rieuse et ridée, un menton court, fièrement relevé, garni d’une barbe grise taillée en pointe ; des yeux verts de mer, ternis en apparence par l’âge, mais qui, par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle, devaient parfois jeter des regards magnétiques au fort de la colère ou de l’enthousiasme. Le visage était d’ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de l’âge, et plus encore par ces pensées qui creusent également l’âme et le corps. […] Mettez cette tête sur un corps fluet et débile, entourez-la d’une dentelle étincelante de blancheur et travaillée comme une truelle à poisson, jetez sur le pourpoint noir du vieillard une lourde chaîne d’or, et vous aurez une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible de l’escalier prêtait encore une couleur fantastique. »
L’histoire. « Attention spoiler ! »
En parlant de maître Frenhofer, je m’aperçois que je ne vous ai pas encore présenté l’histoire du roman. Brièvement : nous sommes au XVII ème siècle, en 1612 plus précisément, le roman s’ouvre sur le jeune Nicolas Poussin, l’un des plus grands peintres de l’époque, se rendant chez son maître, François Porbus, autre artiste bien connu pour avoir peint le roi Henry IV de pied en cap. Devant la porte de l’atelier de son maître, Nicolas Poussin fait la rencontre silencieuse d’un vieillard d’étrange allure, qui lui aussi se rend chez Porbus. Il apprendra qu’il s’agit de « maître Frenhofer », personnage fictif, un prodige de la peinture, initié comme personne aux ultimes secrets de la couleur. S’en suivent des leçons magistrales du vieux maître sur son art et sur l’art en général. Devant le dernier tableau de François Porbus – Balzac a francisé le prénom : il s’agit de Frans Probus, dit Porbus le Jeune – Frenhofer déclare, péremptoire : « Ta bonne femme n’est pas mal troussée, mais elle ne vit pas ». La première leçon a ici lieu, et se termine par une démonstration au cours de laquelle le vieillard semble donner la vie à la Marie Égyptienne – œuvre fictive également – en quelques touches de couleur, ou plutôt, quelques touches de lumière.
A ce récit s’entremêle l’amour de Poussin et de Gillette, sa maîtresse, amour contrarié par la passion dévorante du jeune homme pour la peinture. Après maintes tractations, Gillette accepte de poser pour Frenhofer, en échange de quoi celui-ci accepte de dévoiler aux autres sa dernière œuvre, sur laquelle il travaille depuis dix ans, et ce au prix, sans doute, de sa santé mentale. Il est euphorique, exalté, presque possédé, devant son œuvre. Porbus et Poussin n’aperçoivent qu’une toile recouverte d’un amas informe de peinture, de grumeaux de couleurs disposés en une « muraille de peinture ». La dernière œuvre du vieux maître est un échec. Cet Icare de la peinture s’est brûlé les ailes en voulant atteindre la perfection. Le roman se termine sur un drame raconté de manière laconique : « Le lendemain, Porbus inquiet revint voir Frenhofer, et apprit qu’il était mort dans la nuit, après avoir brûlé ses toiles. »
Un roman sur l’art.
Il manque encore un personnage essentiel à ce résumé : l’Art. Car s’il raconte bel et bien une histoire qui se suffit à elle-même, Le Chef-d’œuvre inconnu nous parle avant tout de l’art, et de la vision que Balzac semble en avoir. Je dis « semble » car il est toujours difficile de savoir où est exactement l’auteur dans de telles conditions : chez Frenhofer ? Chez Porbus ? C’est un problème analogue aux dialogues socratique : le discours de Platon est-il toujours superposable à celui qu’il prête à Socrate ? Quoi qu’il en soit, ce roman esquisse une philosophie de l’art sur laquelle il faut nous arrêter.
Une formule résume toute cette philosophie. C’est une phrase de Frenhofer : « la mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer ». Sublime. Et surtout, cette formule ouvre une perspective nouvelle dans l’histoire de l’art car elle rend possible l’impressionnisme et tout ce qui suivra. Balzac se distingue radicalement de Platon pour qui l’art n’est jamais qu’une imitation, ce qu’il appelle « mimesis ». Pour Platon, l’artiste imite le monde sensible – c’est-à-dire le réel – qui est lui-même imitation de monde intelligible – le monde des Idées, plus réelles que le réel. L’art est donc pour Platon une dégradation au carré. Bien sûr, Balzac s’inscrit complètement en faux contre cette conception de l’art. Peut-être pourrait-on aller jusqu’à dire que chez Balzac, c’est le réel qui imite l’art. On comprendrait ainsi les comparaisons omniprésentes qu’il dresse entre tel fait, tel détail, et telle peinture, comme si la nature avait pris modèle sur l’oeuvre…
Exprimer la nature, c’est lui prêter vie dans un cadre nouveau, tout à la fois lui donner une voix à-travers l’artiste, et la laisser parler elle-même. Etre un révélateur, au sens photographique du terme, mais aussi un créateur, un poète. L’artiste doit réaliser la double tâche d’être à la fois proche de la nature, très proche d’elle, accolée à elle, mais jamais confondue, car il n’en serait qu’un copiste, il lui faut également contraindre la nature, la malmener, lui tordre le bras puis lui faire crier grâce, la dominer en un mot. Soumission et domination sont les deux mouvements contraires dont la synthèse se réalise dans l’artiste. Trop de soumission : l’artiste se dégrade en croque-mort, veillant des cadavres. Trop de domination : il se perd et perd son objet. Car la nature est toujours prise dans un mouvement incessant, « une branloire pérenne » comme dirait Montagne, rien n’est figé, tout se perd dans un entrelacs de causes et d’effets, toute durée est un changement radical d’instants fondus les uns dans les autres. « Une main ne tient pas seulement au corps, elle exprime et continue une pensée qu’il faut saisir et rendre. Ni le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l’effet de la cause qui sont invinciblement l’un dans l’autre ! » Si l’artiste ne doit pas se contenter d’un pur décalque des choses, c’est que tout est pris dans un réseau dont toutes les mailles sont solidaires, en continuité toujours. Ce réseau, cette trame du monde, est spatiale et temporelle.
La trame temporelle est celle des causes et des effets entremêlés, du passé se fondant dans l’avenir, le créateur doit donc dépasser le présent pour saisir le mouvement. En ce sens, Balzac préfigure Bergson et son intuition de la durée et du mouvement.
La trame spatiale maintenant, Balzac permet de l’appréhender à travers sa critique de la ligne en peinture : « Rigoureusement parlant, le dessin n’existe pas » dit Frenhofer. Les objets ne sont pas délimités par des lignes comme sur un dessin, lignes à l’intérieur desquelles viendrait s’insérer la couleur comme un cahier de coloriage. Le passage d’un objet à un autre se fait par une transition continue de l’être à l’être, il n’y a que du plein. La lumière permet de faire surgir les objets, et elle seule. Elle modèle le monde, le sculpte, lui donne sa matérialité. Cela rejoint ce que nous disions du style de Balzac qui lui aussi semble sculpter le réel sans lui donner de ligne précise, seulement un éclairage singulier.
L’échec de Frenhofer.
Je voudrais, avant de finir, dire un mot sur l’échec final de maître Frenhofer. Sa dernière toile, après dix ans de travail acharné, de lutte sans merci, se révèle un tas de peinture, une « croûte » pour parler sans détour. Et ce nonobstant un pied peint à la perfection surnageant dans ce magma de couleur : « un pied délicieux, un pied vivant ! » L’échec n’est donc pas total. Si on a beaucoup parlé de cet échec pour dire qu’il est dû à une trop grande intellectualisation de Frenhofer, une proximité entre l’artiste et l’oeuvre interdisant une nécessaire prise de distance, sa science immense qui au final l’éloigne des sensations etc, je voudrais soulever l’hypothèse que si Frenhofer échoue à peindre sa muse, dont il semble éperdument amoureux, c’est parce qu’il essayait non pas de la peindre elle, la femme de chair et d’os, mais qu’il essayait de peindre l’amour lui-même ! Ce qui est bien entendu impossible ! « Ma peinture n’est pas une peinture, c’est un sentiment, une passion ! » dit-il. Je laisse à votre sagacité cette hypothèse…



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



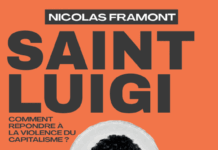




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)





[…] Le Chef-d’oeuvre inconnu […]