La guerre aux « non concernés »
Quand la lutte contre la discrimination devient folle : analyse et réflexions critiques
![]()
Dans les milieux antiracistes, LGBT, féministes, décoloniaux, indigénistes, transidentitaires, et autres victimes professionnelles, une nouvelle arme de destruction massive de toute forme de discussion – je n’ose même plus parler de « débat » – a fait son apparition : la notion de « non concernés ». L’argument est simple : seuls ceux qui sont concernés par une discrimination sont à même de la juger telle. Toute personne non concernée n’a aucune légitimité à en juger et n’a qu’à se taire et acquiescer. « Tu ne peux pas comprendre, ça ne te concerne pas ». Un homme n’a pas son mot à dire sur les discriminations faites aux femmes car il ne les vit pas et donc ne peut pas les comprendre ; un blanc ou plutôt un « non-racisé » ne pourra jamais tenir un jugement adéquat sur le racisme ; un « cis » (entendez : une personne de sexe masculin qui s’identifie comme un homme, ou une personne de sexe féminin qui s’identifie comme une femme c’est-à-dire quelqu’un qui fait coïncider pour elle-même son sexe et son genre) sera toujours incompétent pour parler de transphobie ; un hétéro est condamné à être à jamais inapte à comprendre ce que subit un homosexuel… Autrement dit : seule la victime – autoproclamée – peut dire quand elle est victime et de quoi elle est victime. Quant au « non concerné », il devra toujours se taire, et approuver (mais pas trop fort pour ne pas être accusé de parler à la place des « concernés ») dans tous les cas : rester à sa place de privilégié. Argument imparable pour délégitimer un contradicteur et rester bien au chaud entre soi, entre « concernés ».
Niveau philosophique : Se comprendre, comprendre les autres ?
Il y a ici deux présupposés : si l’on ne vit pas soi-même une situation, alors on ne peut la comprendre. Et réciproquement, celui qui vit une situation est le mieux à même d’en juger de façon adéquate. Nous verrons que ces deux propositions sont fausses ou du moins, grossières et que les choses sont plus complexes. Le deuxième postulat est qu’un « concerné » ne peut se tromper quant à ce qu’il croit subir ; si tel était le cas, il serait impossible de faire de son expérience personnelle la norme de la discrimination.
1- « Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition »[1]
On peut penser que l’expérience d’autrui nous sera à jamais étrangère. C’est une tautologie : autrui n’est pas moi. Tout être humain est enfermé dans le champ de ses expériences, perceptions et représentations, ou du moins limité par elles. Si on peut parfois s’en abstraire, ce n’est que partiellement (se « mettre à la place de » quelqu’un est, au bout du bout, impossible).
Cependant, l’expérience d’autrui fait écho à la mienne, et en ce sens, je peux en comprendre quelque chose. Je puis imaginer ce que ressent quelqu’un qui subit une injure ou se cogne le pied dans une porte puisque j’ai moi-même vécu des vexations et des coups de portes. C’est le fameux : « je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » du poète latin Térence dans l’Héautontimorouménos. Hugo, pour sa part, ouvrait son recueil sublime Les Contemplations en s’écriant « Ma vie est la nôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. […] Ah ! insensé, qui croit que je ne suis pas toi ! » L’humaine condition est une, et nous en partageons tous quelque chose. La souffrance d’autrui peut résonner en moi, son amour, sa haine… c’est d’ailleurs là le ressort de tout l’art. L’art n’est possible que parce que je peux entrer en sympathie (au sens étymologique) avec un personnage fictif. Nous pouvons nous identifier à tel héros de film, de roman, de théâtre parce que nous ressentons un peu de ce qu’il ressent. La force de l’art, et en particulier de la littérature, est qu’il permet d’entrer dans la peau de quelqu’un qui nous est – au moins en apparence – parfaitement étranger. Une magie opère : nous vibrons à la même fréquence que ce personnage, nous souffrons, nous rions des mêmes peines et des mêmes bonheurs – sont-ce les mêmes peines et bonheurs ? toute la question est là. Bref, nous comprenons que quelque chose transcende le genre, la couleur de peau etc. Ce que, précisément, dénient ces discours modernes[2].
2- Enfermé en soi-même
On peut sortir de soi, au moins dans une certaine mesure, certes. Mais ce que je comprends des sentiments d’autrui est toujours passé par le prisme de ce que je suis : je ne suis qu’un miroir déformant d’autrui. Ou plutôt, autrui n’est que le miroir déformant de moi-même. Dit autrement, l’altérité est toujours, en dernière instance, radicale. Elle résistera éternellement, d’aussi loin que l’on s’en approchera. Je peux toujours comprendre quelque chose de la souffrance d’autrui, ce que nous venons d’analyser en parlant de l’art par exemple, mais ce sera toujours une projection : je ne vivrai jamais la souffrance exactement telle que tu la vis, je ne souffrirai jamais ta souffrance. L’expérience vécue est toujours singulière, sans double possible[3].
Ainsi, parce que nous partageons la même condition, nous pouvons comprendre quelque chose de ce que ressent autrui. Cependant, comment savoir si nous ressentons la même chose ? Il n’existe aucune aune commune qui nous permettrait de comparer. Les émotions et expériences générales ont un fond commun, partageable, mais qui se diffracte en une infinité d’éclats subjectifs, qui, eux, demeurent à jamais impénétrables à autrui.
De ces considérations, il résulte que le « non concerné » ne peut effectivement pas comprendre la souffrance particulière et individuelle d’un « concerné », qui est bien réelle et en tous cas, pour parler comme Nietzsche, « irréfutable ». Notons au passage qu’en raison de cette impénétrabilité d’autrui, le « concerné » n’est pas plus habilité à s’exprimer sur la souffrance d’un autre « concerné ». Autrui ne m’est pas moins inaccessible dussé-je partager la même couleur de peau ou le même genre. On ne voit pas pourquoi tout d’un coup, l’expérience d’autrui me deviendrait transparente au motif qu’il est lui aussi « racisé » ou du même sexe. A moins de postuler une moindre altérité des noirs, des femmes, des homosexuels entre eux, ce qui reviendrait à nier une part de leur humanité.
3- Articuler le particulier et l’universel
En tant qu’homme, l’expérience de telle femme me sera à jamais étrangère, certes (et cela ne tient pas spécifiquement au fait qu’il s’agisse d’une femme) ; en revanche la souffrance, l’humiliation, le rejet sont des notions que je puis partager, des sentiments ou des expériences qui peuvent m’être familiers et qui créent une communauté possible avec tous les souffrants, les humiliés ou les rejetés du monde. Il faut donc distinguer d’une part le sentiment particulier de tel ou tel individu, qui est effectivement unique et hors de portée d’autrui et d’autre part l’expérience générale d’un sentiment, qui est, elle, tout-à-fait partageable, et en confère d’ailleurs la portée proprement politique. On pourrait d’ailleurs aller plus loin et montrer que ce que j’éprouve m’échappe en partie, ménageant au sein de l’individu comme une parcelle d’étrangeté, un hiatus irréductible, le « Je est un autre » de Rimbaud[4] ou encore l’inconscient de la psychanalyse. On entre ici dans un niveau de complexité supplémentaire que nous ne développerons pas, mais tout de même, si mes pensées, mes passions, mes désirs, mes perceptions m’échappent, il faudrait être fou pour faire de l’expérience personnelle une norme, fou de penser que je pourrais me connaître à fond. Parfois, autrui me connaît « mieux que moi-même ». Autrement dit, je ne suis jamais transparent à moi-même.
Il ne résulte, et c’est un point important, en aucune manière de tout cela que la souffrance d’autrui ne me concerne pas. Que je ne vive pas une discrimination n’empêche en rien que je puisse me sentir affecté par sa seule existence. C’est d’ailleurs la condition de tout engagement politique (au sens le plus large du terme). Où est la connexion entre le fait de ne pas vivre une situation et ne pas être concerné par elle ? Il y a un lien qui n’est pas du tout évident. Songeons un instant aux luttes pour le droit des animaux. Aucun militant de la cause animale n’a été abattu dans un abattoir insalubre, ni gavé pour son foie gras, ni chassé à courre, ni égorgé lors d’une fête religieuse, ni toréé à mort etc. Est-ce à dire qu’il n’a aucune légitimité à se sentir concerné par ces souffrances ?
Mais surtout, le sort des femmes dans la société dans laquelle je vis me concerne directement en tant qu’homme. Je côtoie des femmes au quotidien, je suis concerné par le fait que ma mère jouisse d’une plus grande liberté, car cela impacte sur mon éducation (par exemple). Comme personne blanche, si mon compagnon est noir, les violences qu’il subit m’impactent directement. A moins de supposer que la société ne se compose de « communautés » absolument étanches, indépendantes et n’ayant aucun rapport les unes avec les autres, les souffrances des uns peuvent aussi concerner les autres. Plus largement, l’émancipation des femmes est une condition sine qua non à toute démocratie digne de ce nom. En tant que citoyen soucieux de démocratie, je suis là aussi directement concerné. Croire que l’émancipation n’est qu’une affaire personnelle est une pure illusion, un raisonnement borgne et autiste. L’amélioration des conditions d’un certain nombre de groupes sociaux est aussi un moteur de l’émancipation générale. C’est le sens de cette phrase magnifique du socialiste Charles Fourrier : « Les progrès sociaux s’opèrent en raison des progrès des femmes vers la liberté et les décadences d’ordre social en raison du décroissement de la liberté des femmes. »[5] Autrement dit, je ne suis jamais libre tout seul ; je ne puis être pleinement émancipé dans une société aliénée.
Enfin, pour se convaincre, si besoin était, que l’on peut dépasser ce que l’on semble être – à quoi nous réduisent sans vergogne les militants de ces discours modernes – pour se hisser au niveau de l’intérêt général, il suffit de remarquer cette chose simple : l’IVG fut autorisée par un Parlement « presque exclusivement composé d’hommes » pour reprendre les mots de Simone Veil ; le crime de sodomie fut abolit en 1791 par des révolutionnaires qui, n’en doutons point, n’étaient pas pour la plupart, des « concernés » ; l’esclavage, abolit par des des hommes libres qui le considéraient comme l’abomination et la honte pour la dignité humaine qu’il constituait. Les exemples ne manquent pas. L’Histoire montre cet élan qu’à l’Homme pour se dépasser, s’oublier et se fondre dans le genre humain. Cette seule considération suffit à réduire les discours modernes et les militants qui les tiennent à ce qu’ils sont : un néant.
[1] Montaigne, Les essais, livre III.
[2] Je parle à dessein de féminisme ou d’antiracisme « modernes » pour les distinguer de leurs versions « old school » qui elles, sont éminemment défendables et nécessaires. Le féminisme du XXème siècle par exemple : universaliste, non revanchard, militant pour une résolution des antagonismes et non leur exacerbation… Féminisme de celles qui ont réellement obtenu la libération des femmes, qui ont pris des risques personnels ; à mille lieux donc des féminismes modernes grouillant dans leur petit confort bourgeois, et qui s’inventent à longueur de tweets des ennemis imaginaires pour exister. Celles-là ne prennent d’autres risques que d’être « bloquées » sur twitter ou de recevoir un GIF moqueur. Des amazones en peau de lapine, des Athéna pathétiques et haineuses… Il en va de même, bien évidemment, pour l’antiracisme moderne.
[3] C’est le propre du Réel lui-même. D’être sans double. L’expérience humaine n’échappe pas à cette règle. Quand bien même nous pourrions ressentir la même chose qu’autrui, en tant que reflet, notre sentiment ne serait pas exactement identique. Autrement dit, le double n’est jamais la chose.
[4] Dans la Lettre du voyant.
[5] Charles Fourier, Théorie des 4 mouvements, 1808. On voit là se dessiner deux visions opposées de la « lutte contre toutes les discriminations ». Entre celles qui s’inscrivent, malgré leurs prétentions, dans l’idéologie libérale et qui segmentent l’émancipation en marchés ; et une autre, critique du libéralisme, qui articule subtilement liberté individuelle et collective. Pour cette dernière, il s’agit de viser l’émancipation collective. Mais une société n’est pas émancipée si elle entretient en son sein la servitude ou l’aliénation de certains groupes. La différence majeure est bien la dimension collective.
Niveau politique : les « concernés » n’aiment pas le bien commun
1- Entrons en politique
Avant d’explorer le niveau politique, il faut montrer en quoi il s’applique au discours des « concernés ». Car après tout, on pourrait objecter qu’il n’y a rien de politique là-dedans, auquel cas ces critiques s’effondreraient. Les militants « concernés » se contenteraient de témoigner, à titre personnel, des insultes subies, ce qui serait tout-à-fait légitime, ils feraient part de leurs expériences malheureuses, pour trouver un peu de réconfort. Une sorte de « thérapie » par des groupes de parole, version « opprimés anonymes ». Dans le cadre du simple témoignage, de la parole qui se libère et qui libère, on pourrait d’ailleurs comprendre qu’il y ait besoin d’espaces privilégiés, de lieux réservés aux « concernés » – des espaces en « non mixité »[6]. Mais précisément, la démarche des militants est toute autre : non pas collectionner des exemples disparates, des faits isolés indépendants – leur objectif n’est pas de proposer une thérapie ; mais bien les inscrire dans un logique plus vaste, leur donner un sens politique et social. Autrement dit, montrer en quoi ces insultes, ces « discriminations », sont des symptômes de systèmes d’oppression généralisée : le « patriarcat », le « racisme systémique » etc. Les militants qui dénient aux « non concernés » le droit à la parole débordent largement le simple témoignage ou le récit personnel puisqu’ils entendent faire retour sur la société et là, le témoignage devient un fait politique. Ces militants se vivent en fait comme des résistants, des parias en lutte contre la société entière et l’Etat, seuls contre tous, rejouant devant leur ordinateur une version bouffonne et pathétique de l’apartheid – véritable régime abject, où la notion de racisme systémique était, hélas, une réalité.
2- Athènes, au secours !
En démocratie, prévaut l’idée que nous sommes tous concernés par les affaires de la cité et que donc nous sommes tous autant compétents – et incompétents – pour en juger[7]. De plus, ceux sur qui s’exerce le pouvoir doivent être en mesure de l’exercer afin de déterminer le destin collectif qui est aussi le leur. A Athènes s’articulaient deux conceptions de la démocratie : d’une part elle est l’affaire de tous, mais d’autre part, il demeure des situations dans lesquelles le fait d’être « concerné » pose problème. Tout l’enjeu est de trouver la juste mesure.
Les grecs antiques estimaient que, lorsqu’il fallait porter la guerre à une cité voisine, les habitants limitrophes ne devaient pas prendre part au vote, de peur que leur intérêt personnel n’interférât avec l’intérêt général. Etre « concerné » était considéré comme un facteur de confusion, et non comme un surcroît de lucidité. Il se peut qu’être concerné brouille la vue, embrume la réflexion et ne permette pas de produire un raisonnement valable. Cette hypothèse est d’ailleurs banale : on voit d’un mauvais œil qu’un juge examine le dossier d’un proche, un médecin préfèrera sans doute ne pas se soigner lui-même de peur d’être trop impliqué, on demande régulièrement à des tiers des avis sur notre situation car nous ne pouvons prendre du recul etc. Ainsi, l’idée selon laquelle un « concerné » serait mieux habilité à parler d’un problème le concernant ne va pas de soi, c’est même souvent le contraire. Cette simple considération devrait inviter à rejeter les discours en cause ici. Bien sûr, il ne s’agit pas d’inverser le raisonnement et de dire qu’un « non concerné » serait, lui, plus lucide. Ce serait encore plus absurde.
On voit bien qu’il y a une négation de la démocratie et de la politique dans une telle façon de procéder. Négation de la politique en détruisant la communauté, qui en est le fondement[8]. Négation de la démocratie puisque cette dernière part du principe qu’il existe quelque chose comme du « commun ». Rousseau parlait « d’intérêt général », mais l’idée est bien celle-là. Celle d’un « bien commun » à rechercher et à construire entre tous les membres de la communauté politique. En démocratie, le peuple est l’acteur du politique, il ne serait question de le scinder en deux. Parler de « non concernés » revient à exclure de fait toute une partie de la population. Chaque communauté de « concernés » se débrouille, mais ces communautés sont imperméables les unes aux autres – une définition possible du communautarisme. Comment dès lors parler de société ? Comment parler de communauté nationale ? C’est la possibilité de faire peuple qui disparaît, et la démocratie qui se déchire.
3- Une tyrannie des susceptibles ?
En acceptant qu’il suffise qu’un « concerné » se sente discriminé pour considérer ipso facto qu’il l’est, en faisant des « concernés » les seuls autorisés à juger des discriminations qu’ils disent subir, on tend à les encourager à voir une discrimination là où il n’y a qu’une insulte (qui n’est pas défendable, mais qui est différent) et pire, là où il n’y en a même pas. C’est, en quelque sorte, ouvrir une boîte de pandore : faire de la susceptibilité[9] personnelle la mesure de toute discrimination.
L’insulte est déjà problématique à définir. Suffit-il de se sentir insulté pour l‘être ? Tout un chacun peut se vivre comme une victime. Ce qu’on ressent est irréfutable en tant que tel. Exemple : une peur peut être bien réelle, mais ne suffit pas à prouver qu’un danger existe. L’on peut se sentir blessé, humilié, rabaissé par telle remarque ou tel comportement, on peut estimer que cela relève de la méchanceté, du racisme, de la misogynie… Chaque acte peut être interprété comme une offense. Mais ce ressenti est étroitement lié à la susceptibilité de chacun, à son histoire personnelle, à sa bienveillance, voire à son sens de l’humour et du second degré. Une remarque, même anodine, n’aura pas le même effet sur quelqu’un qui aurait subi des violences au cours de sa vie ; il y a – et on en fait l’expérience quotidiennement – une multitude de personnes qui prennent toute remarque pour une insulte ou un acte de guerre ; d’autres encore sont incapables de second degré ou d’ironie. Prenons le dernier exemple. Mon incapacité à saisir l’ironie fait-elle de l’ironiste un salaud ? Ma propre susceptibilité doit-elle être la mesure universelle de l’insulte ? Si je me sens insulté, est-ce pour autant la preuve qu’une insulte m’a été adressée ? Bien sûr que non. Heureusement que non. Comprenons-nous bien, quand je parle de susceptibilité, je ne dis pas que les remarques racistes, homophobes, misogynes etc. n’existent que dans la tête de ceux qui en sont victimes. Il existe, malheureusement, beaucoup trop de cas objectifs de discrimination. Seulement qu’il ne suffit pas de se sentir offensé pour avoir le droit de crier au racisme ou la discrimination. Autrement dit : insulter un « racisé » n’est pas forcément du racisme. Et même au-delà de l’insulte réelle, c’est la porte ouverte à toutes les interprétations victimaires les plus délirantes. Celui qui se sent agressé dès qu’on lui adresse la parole serait, dans cette logique, habilité à hurler à la discrimination, sans garde-fou possible !
4- Organiser la guerre de tous contre tous
Petit fait amusant – ou pas –, la notion de concernés détruit l’intersectionnalité[10], pourtant brandie par ses sectateurs. Pour un raison simple : personne ne peut être concerné en même temps par toutes les discriminations. On ne peut être à la fois noir, arabe, homosexuel, femme, transsexuel… sauf cas exceptionnel (ou pathologie mentale). Or, pour penser et articuler toutes les discriminations entre elles, il faudrait nécessairement en faire l’expérience soi-même, ce qui est rarissime. On ne peut donc en parler sous peine d’être taxé de s’approprier l’expérience des victimes. C’est, pour ces militants, se tirer une balle dans le pied. Car les sociologues ou les intellectuels qui essaient pourtant de le faire, qui étudient des discriminations qui ne les concernent pas, devraient illico presto être délégitimés et interdits de parole. Impossible dès lors d’essayer de comprendre ne serait-ce que le fait même de la discrimination. Cette contradiction fait apparaître en creux la véritable volonté de ces militants : non pas penser la discrimination en tant que telle, comme un phénomène global, certes diffracté ; mais ne s’intéresser qu’à leur petit cas personnel, au mépris de tous les autres. Ils ne souhaitent pas l’émancipation, simplement leur émancipation à eux[11]. C’est-à-dire, en réalité, imposer leur domination sur les autres. Et il ne peut en être autrement quand toute discrimination subie par autrui, qui ne me concerne donc pas, ne peut être objet de discours et de pensée. Le simple fait de penser qu’une discrimination que je ne vis pas ne me concerne pas est en soi problématique. On retombe dans une version de la guerre de tous contre tous, ou plutôt, communauté contre communauté, chacun ayant à défendre son pré carré sans espoir, précisément, d’intersectionnalité. C’est la mort des luttes visant à l’émancipation de la société.
Il s’agit en fait d’une tentative de renverser la domination – et surtout pas de l’abolir – : faire des opprimés d’hier les oppresseurs de demain. Si l’on se dote du concept de racisme systémique, c’est justement pour faire en sorte d’invisibiliser la domination que l’on instaure. Ces militants se comportent comme des tyrans, des petits caporaux hargneux mais peu importe, quoi qu’ils fassent, quel que soit le degré de violence de leurs paroles, cela est instantanément dissous dans le fait que de toutes façons, en tant que « racisés », ils ne peuvent être racistes eux-mêmes. C’est une construction intellectuelle très pratique pour justifier sa propre violence, sa propre haine[12].
5- Un essentialisme mortifère
Il faut voir que l’argument des « concernés » suppose une hétérogénéité totale entre les victimes et les autres, comme si elles étaient d’une espèce différente. Il y aurait le commun des mortels, et les victimes de telle ou telle discrimination : deux mondes disjoints. En fait, cette distinction entre « concernés » et « non concernés » va même plus loin, car elle sous-entend que le « non concerné » n’est pas simplement extérieur ou étranger à la discrimination qu’il ne subit pas, mais qu’il en est partie prenante : coupable ou complice. Elle postule que le « non concerné » est le bourreau, voilà pourquoi d’ailleurs il est intolérable qu’il parle à la place de sa victime. C’est tout l’enjeu du racisme systémique[13] brandi par les « antiracistes » modernes, qui affirme que le racisme est le fait de la société, de ses normes, de ses présupposés, de ses codes et de ses institutions, de l’Etat. Chacun est un agent inconscient du racisme, de sa propagation, à moins d’en être une victime. Il n’y a donc que deux catégories : les oppresseurs et les opprimés. L’étau se referme sur le « non concerné » qui non seulement ne peut rien comprendre du racisme mais en plus se retrouve malgré lui un salaud. La seule possibilité pour lui d’en réchapper : abdiquer. Abdiquer son sens critique et prendre chaque déclaration d’un « concerné » pour parole d’évangile. Il y a essentialisation des « concernés » et « non concernés » en victimes et bourreaux.
Cela est également réducteur et ravageur sur le plan individuel car cela essentialise l’expérience victimaire : les individus ne se définissent plus que comme victimes. La seule caractéristique de ces individus ? Etre discriminé. Se réduire soi-même à l’état de victime perpétuelle, et ne se définir qu’à travers cela. Une perspective existentielle d’une pauvreté terrible, mais aussi un couvoir de haine et de ressentiment…
[6] Au passage, on voit aussi l’erreur des groupes en « non mixité » interdits aux blancs. Là non plus, ils ne sont pas de simples espaces d’échanges et de psychothérapie de groupe. Les militants qui les défendent les comparent aux groupes de parole de femmes victimes d’abus, ou d’alcooliques anonymes, où effectivement, seuls les « concernés » sont admis. La comparaison est fallacieuse, car une réunion d’alcoolique anonyme n’est pas une réunion politique, ce que sont précisément les groupes en « non mixité ».
[7] C’est le fameux débat entre Platon et Aristote. Platon considérait que la politique relevait d’un savoir, d’une « expertise » dirait-on aujourd’hui. Au contraire, pour Aristote, elle relève de l’opinion, qu’il nomme « doxa ». La démocratie repose entièrement sur la conception aristotélicienne de la doxa, sans quoi elle s’effondre et laisse place à un « gouvernement d’experts » qui confisquent le pouvoir à leur seul profit. C’est bien la situation actuelle.
[8] Je vous renvoie à notre article Réflexions sur la démocratie.
[9] Par « susceptibilité » je désigne l’extension du domaine de l’insulte et de la discrimination. Non que la discrimination soit une pure invention – loin de là. Simplement, on reste dans le champ de la pure subjectivité, qui en cela dépend de la susceptibilité de chacun et ne peut à soi-seule fonder une politique. On tomberait sinon dans une forme de tyrannie, la tyrannie des susceptibles. Nous y sommes presque…
[10] « Méthodologie sociologique et féministe qui étudie les formes de domination et de discrimination non pas séparément, mais dans leur intersection, en partant du principe que le racisme, le sexisme, l’homophobie ou les rapports de domination sont liés » (Wiktionnaire) Ainsi, on parlera d’afro-féminisme pour montrer qu’il existe des discriminations spécifiques aux femmes noires. Il s’agit de lier les discriminations : sexisme et homophobie, sexiste et racisme etc.
[11] Il faudrait montrer que ces rhétoriques s’appuient sur ce qu’Alain Caillé nomme « l’axiomatique de l’intérêt », paradigme privilégié de l’anthropologie libérale selon lequel chaque individu n’est mû que par la recherche de son intérêt bien compris. En effet, elles entérinent l’idée selon laquelle l’intérêt personnel est le seul motif possible des luttes pour l’émancipation. Non seulement, pour elles, l’intérêt personnel est la seule motivation, mais il ne doit surtout pas en être autrement. Tout altruisme étant systématiquement rabattu sur un projet inavoué néocolonialiste, ou visant à priver les opprimés de parole, ou encore à s’approprier leurs revendications pour les faire taire.
[12] La prochaine étape, à n’en pas douter, sera une lutte sans merci, et peut-être à mort, entre ces mouvements eux-mêmes. Une fois que l’on a posé que la société était coupable, par les notions de racisme systémique, de patriarcat etc. on a créé une fracture entre dominants et dominés. C’était la première étape. Mais ensuite, entre les dominés, il faut reconstruire de telles hiérarchies : l’homosexuel non racisé (blanc) se retrouve petit à petit dans le camp des dominant par rapport à l’homosexuel racisé. C’est ce que nous vivons actuellement. La prochaine étape sera donc un déchirement de ces mouvements, une lutte « entre dominés » pour déterminer le plus opprimé, celui qui aura par conséquent le droit de haïr tous les autres. Il faudra recourir aux mêmes procédés, un degré d’obscénité et d’indécence en plus, puisque il faudra s’en prendre à d’autres victimes. Nous entrons de plain-pied dans cette logique.
[13] La nouveauté étant que pour les antiracistes modernes, le racisme ne peut qu’être systémique. Autrement dit, pour eux le mot « racisme » signifie nécessairement « racisme systémique », et l’on ne pourrait qualifier de racisme des actes isolés, des comportements, même nombreux, tant qu’ils ne sont pas le fait d’un système institutionnel, ou d’une société dans ses fondements. Cet amalgame a été créé afin de disqualifier la possibilité du racisme anti-blanc. Puisque le racisme anti-blanc n’est pas systémique, alors, il n’est pas du racisme du tout. Voilà pourquoi ces « antiracistes » modernes peuvent soutenir, avec le plus grand sérieux, que le racisme anti-blanc n’existe pas. Bien sûr, c’est un attentat sémantique. Tordre ainsi le sens d’un mot est une supercherie et une malhonnêteté totale. Car aucune acception dans aucun dictionnaire ne permet de soutenir cet amalgame fallacieux. Avec une telle logique absurde, on pourrait tout aussi bien soutenir que le racisme anti-noir n’existe pas, ou que le racisme est un plat traditionnel moldave. Enfin, comment un noir pourrait-il affirmer que le racisme anti-blanc n’existe pas, en tant que « non concerné », ne devrait-il pas se taire à son tour face à une réalité qu’il ne peut expérimenter et donc ne pas comprendre ? On voit de quel tissu d’imbécillités et de contradictions tous ces discours sont faits.
Conclusion : penser « l’équivoque du monde » [14]
La société que de tels discours préparent est celle de la permanente revendication des egos. Faire de la misérable individualité mesquine, hargneuse et revancharde une place forte. A ce jeu-là, le plus susceptible l’emporte. Car c’est une escalade, à n’en point douter. C’est aussi une école de la méfiance et de la malveillance a priori puisque toute parole est suspecte de déplaire ; il faut traquer le moindre mot qui pourrait être interprété de travers. La mort de la civilité, de la politesse. Dès lors, il s’agit moins d’accorder a priori à autrui son respect (au moins dans les formes), quitte à le reprendre aussitôt, que le l’exiger de lui. Le don (politesse) fait place à une forme de réclamation, d’extorsion ; ce que je doit, à ce qui m’est dû. Le triomphe du renfermement sur soi[15].
A chaque étape, nous avons vu qu’un peu de nuance eût été de bon ton ; mais elle n’est jamais ce qui anime les milieux militants, souvent radicalisés et certains de prêcher le Bien et le Juste. Ils sont, au contraire, englués dans leurs certitudes et donc incapable de voir l’équivoque des choses, leur plurivocité. La multiplicité des interprétations possibles d’un même fait leur échappe totalement. Nous avons essayé de montrer que les choses sont toujours ambiguës, que face à un même fait, plusieurs points de vues sont possibles, qu’il s’agit souvent d’articuler entre eux. Au contraire de cela, les militants sont inaccessibles à toute forme de nuance, ils appliquent leur grille, leur schéma en toutes circonstances. C’est le propre d’ailleurs de toute entreprise complotiste et religieuse : araser les points de vue, boucher tous les horizons, empêcher tout pas de côté. Voilà pourquoi ces militants sont si imperméables au second degré[16] comme nous le pointions tout à l’heure. L’humour leur est insupportable, car il suppose une prise de distance, un recul.
C’est aussi la raison pour laquelle ils s’en prennent si violemment à l’art qui est par excellence le domaine de l’équivoque. Une oeuvre d’art est un monde dans le monde, ainsi, cette « équivoque du monde » s’y retrouve comme amplifiée, grossie à la loupe. On a vu ces dernières années les charges des féministes et antiracistes modernes contre des œuvres qu’ils jugent racistes, sexistes etc. Là encore l’incapacité à la subtilité et à la nuance (à l’intelligence en fin de compte) est en cause : ils ignorent tout de ce qu’Aristote appelait catharsis, cette distance entre ce qui est représenté et sa réception. On pourrait tout aussi bien considérer qu’une oeuvre mettant en scène du racisme est justement l’occasion de nous en purger, de nous en laver telle une eau lustrale. Mais non, pour les militants, représenter du racisme (ou autre discrimination), c’est forcément être raciste et jouir de ce qui est montré. Quelle imbécillité crasse faut-il pour confondre à ce point le réel et sa représentation ! Les Etats-Unis sont la pointe avancée de ce mouvement de haine de l’art, qui, dans certaines universités, a déjà banni un certain nombre d’auteurs. Juger d’une œuvre vieille de 143 ans[17] avec les catégories du moment ne pose aucun problème à ces gens… Car c’est ce qu’ils font, ils plaquent leurs catégories sur des oeuvre séculaires parfois. Ce qui, au passage témoigne d’une certitude et d’une outrecuidance démesurées : faut-il se penser si supérieur, si moralement élevé, pour oser juger un chef-d’œuvre !
L’homme moderne est caractérisé par cette vanité et cette boursouflure. Ces militants en sont les caricatures, alors qu’ils n’arrivent pas à la cheville de ceux qu’ils condamnent – et même la cheville, c’est leur faire trop d’honneur. Leur prétention est sans borne, ils toisent la nature, le cosmos même, l’ordre plurimillénaire des choses, se vivent comme les premiers hommes d’une race nouvelle, ce sont des « hommes nouveaux ». Quand on sait ce que cette idée a charrié de cadavres, de misère et de tourments, on ne peut que frémir…
[14] J’emprunte cette belle formule au titre d’un livre du philosophe Mickaël Foessel : Kant et l’équivoque du monde, Editions du CNRS, 2008. Ce livre, consacré à la notion de monde dans le système kantien montre combien elle est profondément équivoque, c’est-à-dire qu’elle maintient à la fois une forme d’égalité des sens (les antinomies de la raison chez Kant), une égalité des voix possibles (aequus+vox) mais aussi une ambiguïté, une tension insurmontable.
[15] Nous avions déjà analysé ce phénomène au chapitre 4 du dossier Athées : portés disparus ? Il faut comprendre que la montée de la susceptibilité est un phénomène général, que l’on désigne généralement abusivement par « individualisme ». On devrait plutôt parler d’atomisation de la société, bien évidement liée au développement fulgurant du libéralisme.
[16] On se reportera pour s’en convaincre à toutes les tentatives de ces inquisiteurs chouinards de contrôler l’humour, de museler l’ironie : ils parlent de rire « inclusif ». En fait, une censure de plus. Et surtout, une réduction terrible du monde à un seul aspect, une vision morne et triste des choses sous le prisme unique de leur idéologie. De sorte qu’on peut leur appliquer cette sentence d’Heidegger que lui-même adressait aux animaux et dire de ces militants qu’ils sont « pauvres en monde ».
[17] Je pense ici naturellement au Carmen de Bizet, dont la fin avait été changée afin de satisfaire aux exigences « féministes » : désormais, c’est Carmen qui tue Don José. L’opéra avait aussi été annulé en Australie car il met en place des cigarière. L’hygiénisme délirant rejoint les luttes contre les discriminations. Mais le mouvement est le même : ces luttes sont en fait des « hygiénismes » moraux qui prétendent lutter contre toute perversion de l’art, de l’humour, de la pensée. On pourrait multiplier les exemples, en particulier aux Etats-Unis. Le dernier en date : Blaise Cendrars et ses Petites contes nègres pour les enfants des Blancs. Les militants ont condamné ce livre à cause du mot « nègre », le jugeant évidemment raciste et choquant. Montrant par là leur fétichisme des mots, leur incapacité totale à dépasser le mot pour voir ce qu’il y a derrière : imbécillité là encore. Une telle soumission au langage est effrayante.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou mettre un « j’aime » !
Vous pouvez prolonger le débat dans les commentaires en bas de page ou simplement nous faire connaître votre avis sur l’article.
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



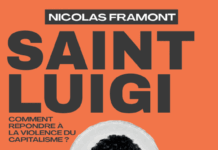




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)
![[Bibliosphère] La terreur féministe – Irene](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/10/Terreur-feministe-La-218x150.jpg)




[…] de leur communauté. Cela rejoint la rhétorique des « non-concernés » que nous analysions dans un précédent article. L’argument ici est subtil : une femme musulmane peut se prononcer sur le patriarcat français […]