Leur violence et la nôtre
Apologie de la (contre) violence
Après le mouvement des Gilets jaunes, mouvement social le plus important et intéressant de ces dernières décennies, l’opposition à la réforme des retraites voulue à toute force par le gouvernement, au prix d’un autoritarisme de plus en plus affirmé, remet la lutte sociale sur le devant de la scène. Or, inévitablement, la lutte ne peut faire l’économie de la violence, ou au moins d’une certaine forme de violence. Excédé par des tombereaux de mépris, par le déni de la « démocratie » parlementaire puis l’usage du 49-3 et le rejet de la motion de censeure, le peuple, massivement opposé à la réforme, en appelle à reprendre en main le pouvoir, en s’opposant frontalement et violemment au gouvernement en place.
Mais ce n’est pas la seule irruption de la violence dans le champ politique. Il y a peu, un député de l’opposition, Thomas Portes, a posé de pied en cap pour une photographie sur laquelle on le voit écrasant de sa semelle droite un ballon à l’effigie de la tête du Ministre du travail, Olivier Dussopt. Que n’avait fait le malheureux ! Aussitôt, cris d’orfraie venus de tout l’échiquier politique, dénonciation par l’inénarrable Eric Woerth – dont le nom correspond à ce qu’inspire le bonhomme : la nausée – d’un odieux « appel au meurtre »[1], menace contre la démocratie… tout y est passé[2]. C’était à qui allait y aller de sa condamnation la plus grandiloquente possible. Citons toutefois le commentaire tweetesque d’un député dit socialiste : « Stop à toute violence, même symbolique »[3]. L’ennemi est clairement affiché : la violence même symbolique. Peu après, lors des manifestations du 11 février, c’est cette fois une poupée gonflable qui a agité d’effroi notre si sensible et émotive majorité présidentielle : une poupée gonflable à l’effigie de la Première ministre, Mme Borne, pendue à un gibet de fortune. Et rebelote : « incitation au meurtre », indignation généralisée, moue outrée de Laurent Berger[4]… Il n’en fallait pas plus pour relancer le cirque médiatique, avec une mention spéciale pour ce député en pleine panique : « Après le ministre du travail décapité et foulé au sol, la Première ministre pendue ! »[5] Mazette, les piques et les guillotines ne sont pas loin. Les manifestations précédentes avaient donné lieu aux mêmes réactions primitives de nos bourgeois si démocrates lorsque, par exemple, des pantins représentant le Président avaient été brûlés en place publique[6]…
Bref, tout ceci est parfaitement ridicule, néanmoins, cela pose la question de la violence en politique et de son instrumentalisation par les dominants. Quel est la place de la violence en politique, qui est violent, contre quoi ou qui, quel usage faire de la violence, qui décide de ce qui est violence ou pas… ? Et surtout, comment nous réapproprier la violence ? Voilà quelques-unes des questions cruciales que nous devons absolument résoudre.
Petite théorie de la violence
Avant de nous interroger sur les usages de la violence, il faut essayer de définir celle-ci. En particulier, de tenter de la définir au regard du politique.
« Le mot violence apparaît en 1215 en français, il est issu de violentia, (‶caractère emporté, farouche et indomptable″) une manifestation de la vis c’est-à-dire de la force, de la puissance. Le terme dérive du verbe violare, qui signifie indistinctement, porter atteinte, attaquer, transgresser, profaner ou déshonorer. […] L’idée de violence semble d’emblée associée à un usage illégitime de la force ».[7]
Nous voilà sans barguigner plongés dans le vif du sujet : l’idée d’illégitimité est au cœur de la violence. Toute la question sera, à partir de là, de distinguer la force légitime et illégitime – c’est-à-dire distinguer la force de la violence. Cela place in medias res l’analyse de la violence au beau milieu des rapports humains eux-mêmes, ce qui semble dire que la violence n’existe pas en dehors du monde des hommes, voire qu’elle est une forme de relation sociale. Pour être plus précis : l’usage qui est fait du mot « violence » est socialement situé. « Caractériser une action comme un acte de violent, c’est lui attribuer une valeur et porter un jugement. Les discours entourant ces actes sont révélateurs des normes et des codes sociaux des différentes époques. »[8] A tous égards, la violence semble indissociable du tissu social dans lequel elle s’inscrit. Est-ce à dire que, si l’on extrapole, toute violence est politique ? Pour autant, en allant aussi loin, ne vide-t-on pas de toute substance le terme de politique, tout comme celui de violence ? D’autres questions se posent alors : qui est habilité à dire ce qui est légitime, et en fonction de quels critères ?
Puisqu’il nous faut nous réapproprier la violence, il est indispensable de proposer une grille de lecture qui la replace à sa juste place dans son rapport dialectique au politique. Nous verrons qu’à rebours des discours dominants qui tentent d’expurger la violence du politique, la première est au cœur du second, elle est ce qui le rend possible et le hante à tout instant.
Les rapports entre politique et violence
La violence tue, elle fait couler le sang, elle fait valser les lames et tomber les têtes, elle fait pleuvoir les coups et s’effondrer les corps ; la violence casse, arrache, mutile, estropie, saccage, massacre, anéantit, blesse, meurtrit ; elle s’enivre de la souffrance et se grise du chaos ; la violence n’appelle jamais qu’elle-même : toujours plus de violence pour répondre à la violence, vae victis ; elle est le mouvement perpétuel qui n’accepte qu’un seul terme : la mort. Voilà ce que sont les effets de la violence : les ecchymoses, les hématomes, les contusions, les démembrements, les dépeçages, les décapitations, les tortures, les éviscérations, les viols, les amputations, les fractures, les égorgements, les saignées, les lacérations, les énucléations, les écorchures, les brûlures, les noyades, les lapidations, les pendaisons, les fusillades… une liste longue comme l’Histoire humaine. La violence peut aussi être symbolique, c’est celle qu’on exerce par l’utilisation de symboles dans un sens très large : injures, manipulations, humiliations, outrages, trahisons, mensonges… Une violence non physique peut faire des dégâts tout aussi considérables chez celui sur qui elle s’exerce.
Partant de là, on pourrait se contenter d’adopter par exemple la définition proposée par Yves Michaud :
« Il y a violence quand, dans une situation d’interaction, un ou plusieurs acteurs agissent de manière directe ou indirecte, massée ou distribuée, en portant atteinte à un ou plusieurs autres, à des degrés variables, soit dans leur intégrité physique, soit leur intégrité morale, soit dans leurs possessions, soit dans leurs participations symboliques et culturelles. »[9]
C’est clair, net, sans bavure, et permet de rendre compte des situations de violence objective. Autrui est présenté comme point de référence de la violence ; l’autre pris dans son extension maximale : son corps, son esprit, ses possessions, ses participations. Cependant, la force de cette définition est aussi sa faiblesse : elle évacue toute notion de légitimité et a une portée démesurée, de sorte qu’au final, toute contrainte, ou presque, devient violence. Le problème surgit alors : on ne peut plus distinguer violence et pouvoir – et politique. Or, « il convient de bien distinguer le pouvoir, en tant qu’usage de la force fondé sur le droit, de la violence, en tant qu’abus de la force. En effet, s’il n’était plus possible de distinguer ces deux notions, cela signifierait ipso facto que toute violence deviendrait légitime. On sortirait alors de l’état politique. »[10]
Il nous faut donc affiner les choses. Le politique, dit-on, permet de préserver l’Homme du trop-plein de violence qui le hante pour la canaliser, la détourner, la sublimer selon le mot des psychanalystes. Il nomme donc ce qui se propose, non d’y mettre fin, mais de lui donner un cours nouveau afin que de violence qu’on dira primaire (violence physique ou symbolique), elle soit symbolisée – une façon de l’organiser, de l’institutionnaliser, de la ritualiser voire de la sacraliser. La violence symbolisée, c’est-à-dire le politique, est sans doute le meilleur bouclier contre la violence primaire. Un bouclier n’est jamais infaillible bien sûr, il peut même, dans certaines circonstances, devenir lui-même une arme « par destination ». Ce qui signifie que la symbolisation de la violence ne prémunit jamais totalement contre la violence primaire et qu’elle peut parfois y conduire.
Symbolisation de la violence : le politique
Le politique est symbolisation de la violence – qui cesse dès lors d’être, au sens propre, violente. Il s’agit de gérer le conflit, la dissension, les affrontements portant sur la vision qu’on peut avoir de la cité et de la collectivité. Cependant, le politique peut à son tour utiliser la violence comme un instrument. Guerre, répression, maintien de l’ordre…on parlera alors de violence secondaire. « La violence est non seulement permise mais aussi moralement légitimée tant qu’elle est utilisée par un pouvoir reconnu comme tel. Le pouvoir repose en permanence sur la possibilité d’exercer la violence. »[11] On pourra voir dans cette réflexion du dernier Günther Anders l’écho lointain de la célèbre phrase de Max Weber : « Nous entendons par Etat une ‶entreprise politique de caractère institutionnel″ lorsque et en tant que sa direction administrative revendique avec succès dans l’application des règlements le monopole de la contrainte physique légitime. »[12] Max Weber utilise le terme Gewaltsamkeit, traduit par « contrainte », bien que le mot allemand signifie en réalité « violence ». Cependant, comme le fait remarquer le juriste Michel Troper, « la violence dont parle Weber n’est ni aveugle ni illégitime mais devient légitime précisément lorsqu’elle est organisée. Elle peut donc alors être appelée ‶contrainte″»[13]. Nous sommes bien dans le cas d’une violence ressaisie par l’ordre politique et même prescrite par lui. Mais c’est un type particulier de violence, une « contrainte » et non un pur déchainement de force. On peut voir qu’il existe une dialectique subtile entre politique et violence, et que le politique n’est pas purement et simplement le décalque en négatif de la violence. En outre, il est frappant de constater que les deux auteurs parlent de la forme institutionnelle séparée que prend le politique : l’Etat pour l’un, le pouvoir pour l’autre.
Il est néanmoins possible d’aller plus loin, en remarquant que la forme-Etat n’épuise pas toutes les incarnations du politique. En opposition aux théories classiques du pouvoir politique qui affirment que « coercition et subordination constituent l’essence du pouvoir politique partout et toujours »[14], l’anthropologue Pierre Clastres affirme que ne voir le pouvoir politique qu’à travers le prise du couple « commandement-obéissance »[15] revient à faire de la politique occidentale le modèle absolu de toute politique. Pourtant, il existe des sociétés humaines dans lesquelles personne ne commande ni n’obéit, à l’instar des Iroquois d’Amérique. Face aux données ethnologiques, il faut se rendre à l’évidence, la politique occidentale n’est pas le fin mot du politique.
« Même dans les sociétés où l’institution politique est absente […], même là le politique est présent, même là se pose la question du pouvoir […]. Si le pouvoir politique n’est pas une nécessité inhérente à la nature humaine, c’est-à-dire à l’homme comme être naturel […], en revanche il est une nécessité inhérente à la vie sociale. On peut penser le politique sans la violence, on ne peut pas penser le social sans le politique : en d’autres termes, il n’y a pas de sociétés sans pouvoir. »[16]
Il y a, pour ainsi dire, consubstantialité du social et du pouvoir politique. Le politique émerge des relations concrètes entre les individus. Dès lors que des êtres humains forment une collectivité, qu’ils nouent entre eux des relations réciproques, ils forment une multitude qui a nécessairement une puissance propre – potentia multitudinis – qui se manifeste tout aussi nécessairement. Autrement dit, les êtres humains, lorsqu’ils forment plus qu’un agrégat mais une collectivité, s’affectent les uns les autres ; et ne peuvent pas ne pas s’affecter, auquel cas il n’y a pas de collectivité. « Le collectif affecte les individus qui le composent, telle est sa force propre, tel est l’effet qui suit de sa puissance, et de ce que sa puissance toujours s’exerce. »[17] Frédéric Lordon, reprenant les catégories spinozistes, montre comment tout pouvoir vient de la puissance de la multitude. D’où vient la « force affectante »[18] du collectif ? Frédéric Lordon, d’après Spinoza, appelle imperium « le principe par lequel le groupe sécrète, à partir de ses membres mêmes, le pouvoir d’affecter ses membres »[19]. On fait alors un pas vers le politique, puisque l’imperium nomme « la souveraineté, mais du social […], c’est-à-dire la force par laquelle le social (en ces normes) fait autorité »[20], ou encore « la puissance par laquelle les normes normalisent, par laquelle les institutions tiennent leurs sujets »[21]. Toutefois, si la multitude est dotée d’une puissance affectante, cette dernière n’est pas à tout moment politique. Le politique apparaît comme les affects communs qui visent plus ou moins explicitement la gestion du corps social. C’est ici que la violence entre en jeu, car les individus, parce qu’ils ont des intérêts parfois divergents, des conceptions étrangères du « bien commun », des façons différentes de considérer la conduite de la cité, vont nécessairement entrer en conflit. Le politique, on a assez insisté dessus, va permettre de canaliser la violence interne au corps social, afin que les individus puissent « s’opposer sans se massacrer »[22]. Cela passe par ce processus que j’appelle la symbolisation de la violence. Le pouvoir politique apparaît comme pouvoir de contraindre les corps, de les plier ou de les marquer. Il est également, notent Anders et Weber, le seul a pouvoir contraindre à la violence légitime. La violence est donc doublement au cœur du politique : à la fois comme son point de départ, et à la fois comme ce dont il est le seul à avoir la – partielle – maîtrise.
Comment la potentia multitudinis parvient-elle à s’assembler, à former du commun ? Grâce à la dynamique de ce que l’ethnologue Marcel Mauss nomme le don, c’est-à-dire « la triple obligation de ‶donner, recevoir, et rendre″ »[23]. Je ne reviendrai pas sur ce point que j’ai déjà largement développé par ailleurs, notamment dans mon ouvrage Ce que le marché fait au monde[24]. Le cycle du don est à l’origine des sociétés humaines, il permet l’instauration du politique car il est par excellence l’opérateur de symbolisation[25]. Ainsi, on passe de la violence primaire à la violence symbolisée par l’intermédiaire du don. Le politique, qui passe toujours d’une façon ou d’une autre par le don, est donc une modalité de la violence symbolisée ; mais toute violence symbolisée n’est pas politique[26]. Dès le départ, le don maussien surgit comme « aménagement de l’antagonisme »[27], mais il ne fait pas cesser le négatif pour autant, transformant les individus en bisounours donateurs. Ce dernier hante le don à chaque instant, comme condition de possibilité même :
« Pour qu’un don soit reconnu comme don, comme un don qui a de la valeur, un don qui fait sens et qui fait lien, il faut non seulement que, lorsque je donne, je sois reconnu comme quelqu’un qui aurait pu ne pas donner – sur le mode de l’indifférence ou de l’aban-don -, ou plus encore qui pourrait donner le mal plutôt que le bien. Bref, la valeur même du don est toujours différentielle : elle suppose la possibilité toujours ouverte de son envers, de son négatif. »[28]
Comment pourrait-on alors définir la violence par le prisme du don ? La violence, pourrait-on dire, est le don qu’on fait à quelqu’un qui n’en veut pas. Elle est un don refusé, un donner sans recevoir, un don qui s’impose. Cela peut-être un don de coup, de meurtrissures, mais aussi d’insultes ; un don de méfaits, mais aussi de bienfaits dont l’autre ne veut pas. La violence d’adresse toujours à quelqu’un, même dans le cas d’une violence dirigée contre des objets. Casser, détruire, briser, démolir, piétiner ou démonter sont des violences lorsque l’on montre qu’on casse, brise, démolit etc., ou que le résultat de la destruction, du bris, de la démolition etc., est vu et refusé par quelqu’un – y compris un quelqu’un imaginaire. Cela dit, imposer un don n’est pas la seule façon d’outrepasser la volonté d’autrui : on peut aussi accaparer ce que l’autre ne veut pas donner. Cela décrit l’acte de prendre. Sociologue spécialiste de l’œuvre de Marcel Mauss, Alain Caillé situe le mal et la violence du côté du « cycle diabolique »[29], c’est-à-dire l’opposé du cycle du don, à savoir « ignorer-prendre-refuser-garder »[30]. Bien sûr, on peut donner des coups, des blessures, des injures, donner des maux, comme dans nombre de rituels ancestraux, dont le fameux potlatch étudié par Marcel Mauss. Ni la mort ni la destruction ne sont, par elles-mêmes, incompatibles avec le don. Mais la violence met fin à la valse du don car elle procède d’un refus : refus de recevoir ou refus de donner. Il n’y a plus de réciprocité. Si l’on suit cette définition de la violence, il faut noter qu’elle résulte d’une intention, qui passe toujours par le premier temps du cycle diabolique mis en avant par Alain Caillé, à savoir ignorer. On ignore le refus effectif d’autrui, mais on ignore également son refus potentiel, c’est-à-dire qu’on ignore l’idée même qu’autrui puisse refuser. Le premier cas de figure est simple : si je rosse l’autre, si je l’outrage par des insultes ou si je le dépouille de ses biens, je choisis immédiatement de passer son refus par pertes et profits, voire je m’en délecte. Dans la seconde situation, en revanche, je peux penser faire du bien à autrui par exemple par un baiser ou des flatteries sans savoir qu’il ou elle n’en veut pas, mais alors, je choisis vertement d’ignorer qu’il ou elle pourrait ne pas en vouloir, son avis m’apparaît comme superflu. Comme le décrit si bien Philippe Chanial,
« la violence manifeste une attitude de fermeture à l’altérité, qui repose sur la suspension ou la désactivation de toute implication sensible, de toute identification empathique. Elle définit ainsi tout ce qui fait violence […] à autrui, ce qui lui porte atteinte ou lui porte offense […]. A ce titre, elle implique une attitude réifiante […], qui fait de l’autre une chose ou un objet, et noue ainsi une relation avant tout instrumentale. »[31]
La violence a ainsi pour effet principal celui-là : considérer l’autre comme une simple chose soumise à ma seule volonté.
La violence secondaire : polemos et stasis
Après la violence primaire et la violence symbolisée (autrement dit le politique), parlons de la violence secondaire : c’est-à-dire la violence utilisée comme moyen par le politique. Ces usages sont multiples et plus ou moins institutionnalisés. Le premier cas de violence secondaire, le plus classique, c’est la guerre. Ce qui donne raison à la célèbre formule du stratège prussien Clausewitz qui, dans De la guerre, disait que « la guerre n’est rien d’autre que la continuation de la politique par d’autres moyens ». La guerre est éminemment codifiée, ritualisée, corsetée dans un appareil législatif et normatif étroit. Il existe même un droit de la guerre. La violence, quand elle se manifeste par la guerre, ne sort pas du cycle du donner, recevoir et rendre, elle est un opérateur de reconnaissance, y compris lorsque le but affiché de la guerre est de conquérir le territoire du peuple auquel on porte querelle, de s’approprier ses biens et d’absorber ses membres. Dans tous ces conflits guerriers, l’adversaire, ou l’ennemi, est posé comme un sujet, mieux, comme un sujet politique. C’est la principale différence avec la violence (primaire) qui réifie intégralement l’autre. Hannah Arendt montre qu’en tant qu’« ultima ratio »[32] du conflit politique, la guerre est toujours là, non pas comme la dégénérescence monstrueuse du politique, mais bien comme sa modalité violente.
A côté de la guerre classique, d’autres types d’actions guerrières se multiplient : des petites guerres. Si « la désignation de “petite guerre” […] correspond au XVIIIe siècle à la tactique des troupes, enrégimentées ou pas, qui servent en appui de l’armée régulière dans le cadre des conflits inter-étatiques classiques »[33], avec Clausewitz, les choses changent. La petite guerre cesse d’être subordonnée à la guerre classique, elle n’est plus seulement une tactique d’appoint utilisée par les armées régulières[34]. Le tacticien applique la notion de petite guerre à des conflits d’ordre insurrectionnel ou à des soulèvements populaires. Si le concept, enrichi par l’officier prussien, permet de penser certaines manifestations actuelles de conflits armés, c’est avant tout grâce à sa souplesse, tandis que la grande guerre est trop rigide, trop massive, trop « militaire » pourrait-on dire. Il ne s’agit pas d’un affrontement mais, au contraire, d’un art de la dissimulation, de la surprise, de la frappe invisible, « la tactique de petite guerre ayant pour but de mettre l’ennemi dans un climat d’insécurité perpétuel »[35]. Harceler, et pour cela être mobile et furtif, afin que la petite troupe, par sa flexibilité, l’emporte sur la grosse. Comme le résume bien l’historienne Sandrine Picaud-Monnerat, « la petite guerre est bien souvent la guerre du faible au fort »[36], il faut donc user des ressources de la ruse pour circonvenir l’ennemi et ne lui laisser aucun moment de répit. L’objectif de la petite guerre n’est pas d’écraser l’ennemi ni de le détruire, la faiblesse de nombre rendrait un affrontement direct suicidaire. Il s’agit plutôt de faire en sorte qu’en privant l’ennemi de sécurité, celui-ci déguerpisse – voire qu’il dépose les armes.
Mais la guerre peut se retourner contre le corps social lui-même : c’est la guerre civile[37]. Polemos devient alors stasis. La guerre civile n’est pas étrangère au politique, elle la suit comme son ombre, et menace à chaque instant de la déborder. D’un point de vue logique, et non chronologique, la guerre civile est à la fois pré-politique et post-politique : c’est de la méta-politique. Elle est vraiment la violence qui hante le politique, pour reprendre l’image de Jacques Derrida creusée dans Spectres de Marx, elle a une existence spectrale qui peut s’actualiser en prenant possession du corps politique. Malheureusement, tout le monde sait bien qu’on ne se débarrasse jamais d’un spectre.
« La guerre civile peut donc être définie comme l’actualisation d’un état de guerre permanent, d’une possibilité réelle, à l’œuvre même après l’instauration du contrat social. Elle est une permanence constante. […] La guerre civile est un mal qui peut se réveiller, et Hobbes d’utiliser cette image de l’hostilité susceptible de ‶réveiller la guerre assoupie″. »[38]
Pour Hobbes, la guerre civile désigne donc le fait que l’état de nature n’est jamais aboli, y compris au sein de la communauté politique la plus achevée.
« L’état de nature est la formulation théorique de la sous-jacence de la guerre dans n’importe quel État ; la guerre civile, interindividuelle, replace paradoxalement la cité dans une posture prépolitique. L’état de nature est le modèle (la guerre civile en est la figure) de la négation du politique dans le politique. »[39]
La stasis est, dès son origine grecque, liée à la famille, au foyer, à cette communauté minimale qui, par agrégation à d’autres familles, formera finalement la polis. Le lieu de la guerre civile semble être à première vue celui de l’intimité qui déborde dans la cité. La stasis est en première approximation le conflit entre les familles, ou au sein des familles, premier échelon de la polis. La famille est donc ambivalente : elle est le premier degré de la cité tout en étant le ferment de la guerre civile – la guerre fratricide. Pour autant, la stasis est-elle strictement confinée au sein de la famille ? Certes non, dans la mesure où le frère de sang et le concitoyen sont mis sur le même niveau : « dans la stasis, le meurtre de ce qui est le plus intime ne se distingue pas du meurtre de ce qui est le plus étranger »[40], autrement dit, tuer son frère de sang ou tuer un étranger sont équivalents en regard du contexte de la cité tout entière. Prévaut alors une indistinction généralisée entre la famille et la cité. Comme une grande et terrible remise à plat, le champ social dans son ensemble plonge dans cette « indécidabilité entre oikos et polis, entre parenté de sang et citoyenneté »[41].
« La stasis – selon notre hypothèse – ne se situe ni dans l’oikos ni dans la polis, ni dans la famille ni dans la cité : elle constitue une zone d’indifférence entre l’espace impolitique de la famille et l’espace politique de la cité. En franchissant ce seuil, l’oikos se politise et, inversement, la polis ‶s’économise″, c’est-à-dire se réduit à l’oikos. Cela signifie que, dans le système de la politique grecque, la guerre civile fonctionne comme un seuil de politisation ou de dépolitisation, par lequel la maison s’excède en cité et la cité se dépolitise en famille. »[42]
Dans cette espèce « d’entre-deux », on n’est plus vraiment ni dans l’ordre du politique ni dans celui du domestique, ce qui donne une plus grande place à l’individu et le somme de prendre parti : la guerre civile requiert tout un chacun, y compris à son corps défendant. Elle remplit alors une fonction essentielle : le rétablissement d’un déséquilibre entre deux pôles sociaux fondamentaux, la famille et la cité. Elle a bien ce statut méta-politique : ni famille ni cité, ni politique ni apolitique, ni dedans ni dehors. Une modalité paroxystique et régulatrice de la violence.
Petit tour d’horizon
Nous venons de voir en quoi le politique est, à tout instant, intriqué avec la violence. On ne peut, quels que soient les efforts entrepris, abolir complètement la violence, c’est dans ce constat implacable que se tient ce qu’après les Grecs et Nietzsche on peut appeler le tragique.
Le cirque politique et médiatique montre tous les jours que le (néo)libéralisme tente pourtant, en dépit de tout, de renier la violence au sein du politique, ou plutôt de rejeter du côté de la violence tout dissensus politique, toute manifestation de conflit donc de violence symbolisée. Chaque manifestation de « violence » est considérée comme fondamentalement antipolitique, mais il y a plus, la moindre opposition, pour peu qu’elle ne cadre pas parfaitement avec le Spectacle, au sens debordien, est immédiatement disqualifiée est rejetée au rang de « violence », de sorte que la violence est le repoussoir ultime, que ce soit par ailleurs une violence réelle, ou déclarée telle. Mais, et c’est là le nœud de l’affaire, c’est toujours le pouvoir qui décide de ce qui est violent ou ne l’est pas.
La thèse que je veux défendre ici est abrupte : il nous faut réinvestir le champ de la violence en politique. Pour cela, commencer par définir de quoi l’on parle en utilisant ce mot. On ne peut pas fermer les yeux sur l’utilisation actuelle qui est faite de ce terme – par le pouvoir et contre nous. Aujourd’hui, l’emploi du terme « violence » est devenu un enjeu politique majeur, il est tombé dans l’escarcelle du pouvoir et de ses séides (ce que j’appelle le « système »). Ce sont les dominants qui donnent le tempo, qui décrètent que ceci est violence et que cela n’en est pas. Macron : « ne parlez pas de “répression” ou de “violences policières”, ces mots sont inacceptables dans un Etat de droit. »[43] Les choses sont claires : seul le pouvoir décide de l’emploi du mot « violence ». Est « violence » tout acte qui conteste le pouvoir, alors que tout ce qui tend à le maintenir est « ordre ». Nous en sommes là. Comme toujours, nous avons été dépossédés de nos mots, de nos manières de nommer le réel, de nos dénominations, donc du réel lui-même. Il est fondamental de reprendre ces termes de la bouche du pouvoir – qu’il soit politique, médiatique, économique, académique – pour nous les réapproprier et dans le même mouvement, restaurer le réel qu’ils décrivent. Toute lutte politique est une lutte pour le réel et contre la falsification. Macron, en interdisant l’usage du mot violence à propos de la police, fait comme si tout acte institutionnel était légitime du simple fait qu’il émane d’une institution – une institution séparée, bureaucratique, autonomisée du corps social, étatique. Sous-entendu : puisque tel acte émane de l’Etat, il est légitime, donc indiscutable. On voit la terrible mécanique et tous les débordements qu’elle autorise par anticipation.
Où en sommes-nous ?
Le mouvement social est violent. C’est du moins ainsi que tous les commentateurs le perçoivent. Et en un sens, cela est vrai. Le mouvement des Gilets jaunes était une volonté de réintroduire du politique dans un monde presque intégralement dépolitisé, c’est-à-dire soumis, pour ce qui est des affaires publiques, à la seule régulation (néo)libérale du marché. Depuis des dizaines d’années, sous couvert d’efficacité, de régulation, de réalisme face à la mondialisation, le politique tend à être pulvérisé. Face à cela, les gilets-jaunes ont eu l’outrecuidance de réclamer le retour du politique et du peuple comme sujet politique. Les manifestations contre la réforme des retraite s’inscrit dans le même mouvement. Si maintenant nous appliquons l’analyse formulée plus haut sur ce constat, nous obtenons ceci : un retour du politique est donc un retour de la violence symbolisée dans un monde duquel elle a été expurgée – au moins aux yeux des dominants. Car si ce sont les dominants qui décident de ce qui est violent, la violence qu’ils exercent est invisibilisée, pire, elle n’est même plus pensable en tant que violence.
La question est alors de savoir dans quel moment du cycle de la violence nous nous trouvons. Violence primaire, moment politique, violence secondaire, guerre civile ? Où en sommes-nous ? De la réponse à cette question débouche toute une série de positionnements pratique aux répercussions capitales.
Il est clair que si le politique disparaît, au profit du seul marché, toute possibilité de symbolisation de la violence s’envole. Qu’est-ce qu’un monde apolitique ? Un monde où règne la violence primaire – c’est une tautologie : si le politique nous écarte de la violence primaire, et si l’on retranche le politique, ne reste que la violence primaire. Pourtant, la singularité du (néo)libéralisme vient de ce que, précisément, il nie absolument la violence primaire qu’il génère (négativement et positivement). Le monde vu par les lunettes roses des néolibéraux est fluide, cool, open, happy (que l’on songe aux Chief Happiness Officers qui distribuent du bonheur et du plaisir parmi tous les « collaborateurs » dans des open spaces), ce monde est progressiste, adapté, inclusif, il ne tolère ni obstacle ni entrave, il veut « libérer les énergies » et « déverrouiller les conservatismes »… Toute violence est non seulement niée, mais surtout refoulée et imputée à des forces externes : les blocages, les « fainéants et les cyniques » dixit Macron, les forces conservatrices, l’inertie… De sorte que lorsque le politique fait soudain irruption, la violence dont il est inséparable le heurte de plein fouet. On se retrouve avec tous les commentateurs, politiques et philosophes assermentés qui, sur tous les plateaux et dans tous les médias, beuglent, comme des bœufs qu’ils sont, à la montée de la violence politique comme s’il s’agissait de violence primaire. Et dans la confusion générale, ils ne voient aucun problème à y opposer la véritable violence physique d’un système répressif qui arrache des mains, crève des yeux, tue une vieille dame, brise des mâchoires, violente des quidams, charge sur des manifestants pacifiques et bouscule gratuitement une personne âgée au risque de lui fracasser le crâne[44]. La grande force du gouvernement est d’avoir dissous la frontière entre violence symbolique et physique. Pour lui, relève de la pire des violences le fait de décrocher un portrait présidentiel, est un attentat inqualifiable le fait de pendre un mannequin, constitue un crime atroce un moulage brisé, une banque caillassée est érigée en martyre et, pire infamie entre toutes, attaquer une porte, fût-elle ministérielle, représente une tentative de coup d’Etat sans équivalent dans l’Histoire. D’un côté : violence symbolique des mouvements sociaux[45] ; de l’autre : violence primaire des « forces de l’ordre ». Cette simple dissymétrie devrait nous faire réfléchir.
Ce qui caractérise le dominant est son règne sur l’ordre discursif et symbolique. Autrement dit, c’est lui qui a le pouvoir de nommer les choses, comme on l’a vu. Il dispose des moyens de mettre le monde en récit, c’est lui qui décide des discours à tenir, des mots à employer, des interprétations à donner aux phénomènes. Dès lors, il lui est facile de construire un ordre discursif qui le renforce. Les médias du système font régulièrement état des violences qui agitent la société, ils s’en sont donné à cœur joie à propos des gilets-jaunes. Pourtant, ils ne présentent jamais que des effets sans causes. Des violences « ont éclaté », disent-ils, comme si la violence surgissait ex nihilo et qu’elle était causa sui, cause d’elle-même. La violence surgirait de nulle part, rien ne la provoquerait que la bestialité d’énergumènes en mal de sang. Une chemise arrachée à un cadre arrache en retour des sanglots et des cris horrifiés à toute la meute politico-médiatique. Alors que cet acte est l’aboutissement d’un long processus qui, bizarrement, n’est jamais évoqué, encore moins montré : management par le stress, chantage à l’emploi, conditions de travail exécrables, humiliations quotidiennes… Cette violence-là, qui affecte les corps au plus profond d’eux, conduisant parfois au suicide, plus souvent au burn-out, à la dépression, à l’explosion de la famille, à la détresse existentielle, à la perte de sens, à la solitude, au mal-être, à la maladie, aux troubles psycho-somatiques, cette violence-là, disais-je, semble ne pas exister. Pourtant, elle relève bien de la violence physique, primaire, celle qui affecte les corps. Mais le jeu journalistique isole l’acte final et spectaculaire de cette longue chaîne tristement banale, ainsi il perd tout son sens, et apparaît comme une pure manifestation de violence gratuite. L’image décontextualisante est un acte politique – c’est-à-dire qu’elle est tout sauf neutre et objective.
La violence sociale qui s’exerce de haut en bas n’est que rarement montrée et analysée en tant que telle dans les grands médias. Elle est encore plus rarement mise en relation avec les violences qui s’exercent de bas en haut. D’autant que si les dominants disposent de tous les moyens de coercition des corps, les dominés, les petits, ceux « qui ne sont rien », n’ont, eux, la plupart du temps, que leur maigre attirail d’actions symboliques : brûler des pantins, faire grève, crier des slogans critiques, taguer les murs, revêtir des gilets fluorescents, déposer du purin devant des permanences de parlementaires… Et quand la violence déborde, qu’elle s’en prend aux corps, c’est toujours sur d’autres dominés qu’elle s’exerce : les fameuses « forces de l’ordre ». La classe dominante est gardée par une frange des dominés qu’elle jette contre d’autres dominés qui lui sont hostiles, afin que les conflits qui secouent le corps social n’affectent finalement que les dominés entre eux. L’ennemi du dehors (les « élites », le « système »…) est inatteignable, tandis que se crée une partition au sein même des classes inférieures. Les grands dirigeants d’entreprise, les grands décideurs, les vrais responsables, eux, sont intouchables. Lorsque Macron, en pleine « affaire Benalla », déclare aux français furieux de voir un système mafieux d’hommes à tout faire et de miliciens protégés au sommet de l’Etat, « qu’ils viennent me chercher »[46], alors qu’il est juridiquement et physiquement intouchable, il met en lumière la séparation entre le pouvoir et ceux sur qui il s’exerce. Le matamore, le brave en peau de lapin, peut fanfaronner et jouer les gros bras, il sait très bien que personne ne viendra le chercher et que si tel était le cas, il serait le premier à déchaîner la fureur policière.
Autre violence, un peu particulière, à laquelle il faut prêter attention : la violence institutionnelle. Je veux parler de la violence par exemple des lois adoptées, des réformes mises en œuvre, des règlements, ordonnances et autres décrets qui émanent du pouvoir législatif et exécutif. Une réforme des retraites comme celle qu’a imposée le gouvernement, avançant, tel un char d’assaut, contre la volonté générale, en allongeant la durée légale de cotisation pour bénéficier d’une pension de retraite, donc en prolongeant la durée de vie en emploi, a des conséquences éminemment concrètes sur les corps et les vies des travailleurs. C’est là le point nodal de l’opposition généralisée à cette réforme, et c’est précisément ce que la minorité au pouvoir nie. Le fond du problème, ce n’est pas la retraite, mais le travail. L’emploi capitaliste est un monde de violence primaire, puisque mettant aux prises des individus hiérarchiquement inégaux. Il n’y a pas de politique au sein de l’emploi capitaliste – à moins de l’y introduire par la force de la loi. Or, le néolibéralisme détricote peu à peu le droit du travail – c’est-à-dire la tentative de politisation de l’emploi capitaliste – et tend à affaiblir les collectifs de travail, sans lesquels aucune politique n’est envisageable, en mettant en avant l’individualisation (des primes par exemple), la mise en concurrence et le primat du contrat sur la loi. En parallèle, les travailleurs et sociologues alertent sur une hausse terrible de la violence du travail. Enfin, les emplois pénibles détruisent physiquement les travailleurs. Etant alors entendu que le monde du travail capitaliste est un îlot de violence primaire au sein d’une société qui affiche partout le rejet de la violence, étendre l’emprise de l’emploi sur la vie des travailleurs ne peut que mener à une extension de la violence. Autrement dit, la réforme des retraites est un acte de violence primaire contre les citoyens.
Légitimite du peuple
D’emblée, nous avons vu que l’enjeu sous-jacent de la violence était celui de la légitimité. Soyons directs : les institutions politiques actuelles n’ont aucune légitimité démocratique, elles n’ont qu’une légitimité de façade, sur laquelle elles assoient leur force d’intimidation et de répression du corps social. Tandis que la démocratie est un processus qui part du bas vers le haut, en faisant émerger des représentants ou des décisions politiques à partir du peuple des citoyens, notre régime procède à l’exact opposé : du haut vers le bas. Les citoyens ne sont bons qu’à valider des décisions ou des dirigeants pré-choisis, à aucun moment ils n’exercent réellement le pouvoir. La seule légitimité démocratique provient, en dernière instance, du peuple, mais du peuple réel, de la majorité réelle des citoyens, ce que tout un chacun approuve ou désapprouve. Les représentants ne sont jamais que… des représentants. Ils ne font, en démocratie, que recueillir la volonté de leurs concitoyens. C’est l’inverse qui se produit : les institutions dites représentatives entendent forger la volonté générale. Et lorsque le peuple n’est pas d’accord… c’est qu’on n’a pas été assez « pédagogue », qu’on a « mal vendu » telle réforme, bref, que le peuple a tort. Les institutions sont donc coupées de la légitimité populaire et tournent à vide. Macron prend toute sa place dans ce dispositif, il en est même la pierre angulaire. Il est celui qui a porté le plus haut le décalage entre les institutions et le peuple dont elles sont censées être l’émanation. Il devrait être inconcevable, en démocratie, qu’un dirigeant soit élu et considéré comme légitime avec à peine plus d’un tiers des votes des citoyens inscrits sur les listes électorales, comme ce fut le cas pour la seconde élection d’Emmanuel Macron. Mais cela ne dérange, semble-t-il, personne, ce qui est la marque que la déchéance démocratique que nous vivons est très profonde.
La légitimité de l’institution provient toujours, donc, du collectif, de la puissance de la multitude. Une violence légitime, autrement dit une contrainte, est alors, de ce fait, toujours légitimée par le collectif et par lui seul. Un contrainte, fût-elle légale, non consentie par le corps social n’est alors plus une contrainte, mais, on l’a vu, une violence. Si on admet que les institutions politiques actuelles ne sont pas légitimes, la contrainte, au sens de Max Weber, qu’elles exercent ne l’est pas non plus. On verse alors immanquablement dans la violence, qui plus est dans la violence primaire – puisque sortie du cadre politique.
Retrouver le goût de la violence
Il semble clair que ce très bref tour d’horizon ne montre pas un paysage chahuté par du conflit politique, de l’affrontement symbolisé qui ressortirait du domaine du don contre-don, mais bien une terre brûlée, un panorama ruiné par de la violence primaire soustraite au politique. Précisément parce que les citoyens et les dirigeants ne sont pas dans un rapport de réciprocité, mais de pure et simple verticalité. Tout le cirque institutionnel n’a d’autre but que de mettre en scène une supercherie politique et d’entretenir l’illusion de réciprocité au travers des élections. La seule réciprocité entre les citoyens et les dirigeants peut potentiellement s’exprimer lors des échéances électorales : si les citoyens ne sont pas contents, nous dit-on, les élus en subiront les conséquences dans les urnes. C’est bien entendu complètement faux, car, même électoralement, le système est imprenable – il est d’ailleurs fait pour ça. La question est dès lors, comment répondre à cette violence et comment réinstaurer du politique ? Il va de soi que, dans la mesure où le politique a été pulvérisé et que les institutions étatiques sont vérolées et illégitimes, nous ne pourrons nous appuyer dessus. Toute symbolisation de la violence est d’emblée exclue par cet état de fait. La conclusion qui s’impose va nous conduire à briser le tabou de la violence – ce qu’on ne peut faire qu’en tremblant, car cela revient à déchaîner l’incontrôlable.
Toute tentative de repolitiser le conflit et de proposer une opposition politique au gouvernement est vouée à l’échec, et surtout au déferlement de violence – pardon, au « maintien de l’ordre ». Un pouvoir illégitime ne tient que par la coercition et un appareil répressif qui ne peut que se durcir à mesure que le peuple prend conscience de cette illégitimité. Dans la mesure où ils évoluent dans un monde apolitique, les dirigeants actuels se condamnent à ne recevoir que des manifestations de violence de la part de leurs opposants. C’est que toute opposition est, pour eux, en elle-même une violence – en rompant la réciprocité du don, ils se placent dans une attitude de refus, donc de violence systématique. Quoi que nous fassions pour nous opposer, nous serons toujours perçus comme violents ; chacune de nos actions, y compris la plus symbolique, sera nommée violente. Nous d’avons, dans ce cas, d’autre choix que d’assumer la violence. Jusqu’à présent, cette conscience était larvée, souterraine, elle s’exprimait parfois de façon paroxystique au cours de mouvements sociaux, mais, à défaut d’être ouvertement formulée, elle engendrait la plupart du temps de la résignation. Mais Macron, en déchaînant le mépris et la violence institutionnelle, semble radicaliser en retour l’exigence du politique chez ses opposants – ce qui est une bonne chose. On ne peut d’ailleurs pas ne pas s’interroger sur les motivations du chef de l’Etat, qui ne pouvait pas ne pas anticiper les « débordements » et la colère. Il a méthodiquement employé les moyens les plus appropriés pour attiser cette colère contre lui et a tout aussi méthodiquement rejeté toutes les voies possibles d’apaisement. Quelles sont ses intentions ? Où veut-il en venir ? On ne peut exclure une volonté délibérée de pourrissement et de généralisation de la violence. Peut-être pour mater le plus férocement possible la contestation et se placer en seul rempart contre le chaos.
Le fait est que si l’on veut réduire les inégalités, il faudra combattre les grandes fortunes ; utiliser des moyens de rétorsion légale pour que les multinationales paient leurs impôts ; exproprier certaines entreprises d’utilité publique privatisées de manière illégitime en les renationalisant ; établir un rapport de force sans précédent avec le capital et toutes ses forces d’appui ; imposer un plus juste partage des richesses entre les actionnaires et les travailleurs ; aller à l’encontre des intérêts égoïstes et rapaces des prédateurs de la finance. Cependant, tout cela implique d’avoir déjà, au préalable, restauré le politique. La tâche immédiate est d’une tout autre ampleur, puisqu’elle vise, précisément cette réinstauration, sans laquelle rien n’est possible. Or, on l’a suffisamment dit, le monde pré-politique est celui de la violence brute à laquelle ne peut répondre qu’une autre violence brute… Le temps n’est plus aux circonlocutions ni aux euphémismes : il s’agit ni plus ni moins que d’une question de vie ou de mort.
Apologie de la violence
Que faire, donc ? Toutes les stratégies pacifistes ont échoué. Tout le monde cite la « bataille culturelle » de Gramsci comme enjeu majeur de la lutte. Il faudrait bouleverser les consciences, il faudrait que les opinions publiques, partout sur la planète, ouvrent les yeux. La bataille culturelle serait l’alpha et l’oméga de la lutte politique. Il faudrait donc multiplier les happenings et les opérations symboliques pour faire trembler les dominants ou conscientiser les masses. Quelle rigolade. Ou bien, il faudrait essayer de « subvertir » les institutions de l’intérieur, par exemple en se faisant élire pour essayer de faire passer nos mesures en contrebande ou d’adoucir la violence du système. Belle réussite. Tout cela a fait preuve de son inefficacité. Cela fait des décennies que ces stratégies sont systématiquement promues comme les seules raisonnables, la destruction accélérée du monde a-t-elle ralentie d’un iota ? Nenni. Pour la simple et bonne raison que ces stratégies supposent l’existence d’institutions politiques.
Nous n’avons alors qu’un seul et terrible mode d’action : la violence. En 1986, Günther Anders annonçait un tournant radical.
« Bon, je veux d’abord […] avouer que, bien que je sois très souvent vu comme un pacifiste, je suis aujourd’hui arrivé à a conviction qu’on ne peut plus rien atteindre avec la non-violence. La renonciation à l’action n’équivaut pas à une action. »[47]
Le philosophe, qui a fait du nucléaire – civile ou militaire – le combat de sa vie, voit que, face à un système si puissant, si armé et si déterminé, les symboles ne sont d’aucune efficacité. Je dirai même, au contraire, toute action symbolique donne l’illusion qu’une lutte politique existe, que par conséquent des forces d’opposition sont possibles et efficaces, que le système est contesté et parfois rudoyé. Il n’en est rien. Mais cela entretien cette idée qu’on peut se contenter, pour lutter effectivement, d’« offrir des bouquets de myosotis aux policiers qui ne pourront pas les recevoir parce qu’ils ont leur matraque à la main »[48] ou de « jeûner contre la guerre nucléaire »[49]. Ce qui fait bien rire les dirigeants politiques et économiques, et surtout les rassure. Tant que le summum de la contestation reste une pot de sauce tomate jeté contre la vitre protégeant une œuvre d’art, les affaires continuent, et avec d’autant plus de facilité.
Toutes ces actions, dis-je, on fait la preuve de leur contre-productivité. Nous sommes entrés dans ce qu’Anders nomme un « état d’urgence » qui nous place dans une situation de « légitime défense »[50]. Cet état d’urgence est écologique et social – la radicalisation autoritaire de Macron nous donne à voir le degré d’urgence qu’il y a à s’emparer de la question politique. « En outre, ajoute Anders, comme la menace est totale et l’anéantissement potentiel global, notre légitime défense doit également devenir totale et globale. Il s’agit d’une guerre défensive de toutes les personnes menacées. »[51] La violence derrière laquelle s’est rangé Anders est donc défensive, mais il n’imaginait sans doute même pas à quel point. La réforme des retraites marque une sorte de nouveau sommet, après les Gilets jaunes, dans la violence institutionnelle. Le passage en force du gouvernement par le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui lui permet de court-circuiter le vote parlementaire pour faire adopter son projet, alors même qu’il est ultra-minoritaire dans la société française, et que les mobilisations sociales ont connu une ampleur inédite depuis des décennies, est une étape supplémentaire dans la radicalisation autoritaire du régime en place. Les citoyens l’ont bien compris. Tout l’enjeu du mouvement social sera désormais, on ne pourra plus fermer les yeux là-dessus, d’assumer la violence – une certaine violence.
Quand on lâche les vannes de la violence (primaire), on s’expose à libérer un flot incontrôlable qui emporte tout sur son passage, y compris ceux qui l’ont déchaîné. On doit donc se préparer à l’inconnu, à l’inconnu radical. A l’imprévisible absolu. La violence ne se maîtrise pas, elle déborde, toujours. Mais nous n’avons plus le choix. L’enjeu, on l’a dit, est ni plus ni moins que notre survie. C’est exactement la situation de l’état de nature décrit par Hobbes, celle de la guerre de tous contre tous. Notre tache la plus importante est alors d’essayer de maîtriser ce qui ne peut pas l’être, afin de diriger le cours impétueux de la violence contre ceux qui nous menacent. Pour cela, il faut politiser au maximum le mouvement social, pour que la violence passe à son stade secondaire. Il nous faut ainsi entrer dans la configuration d’une petite guerre à la Clausewitz, celle qui use de tactique afin de déstabiliser l’ennemi, de le harceler et de le terroriser. Je laisse Anders parler :
« En tout cas, je tiens pour nécessaire que nous intimidions ceux qui exercent le pouvoir et nous menacent (des millions d’entre nous). Là, il ne nous reste rien d’autre à faire que de menacer en retour et de neutraliser ces politiques qui, sans conscience morale, s’accommodent de la catastrophe quand ils ne la préparent pas directement. La simple menace pourrait peut-être déjà, et je l’espère, avoir un effet intimidant. »[52]
Pour que la menace prenne, et ne soit pas vu comme un simple jeu, pour qu’elle soit efficace et produise des effets, il faut qu’elle passe outre ce que Günther Anders appelle le « comme si »[53], c’est-à-dire la simulation presque ludique de la violence mise en œuvre par les militants qui se contentent des happenings. Ce qui fait qu’une menace est perçue comme telle, c’est le fait qu’on croit à la possibilité qu’elle se concrétise et prenne une forme réellement violente à notre endroit. Une pseudo-violence mise en scène et simulée n’est pas une menace, car on sait bien qu’elle n’est que ce qu’elle est. Et c’est le problème de tous ceux qui acceptent de s’opposer jusqu’à un certain point, celui, par exemple, des institutions dites démocratiques. Dès lors qu’on pose par avance les limites de l’action, on cesse d’être menaçant car on devient intégralement prévisible – là ou la menace tire toute sa force, justement, de son imprévisibilité. Il faut donc dans un premier temps menacer nos ennemis, c’est-à-dire leur faire comprendre que la violence qui pourrait s’exercer sur eux n’a aucune limite a priori.
La finalité de la violence à laquelle appelle Günther Anders est sa condition d’acceptabilité. D’ailleurs, poser une finalité à la violence, c’est déjà la politiser, c’est déjà la dialectiser, et le mot est du philosophe lui-même.
« Nous ne recourrons à la légitime défense que dans le but de rendre superflu la nécessité d’y recourir. C’est une ‶dialectique de la violence″, si vous voulez. […] Comme nous n’avons qu’un seul objectif, à savoir le maintien de la paix, nous espérons que nous n’aurons plus besoin de la violence après a victoire (si jamais nous la remportions, ce dont nous devons douter en permanence). Nous ne devons jamais avoir recours à la violence que comme un moyen désespéré, une contre-violence, un expédient provisoire. Car elle n’a d’autre objectif que d’instaurer un état de contre-violence. Aussi longtemps que les puissances établies utiliseront la violence contre nous […] ; aussi longtemps qu’elles chercheront à nous dominer, à exercer une pression sur nous, à nous humilier ou à nous anéantir […], nous serons obligés de renoncer à notre renoncement à la violence pour répondre à l’état d’urgence. »[54]
Très habilement, Anders replace la question de la violence sur le terrain de la légitimité. Pour ce faire, il mobilise l’idée de légitime défense – qui devient alors une légitime violence. Il se place ainsi sur le terrain libéral d’un Hobbes ou d’un Locke, pour qui finalement les individus sont censés renoncer à la violence en vivant en société, dans la mesure où celle-ci leur garantit la sécurité et la sûreté. Il y a chez ces penseurs une vision de la violence originaire (la guerre de tous contre tous), une violence primaire ou ante-politique, à laquelle les individus renoncent parce que la société pourvoit à leur sécurité physique et matérielle (par la protection absolue de la propriété privée). Le philosophe allemand subvertit les catégories usuelles de la théorie politique, ou plutôt, il les prend vraiment au sérieux. En effet, si l’Etat ou les appareils de pouvoir ne garantissent plus la sécurité des citoyens ou pire, mettent cette dernière en péril, alors chaque individu a le droit, voire le devoir, de ne plus renoncer à se protéger par ses propres moyens en se ressaisissant de la violence. En opposant systématiquement un « nous » et un « eux », il tente, d’une certaine manière, de recréer du politique. Il joue en fait sur deux tableaux : la violence primaire que chaque individu doit se réapproprier en renonçant à renoncer à la violence, et la violence secondaire dirigée contre un ennemi extérieur et mise au service d’un objectif précis, à savoir la non-violence, c’est-à-dire l’instauration du politique. C’est ça la dialectique de la violence : nous devons tout d’abord retrouver la violence primaire ante-politique pour ensuite la secondariser politiquement. C’est la seule façon de ne pas verser dans la guerre civile. Le politique apparaît là aussi comme ce qu’il y a de plus important.
L’opposition « eux » et « nous » est alors fondamentale, car ce n’est qu’entre « nous » que peut, dans la situation actuelle, s’instaurer un rapport politique. Quant à « eux », ils récusent le politique, ils rejettent la logique du don maussien. En ce sens, ils sont des ennemis, et non des adversaires, car opposent à toute tentative de symbolisation de la violence une fin de non-recevoir systématique – comme le montrent tous les échecs de mouvements pacifiques de contestation. Entre « nous », la possibilité du politique, donc de la symbolisation puis de la secondarisation de la violence en guerre, et plus spécialement en petite guerre, dirigée contre « eux ». C’est ainsi qu’on échappera au débordement de la violence primaire. En somme, il s’agit de poser le conflit de classe comme seule échappatoire. L’objectif est de s’emparer des institutions politiques établies, qui nous enserrent, et de chasser ceux qui les tiennent actuellement, et qui refusent le politique. L’enjeu, pour ce faire, est de cerner très précisément ceux contre qui il faut diriger la violence, autrement dit les responsables. A moins de cibler notre violence, celle-ci reste en l’air, elle ne menace personne, ou plutôt menace tout le monde. Or, le pouvoir se satisfait d’une violence indécise car il peut, à l’abri et légitimement, y opposer le maintien de l’ordre dont on voit qu’il n’a aujourd’hui, et soutenu par le pouvoir, aucune limite légale.
Notre tâche est alors claire : intimider les responsables politiques (et économiques) de notre sort. Les ministres, les députés traîtres, le Président, les hauts fonctionnaires… C’est eux ou nous. Voilà l’impasse dans laquelle nous a nassé Emmanuel Macron. Face à la violence institutionnelle, comme face à celle du capitalisme qui détruit tout, nous n’avons plus d’autre choix : reformer une communauté politique pour reprendre le pouvoir au mains d’individus illégitimes et dangereux.
[1] https://twitter.com/BFMTV/status/1624075508873846789
[2] https://www.ouest-france.fr/politique/institutions/assemblee-nationale/colere-de-dussopt-seance-suspendue-a-l-assemblee-la-polemique-du-ballon-a-l-effigie-du-ministre-6828c2a8-a952-11ed-8143-2a8717a808f3
[3] https://twitter.com/guillaumegarot/status/1623727272816517121
[4] https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/retraites-une-poupee-elisabeth-borne-pendue-a-marseille-la-macronie-horrifiee_213977.html
[5] https://twitter.com/FCBDeputeduCher/status/1624709705707683843
[6] https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/04/08/97001-20180408FILWWW00063-nantes-le-mannequin-de-macron-pendu-et-brule-choque-les-elus-lrem.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
[7] BAYARD Adrien, DE CAZANOVE Claire, DORN René, « Les mots de la violence », Hypothèses, 2013/1 (16), p. 235-246.
[8] Id.
[9] MICHAUD Yves, Violence et politique, Gallimard, 1978, p. 20, cité in BAYARD Adrien, DE CAZANOVE Claire, DORN René, art. cit.
[10] POIZAT Jean-Claude, « La violence ou la déréliction du pouvoir », Le Philosophoire, 2000/3 (n° 13), p. 43-48.
[11] ANDERS Günther, La violence : oui ou non, Editions Fario, 2014, p. 25, cité par BAYER Osvaldo, « La seule issue est la violence », Tumultes, 2007/1-2 (n° 28-29), p. 239-253.
[12] WEBER Max, Economie et société, Plon, 1971, p. 57.
[13] TROPER Michel, « Le monopole de la contrainte légitime. (Légitimité et légalité dans l’État moderne) », Lignes, 1995/2 (n° 25), p. 34-47.
[14] CLASTRES Pierre, La société contre l’Etat. Recherches d’anthropologie politique, Les Editions de Minuit, 1974, p.5.
[15] Id. p.4.
[16] Id, p. 10.
[17] LORDON Frédéric, Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent…, La Fabrique, 2019, p.104.
[18] Id., p. 134.
[19] LORDON Frédéric, Imperium. Structures et affects des corps politiques, La Fabrique, 2015, cité in MERCIER Geoffrey, Ce que le marché fait au monde. Proposition d’une Garantie Inconditionnelle de Subsistance, L’Harmattan, 2020.
[20] LORDON Frédéric, Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent…, op. cit., p. 134.
[21] Id., p. 135.
[22] MAUSS Marcel, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, PUF, 2012 [1924].
[23] BIANQUIS Gaspard, « Marcel Mauss et la dimension anthropologique de l’échange », Regards croisés sur l’économie, 2018/1 (n° 22), p. 50-53.
[24] MERCIER Geoffrey, Ce que le marché fait au monde. op. cit.
[25] Voir à ce propos CAILLE Alain, Anthropologie du don. Le tiers paradigme, La Découverte, 2007.
[26] Par exemple, on trouvera dans certaines œuvres d’art ou productions culturelles en général d’autres processus de symbolisation de la violence.
[27] CAILLE Alain, op. cit.
[28] CHANIAL Philippe, « Du symbolique au diabolique ambivalences et normativité du don » in CARRÉ Louis (dir.) ; LOUTE Alain (dir.), Donner, reconnaître, dominer : Trois modèles en philosophie sociale, Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2016, pp.85-104.
[29] CAILLE Alain, CHANIAL Philipe, GAUTHIER François, La violence et le mal. Girard, Mauss et quelques autres… Revue du MAUSS semestrielle, 2020, Présentation, p. 17.
[30] Id.
[31] CHANIAL Philippe, « Du symbolique au diabolique ambivalences et normativité du don » art. cit.
[32] ARENDT Hannah, Qu’est-ce que la politique ?, Editions du Seuil, 1995, pp. 108-109.
[33] PICAUD-MONNERAT Sandrine, « La réflexion sur la petite guerre à l’orée du xixe siècle : l’exemple de Clausewitz (1810-1812) », art. cit.
[34] « L’art de la guerre se divise en stratégie et en “grande tactique”[…], et la petite guerre est une partie de cette grande tactique », PICAUD-MONNERAT Sandrine, « La réflexion sur la petite guerre à l’orée du xixe siècle : l’exemple de Clausewitz (1810-1812) », art. cit.
[35] Id.
[36] Id.
[37] Bien entendu, l’opposition intérieur/extérieure est ici commode mais gare à ne pas la prendre trop au sérieux non plus. La guerre dirigée contre une puissance étrangère peut être l’occasion d’un déchirement du corps social, tout comme une guerre civile peut être appuyée, de l’extérieur, par des forces concurrentes. Tout cela est poreux.
[38] GRANGE Ninon, « L’état de nature, modèle et miroir de la guerre civile », Astérion [Online], 2|2004.
[39] Id.
[40] AGAMBEN Giorgio, op. cit., p. 22.
[41] Id.
[42] Id., p. 23.
[43] Emmanuel Macron, mars 2019, lors du Grand débat national, à Gréoux-les-Bains.
[44] Voir le travail décisif de David Dufresne sur les violences policières. Par exemple : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/qui-detient-le-monopole-de-la-violence-avec-david-dufresne-et-alain-bauer-2293299
[45] Bien sûr, je ne nie à aucun moment qu’il y ait des violences au sens premier du terme lors des manifestations. En revanche, je pointe du doigt le fait que des violences symboliques soient traitées de la même manière que des violences physiques.
[46] Emmanuel Macron, 24/07/2018. https://www.marianne.net/agora/les-signatures-de-marianne/qu-ils-viennent-me-chercher-le-bras-d-honneur-de-macron-dans-l-affaire-benalla
[47] ANDERS Günther, op. cit., p. 21.
[48] Id., p 22.
[49] Id., p. 22.
[50] Id. p. 75.
[51] Id. p. 75.
[52] Id., p. 22-23.
[53] Id., p. 82.
[54] ANDERS Günther, op. cit., p. 85-86.
Ultime précision : la violence dont il est fait ici l’apologie, est bien entendu, comme le lecteur l’aura sans l’ombre d’un doute compris, une violence politique, en aucun cas un appel au lynchage, ni au meurtre, ni à l’atteinte physique aux personnes.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)

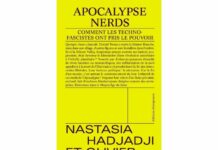


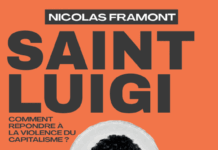



![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)









L’idéal néo-libéral, c’est la grande nursery. Il s’agit de parquer la population dans des feed-lots avant l’abattoir des EHPAD. Tout cela, dans une ambiance sirupeuse digne du « Meilleur des Mondes ». Huxley avait bien mieux compris qu’Orwell ce qui allait advenir de nous: un bétail drogué aux hormones de la « happycratie ». Sorel, relève-toi, ils sont devenus… mous!