Aya, Edith et les autres…
Guy Debord aux Jeux Olympiques
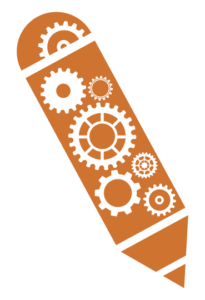 Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront un fiasco pour la France, médiatisé par toutes les télévisions et les journaux du monde. Sur tous les plans : Paris, la « plus belle ville du monde » est dégueulasse à en pleurer, les transports en commun sont déjà sursaturés et ne sont absolument pas prêts, tout comme la sécurité des milliers et millions de touristes qui déferleront pour assister à cette grand-messe du sport mondial. Nous aurons le privilège de les voir se faire dépouiller en mondovision, quelle satisfaction insigne. Etudiants et sans abris sommés d’aller se faire voir ailleurs, parisiens invités à ne pas sortir de chez eux, rats (pardon : surmulots) se faufilant entre les trépieds des caméras… Le désastre est annoncé. La France sera, cela ne fait aucune doute, la risée du monde. Macron et Hidalgo seront responsables de ce qui apparaîtra comme un échec prévisible et cuisant, mais déploieront des trésors de rhétorique et de contorsions pour nous démontrer que ces JO auront été un succès incontestable – grâce à eux bien évidemment[1]. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il fallait ajouter le ridicule à la catastrophe. La nouvelle a fuité, et a fait grand bruit : Macron souhaite, pour la cérémonie d’ouverture, qu’Aya Nakamura, surnommé la « Queen »[2], interprète une chanson d’Edith Piaf – qu’il faudrait, j’imagine renommer la « Kid »[3]. Aussitôt, le monde culturel, journalistique, médiatique et politique – autrement dit : le Spectacle – se mit en ébullition : chacun d’y aller de la condamnation ou de son admiration. Dans le camp des admirateurs (souvent à gauche), c’est à qui en ira du superlatif le plus flatteur.
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront un fiasco pour la France, médiatisé par toutes les télévisions et les journaux du monde. Sur tous les plans : Paris, la « plus belle ville du monde » est dégueulasse à en pleurer, les transports en commun sont déjà sursaturés et ne sont absolument pas prêts, tout comme la sécurité des milliers et millions de touristes qui déferleront pour assister à cette grand-messe du sport mondial. Nous aurons le privilège de les voir se faire dépouiller en mondovision, quelle satisfaction insigne. Etudiants et sans abris sommés d’aller se faire voir ailleurs, parisiens invités à ne pas sortir de chez eux, rats (pardon : surmulots) se faufilant entre les trépieds des caméras… Le désastre est annoncé. La France sera, cela ne fait aucune doute, la risée du monde. Macron et Hidalgo seront responsables de ce qui apparaîtra comme un échec prévisible et cuisant, mais déploieront des trésors de rhétorique et de contorsions pour nous démontrer que ces JO auront été un succès incontestable – grâce à eux bien évidemment[1]. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il fallait ajouter le ridicule à la catastrophe. La nouvelle a fuité, et a fait grand bruit : Macron souhaite, pour la cérémonie d’ouverture, qu’Aya Nakamura, surnommé la « Queen »[2], interprète une chanson d’Edith Piaf – qu’il faudrait, j’imagine renommer la « Kid »[3]. Aussitôt, le monde culturel, journalistique, médiatique et politique – autrement dit : le Spectacle – se mit en ébullition : chacun d’y aller de la condamnation ou de son admiration. Dans le camp des admirateurs (souvent à gauche), c’est à qui en ira du superlatif le plus flatteur.
Petit florilège : le député Antoine Léaument de la France Insoumise, bien colère nous prévient. « La raison pour laquelle des gens ne veulent pas qu’Aya Nakamura chante Édith Piaf est simple. Ça s’appelle le racisme. Aya Nakamura a fait plus pour le rayonnement de la France à l’étranger que ceux qui s’opposent à ce qu’elle continue à le faire. »[4] Il en rajoute une couche lorsqu’il répond à un Twittos qui énonce l’absence de talent manifeste de la dame : « Sans talent ? Aya Nakamura est la chanteuse francophone la plus écoutée au monde. »[5] Être écoutée est synonyme de talent, nous y reviendrons. Le journaliste Pablo Pillaud-Vivien, en pleine extase, livre une analyse guère différente de l’affaire Aya : « y’a juste 3 vieux reacs qui ne bittent [sic] rien à la musique qui essaient de faire chier le monde »[6]. Ne pas aimer la Queen c’est donc être raciste, réac et ne rien connaître à la musique. L’extase se transforme en orgasme : « contrairement à certains textes de Brel ou même Piaf qui, lorsqu’on les lit, montrent parfois toute leur vacuité, Aya Nakamura, ça reste puissant »[7]. « J’suis pas ta catin Djadja, genre, en catchana baby, tu dead ça »[8] Voilà qui est bien plus puissant que la vacuité d’un « il est, paraît-il / des terres brûlées / donnant plus de blé / qu’un meilleur avril »[9]. Bien sûr, Sandrine Rousseau fut au rendez-vous : « Aya Nakamura est une grande. Derrière la minorisation de son talent, il y a des relents racistes. »[10] Arrêtons là.
Chez les contempteurs, on n’est guère plus finaud : les réacs authentiques et autres racistes de dénoncer les origines maliennes, la naturalisation tardive, la couleur de peau, la jeunesse à Aulnay-sous-Bois… Ces exhalaisons droitardes, minoritaires mais indignes, ne doivent pas, sans les ignorer pour autant, nous interdire tout esprit critique. Il va de soi que, n’ayant pas abdiqué tout discernement, j’estime que la « musique » d’Aya Nakamura, c’est de la merde[11], mais ce n’est pas tant sur ce terrain que je souhaite me situer ici. Avant tout, il faut souligner que, la décision de Macron tout comme la polémique qui s’ensuit, appartiennent au Spectacle, en sont des émanations et n’ont d’autre effet que de l’entretenir. Cela fait tourner la machine à dépolitisation, à fracturation et à atomisation. Macron, ses détracteurs et ses admirateurs participent au Spectacle libéral destructeur, pire, ils ne vivent que par lui – sans lui ils disparaissent dans leur propre néant[12]. De sorte qu’on a tort de fustiger la « politique-spectacle », comme s’il en allait là d’un simple excès voire d’une exception, comme si « le spectacle [n’était] rien d’autre que l’excès du médiatique »[13]. Il n’y a pas de politique-spectacle : il n’y a, en fait, que du spectacle et rien d’autre : il n’y a plus aucune différence, du point de vue réel, entre Macron et Nakamura. Qui de plus logique, dès lors, qu’Aya Nakamura, sorte de personnalisation, d’incarnation du Spectacle – et du néant ?
Il faut ici déployer ce concept hérité de Guy Debord[14] pour comprendre ce qui se joue. Ma critique, en effet, ne porte pas tant sur la personne médiatique ni sur la « musique » d’Aya Nakamura, il ne s’agit pas pour moi de démontrer en quoi tout cela n’est que supercherie. Il suffit, du reste, d’écouter froidement « Nakamura, t’es trop chiante / Tu fais que de me provoquer »[15], pour le comprendre, tout commentaire étant superflu. Non seulement superflu, tout commentaire participe du spectacle qu’il entendrait démonter. Il ne faut pas s’escrimer à analyser, à décortiquer la musique d’Aya Nakamura, c’est rentrer dans la logique spectaculaire, c’est, d’une certaine manière, lui faire trop d’honneur, l’élever à un rang qui n’est pas le sien. Une merde de chien dans la rue, ça ne s’analyse pas, ça s’évite. On ne cherche pas à prouver la merde, on la reconnaît et on s’en écarte. Ce qu’on dit des « textes »[16] de Nakamura, cependant, on pourrait tout autant l’appliquer à ses « musiques » : même boîte à rythme sur la dizaine de titres que je me suis infligés, mêmes aplats d’harmonies mièvres en fond sonore, sans aucune progression musicale, même utilisation du vocodeur partout, des voix qui popent ça et là pour remplir l’espace sonore comme autant de borborygmes synthétiques, même la ligne de chant ne propose aucune mélodie (ni, cela va de soi, aucune anti-mélodie[17])… Les arrangeurs font preuve d’une paresse créative à faire pleurer. Une boucle de boîte à rythme préfabriquée tourne pendant un peu moins de trois minutes environ, on y ajoute deux ou trois nappes harmoniques, le tour est joué : plus qu’à laisser faire la Queen.
A nouveau, toute critique de cette musique, au sens de la critique d’art, est déjà du Spectacle, ce que, précisément, nous devons refuser. Le Spectacle est « à la fois le résultat et le projet du mode de production existant »[18], il est ce que produit et vise en même temps le capitalisme, sa « vision du monde qui s’est objectivée »[19]. Le Spectacle manipule tous les signes de la production, il les diffuse, les impose, les met en scène… ou plutôt : ces signes deviennent la réalité même car la réalité devient ensemble de signes. Comme le dit dans une formule déterminante Guy Debord : « la réalité surgit dans le spectacle, et le spectacle est réel »[20]. Par lui, il y a fusion (unification dans le langage de Debord) et séparation en même temps, toute réalité vécue étant diffraction du spectaculaire. Puisqu’il sature tout, puisqu’il est tout, il est la réalité même, une réalité produite, certes, mais dont on ne peut se décoller car « les simples images deviennent des êtres réels »[21], ce qui conduit à identifier image, réalité puis désir et enfin vérité. Cette dernière finit donc par s’effacer, ce qui conduit où nous en sommes très exactement : la vérité n’est plus un critère, elle s’est dissoute dans le grand bain du spectacle et de la marchandise. « Le monde à la fois présent et absent que le spectacle fait voir est le monde de la marchandise dominant tout ce qui est vécu »[22], le monde du Spectacle n’est autre que la vision d’un monde devenu marchandise, à la fois comme agrégat de marchandises dispersées et comme rapport au monde devenu rapport marchand. Pour dire les choses simplement : tout devient marchandise. Le Spectacle est ce qui apparaît, ce qui se donne à voir quand les seules choses à voir sont des marchandises : le journalisme, la culture, la politique, l’art, la nature… C’est le triomphe absolu du marché : tout est marchandise, passé par la moulinette spectaculaire. « La marchandise s’absolutise, elle remplit le monde, le sature. L’unité, est le principal effet, paradoxal, du marché, construit comme instrument de neutralisation. Le premier mouvement du marché fait tout éclater, il disperse l’unité en une myriade d’atomes ; le second recompose le monde en une sorte de synthèse impossible, la synthèse de toutes les marchandises, à commencer par les marchandises que nous sommes. »[23]
Lorsqu’on fait la critique d’un élément du spectacle, dont la musique d’Aya Nakamura – à mettre en cela presque sur le même plan qu’un discours de politique générale prononcé par un quelconque Premier ministre – on joue son jeu, avec ses propres règles. « En analysant le spectacle, on parle dans une certaine mesure le langage même du spectaculaire »[24] dit Debord, on n’a d’autre choix que de le saisir tout uniment, en bloc. En isoler des fragments, les discuter, débattre de leur plus ou moins grande intégration au spectacle revient à pratiquer sa méthode : celle de la séparation. C’est ici le premier point que je tenais à soulever : entrer dans la polémique – stérile – au sujet d’Aya Nakamura chantant Piaf suite à la demande du Président Macron, c’est empiler le spectaculaire sur du spectaculaire.
Il est pourtant étrange – mais c’est un faux étonnement de ma part – de constater que ce soit, de façon générale, la gauche qui défende la Queen – souvent, au passage, en dénigrant Piaf, Bref ou Brassens, qui n’avaient pourtant rien demandés. Cette gauche s’en vient à se ranger du côté du Spectacle, de la marchandise, donc de la vision du monde capitaliste[25]. Parce qu’il faut tout de même dire qu’au-delà même de la « puissance », pour reprendre le mot de Pillaud-Vivien, de ses textes, Nakamura véhicule à peu près toutes les valeurs capitalistes. Ici, le mot « valeur » est à prendre au sens de la valeur, monétaire, presque, d’une marchandise. Voyez les clips, lisez les textes, partout on y voit l’éloge : du bling-bling, de la compétition généralisée (compétition des femmes pour posséder les « boug »[26] le plus souvent), de la self-made-woman[27], de la thune, de la femme-objet, de la réussite par le fric, du mépris pour la culture, de l’égoïsme[28]… bref les bonnes grosses valeurs de gauche n’est-ce pas ? L’imaginaire libéral tout craché. Et c’est ce qu’il faudrait ériger en modèle… Les arguments utilisés pour la défense de Nakamura – en écartant les divagations énamourées sur la puissance de ses textes – tournent peu ou prou autour du même thème : son succès. On se donne un faux air populo en s’extasiant devant une artiste « populaire ». Il faudrait d’ailleurs regarder en détail cette affirmation, car en réalité, à l’inverse de la popularité d’un Johnny, Aya Nakamura n’est populaire que parmi son public et son cœur de cible, atteint essentiellement via les réseaux sociaux. Autrement dit, si Nakamura est l’artiste la plus écoutée sur les plateformes, c’est uniquement par un groupe clôt qui ne déborde quasiment pas. Or, précisément, ce qui fait qu’un artiste est populaire (au sens du peuple), c’est le fait qu’il « déborde », qu’il soit connu au-delà de son public par une très large proportion de la population. Il faudra vérifier cela de près s’agissant d’Aya Nakamura, mais je peux facilement hasarder que tel n’est pas le cas. Mais surtout, derrière cet argument, il y a toujours l’idée que la « valeur » de la chanteuse, ce qui prouve qu’elle une grande au même titre que Piaf, c’est cette « popularité », le fait qu’elle soit très suivie sur les réseaux sociaux et très écoutée sur les plateformes. C’est une grande artiste, la preuve, elle vend beaucoup de disques, elle fait beaucoup de vue sur Youtube et elle est très téléchargée sur Spotify. Ainsi, la « valeur » artistique d’Aya est une antivaleur : le marché, la loi de l’offre et de la demande. Les critères du beau sont dès lors purement quantitatifs, mercantiles, algorithmiques, computationnels et spectaculaires. Dans le Spectacle, du moins est-ce la promesse qui est faite, « ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît »[29] écrivait Debord. Il s’opère une sorte de platonisme renversé. Lorsque le Grec posait cette équation folle entre le bien, le beau, le juste et le bon, il situait tout cela dans le ciel des Idées pures, c’est-à-dire dans ce qui n’apparaît et ne se manifeste jamais car étant pure idéalité, tandis que le Spectacle affirme que l’apparition – d’une marchandise, d’une star, d’un discours, d’une image etc. – réalise cette équation, et que par elle se manifeste le vrai, qui est identique au juste, au beau et au bon. Cela va plus loin, en réalité ce sont les termes mêmes de l’équation qui disparaissent : il n’y a plus de bon, de vrai, de juste, de beau. L’apparition spectaculaire, dans la mesure où, contrairement aux Idées platoniciennes, elle se manifeste concrètement, finit par recouvrir puis à dissoudre les anciennes valeurs, l’apparition devient dès lors une valeur en tant que telle, la seule. Aya apparaît partout ce qui, pour le Spectacle, démontre ainsi la valeur et la qualité de son œuvre.
Une confusion assez terrible au regard des analyses de Blaise Pascal. N’oublions pas que le philosophe nous disait que la confusion des ordres conduit à la « tyrannie »[30], c’est son propre mot. Chaque ordre (le beau, la science, l’amour, la force, le pouvoir, le vrai etc.) possède des critères propres à l’aune desquels on juge l’adéquation de tel ou tel objet ou action. Mais lorsqu’on dit que telle chose est belle (qu’elle possède une haute valeur artistique) parce qu’elle est soi-disant populaire ou qu’elle apparaît en masse, on confond tous les critères. C’est l’un des effets du marché (néo)libéral généralisé et de ses incarnations spectaculaires : tout corroder, tout corrompre, tout confondre, tout fondre dans le grand bain d’acide de la marchandise et de l’argent. Ce mouvent annihilateur, Bernard Stiegler lui donne un nom : la disruption[31]. Le marché bouscule tout, tout le temps, et à une vitesse telle que rien ne peut plus se resolidifier après avoir été abattu. « La disruption est ce qui va plus vite que toute volonté, individuelle aussi bien que collective »[32]. Détruisant les valeurs, les critères de jugement, les formes de socialité, les modes d’organisation, les institutions, l’économie… le marché va si vite qu’il ne laisse même pas le temps à de nouvelles valeurs, de nouveaux critères, de nouvelles formes de socialité etc., d’émerger et de se stabiliser. Et c’est précisément cela la disruption. Des critères doivent nécessairement, pour être opératoires, et surtout valoir à l’échelle collective, avoir une certaine stabilité, une certaine fixité. Ils ressortissent de ce que Barbara Stiegler appelle la « stase » opposée au « flux » vanté par Macron et le marché[33]. La destruction des critères est largement le fait de la disruption engendrée par le marché, mais elle est aidée en cela par l’idéologie progressiste actuelle, qui est en fait l’aile sociétale du libéralisme, qu’on appelle vulgairement le « wokisme »[34]. Celle-ci se satisfait pleinement de la disparition du beau, du vrai, du bon, du juste, au nom d’un relativisme de bon ton. Lorsqu’il n’y a plus de critères de jugement, on peut mettre sur le même plan « Je joue avec le fuego / Il veut qu’on danse le mambo / Il voudrait qu’on reste amigos / Il m’a dit hasta luego »[35] et « Tous les somnambules, tous les mages m’ont / Dit sans malice / Qu’en ses bras en croix, je subirai mon / Dernier supplice »[36]. Aya devient supérieur à Georges ou Edith en talent et en « puissance ».
« La disruption », écrit Bernard Stiegler, « est l’époque de l’absence d’époque, qui fut annoncée et pressentie […] comme ‶nouvelle forme de barbarie″ par Adorno et Horkheimer »[37]. Nous vivons cette barbarie, analysé déjà par l’école de Francfort à la fin des années 1940. Lorsqu’ils écrivent sur l’industrie culturelle, Adorno et Horkheimer sont pourtant loin du devenir ayanakamuresque de cette industrie. Néanmoins, ils en pressentent la dégénérescence fulgurante, sous les coups de boutoir du marché. « Ce qui est nouveau », écrivent-ils, « ce n’est pas que l’art est une marchandise, mais qu’aujourd’hui, il se reconnaisse délibérément comme tel, et le fait qu’il renie sa propre autonomie en se rangeant fièrement parmi les biens de consommation confère son charme à cette nouveauté. »[38] Quelques années plus tard, Adorno enfonce le clou : « Les productions de l’esprit dans le style de l’industrie culturelle ne sont plus aussi des marchandises mais le sont intégralement. »[39] Adhérer sans réserve aux productions de l’industrie culturelle la plus achevée, c’est se noyer dans le monde de la marchandise, dans la marchandise devenue monde, ce qui est la définition même du Spectacle. A ce niveau-là, l’œuvre perd sa relative autonomie, qui faisait qu’elle était, au moins en droit ce ni n’est en fait, pensable en dehors de l’industrie culturelle, en dehors du capitalisme, en dehors du Spectacle. Mais les « œuvres » d’Aya Nakamura n’ont aucune existence propre si on les extrait de leurs conditions de création et de diffusion, l’industrie culturelle, les réseaux sociaux, l’imaginaire libéral, etc. Elles n’ont, en bref, aucune existence propre en dehors du marché – pris comme rapport social. Nous en sommes au stade où « la publicité devient l’art par excellence »[40]. Aussi ne faut-il pas s’étonner lorsque la Queen chante, en guise de refrain : « Nous, c’est le goût »[41], phrase qui n’est autre que le slogan bien connu d’une enseigne de fast-food. La publicité et « l’art » se rejoignent au point de se confondre, on ne sait même plus les distinguer. La diffusion massive des productions de l’industrie culturelle, soustraite à tous critères de jugement, fait de nous des « nouveaux barbares »[42] ayant perdus nos facultés noétiques, nos désirs, nos projets, notre singularité.
Aya Nakamura est sans doute l’une des incarnations les plus abouties de tout cela. Elle n’est qu’un pur produit – au sens du machin « élu produit de l’année » – du libéralisme roi. Le fait qu’elle soit à ce point « populaire », avec toutes les limites que nous avons dites plus haut, témoigne d’une dégénérescence inquiétante de nos sociétés. Nakamura, mais c’est vrai de beaucoup d’autres – Jul, Gims par exemple, Vianney à sa manière etc. –, n’est que le nom d’une maladie collective. Cette maladie que Bernard Stiegler a parfaitement décrit comme « la destruction des rétentions et des protentions psychiques et collectives »[43], autrement dit la dislocation des individus et des sociétés, de leur mémoire et de leurs projets.
Pour en revenir aux Jeux Olympiques, bien sûr, on l’a dit, ce sera un revers cinglant pour la France. Je ne parle bien sûr par des performances sportives. Or, il y a peut-être, dans ces performances, précisément, quelque chose qui échappe encore un peu à la marchandise. Bien que les JO soient l’une des manifestations du sport-spectacle, le dépassement de soi des athlètes, leur abnégation, leurs sacrifices portent au plus profond quelque chose d’irrécupérable pour le marché : la gratuité. L’acte sportif est accompli en pure perte, pour rien d’autre que lui-même. Tout comme l’œuvre d’art, l’œuvre sportive est un don à tous les sens du terme. Don de soi mais aussi don, peut-être inné, qu’on cultive et qu’on fait fructifier, don d’émotion, don sacrificiel. Parce qu’il est imprévisible et non maîtrisable malgré tous les efforts les entraîneurs, des équipes et des sponsors, le sport reste pour le moment une parenthèse d’inappropriable. Il reste un bastion du don maussien, un fortin assiégé qui, déjà, voit ses murailles se fissurer de toute part. Vanter Aya Nakamura chantant du Edith Piaf à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, c’est ériger en modèle ce que le sport combat de toutes ses forces – tout comme l’art. Quelle ironie finalement.
Notes
[1] Il sera néanmoins drôle de les voir se rejeter la faute de « ce qui n’a pas marché » – selon la formule présidentielle – les uns sur les autres.
[2] Surement une façon de faire « rayonner » la langue française.
[3] Vous comprenez, la « môme » c’est dépassé, c’est la France rance.
[4] https://twitter.com/ALeaument/status/1763925787466490107
[5] https://twitter.com/ALeaument/status/1763962233392922882
[6] https://twitter.com/ppillaudvivien/status/1764018566792159375
[7] https://twitter.com/ppillaudvivien/status/1764263965117288719
[8] Nakamura Aya, « Djadja », Nakamura, Le Side, 2018.
[9] Brel Jacques, « Ne me quitte pas », La valse à mille temps, Philips, 1959.
[10] https://twitter.com/sandrousseau/status/1764331015605023080
[11] Je vous renvoie à mon article « La gadgetisation du monde » pour cerner ce que j’entends par « merde », c’est-à-dire cet avatar du gadget, dont finalement le gadget culturel n’est qu’une déclinaison parmi d’autres. Aya Nakamura illustre bien ce que je décris en parlant de cela.
[12] Je vous renvoie à Bernat Harold, Le néant et le politique Critique de l’avènement Macron, L’Echappée, 2017
[13] Debord Guy, Commentaires sur la société du spectacle [1988], in Œuvres, Quarto Gallimard, 2006, p. 1596.
[14] Debord Guy, La société du spectacle [1967], in Œuvres, Quarto Gallimard, 2006, p. 765.
[15] Nakamura Aya, « Le goût », DNK, Warner Music France, 2023.
[16] J’ai toujours trouvé très drôle d’imaginer que quelqu’un puisse sérieusement se poser à une table, devant une feuille de papier, un crayon à la main, et se creuser la tête, congestionné par l’intense réflexion, avant d’écrire : « J’ai taffé toute la nuit / J’vais rider toute la night / […] / J’arrive dans ma tchop, tchop, tchop / Toi t’es dans le flop, flop, flop » (« Tchop », Aya, Warner Music France, 2020), « Mais qui est la plus bonne bonne bonne de mes copines ? / Ah, mes copines, ah, mes copines » (« Copines », Nakamura, Warner Music France, 2018) « J’l’ai senti (j’l’ai senti) j’ai senti de loin sans mentir / On peut pas se fâcher, j’ai senti ce que t’as senti » (« Baby », DNK, Warner Music France, 2023) ou encore « J’ai la mentale [sic], la vision, bien sûr / C’est quoi les bails ? Chéri, c’est quoi les bails ? / C’est quoi la suite ? Eh vas-y, c’est quoi les bails ? » (« Biff », Aya, Warner Music France, 2020). La meilleure réaction face à cela, la plus saine et politiquement créatrice, c’est effectivement le rire.
[17] N’oublions pas que d’excellents musiciens ont cherché à se défaire des codes de la mélodie, de l’harmonie etc. La musique minimaliste de John Cage, bien sûr, la musique de l’atonalité portée par Schönberg ou Berg, la musique répétitive de Glass… tout cela, entre autres, a remis en question les fondements de la musique traditionnelle. Nous ne sommes, est-il besoin de le préciser ?, pas dans ce cas de figure. Ces génies maîtrisaient leur art à la perfection, maîtrise qui est la condition de son dépassement. Je ne sache pas que Nakamura maitrise le style rimbaldien ou proustien en vue de le dépasser.
[18] Debord Guy, La société du spectacle, op. cit., §6, p. 767.
[19] Id., §5, p. 767.
[20] Id., §8, p. 768.
[21] Id., §18, p. 770.
[22] Id., §38, p. 777.
[23] Mercier Geoffrey, Ce que le marché fait au monde. Proposition d’une garantie inconditionnelle de subsistance, L’Harmattan, 2020, p. 124.
[24] Debord Guy, La société du spectacle, op. cit., §11, p. 768.
[25] Faux étonnement en effet, c’est toute la thèse d’un Jean-Claude Michéa : la gauche est un avatar du libéralisme. Le libéralisme, originellement opposé aux forces conservatrices et au pôle socialiste, s’est par la suite diffracté en un versant économique, pris en charge par la droite, et un versant culturel, assumé par la gauche. La synthèse des deux étant parfaitement représentée par le macronisme, cet épisode ayanakamuresque n’en est qu’un énième témoignage de plus.
[26] « Tu voulais me comparer aux autres / Mais moi, c’est le haut niveau / Bam bam, le boug est love / Le plan c’était s’enjailler » (« Haut niveau », DNK, Warner Music France, 2023).
[27] « J’fais mon biff et j’me débrouille toute seule / Ce que j’ai, je l’ai gagné toute seule » (« Biff », Aya)
[28] « J’suis égoïste, question de survie » (« Tchop », Aya)
[29] Debord Guy, La société du spectacle, op. cit., §12, p. 769.
[30] Pascal Blaise, Pensées, §58 (Lafuma),
[31] Stiegler Bernard, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ?, Les liens qui Libèrent, 2016.
[32] Id., p. 24.
[33] Stigler Barbara, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, NRF Essais, 2019.
[34] Je redis ici à quel point je m’oppose à ce terme fourre-tout, repris largement par la droite et l’extrême droite CNews,, essentiellement destiné à discréditer un mouvement de pensée très disparate, très divers, très peu unifié, en y mélangeant des productions scientifiques et universitaires, des saillies médiatiques, des tweets anonymes, des happenings, etc. Ce mot masque souvent un anti-intellectualisme forcené, très répandu à droite, ainsi qu’une défense tout aussi acharnée des valeurs et des modes de vie bourgeois.
[35] Nakamura Aya, « Fuego », Journal intime, Parlophone, Warner, 2017.
[36] Brassens Georges, « Je me suis fait tout petit », Je me suis fait tout petit, Philips, 1956
[37] Stiegler Bernard, Dans la disruption, op. cit., p. 35.
[38] Adorno Theodor, Horkheimer Max, Kulturindustrie. Raison et mystification des masses, [1947], trad. Eliane Kaufholz, Allia, 2019, p. 85.
[39] Adorno Theodor, L’industrie culturelle. Conférence de 1962 in Communications, 3, 1964, pp. 12-18
[40] Adorno Theodor, Horkheimer Max, op. cit., p. 98.
[41] Nakamura Aya, « Le goût », DNK, Warner Music France, 2023.
[42] Stiegler Bernard, Dans la disruption, op. cit., p. 67.
[43] Id., p. 53.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !
par
le



![[Billet d’humeur] La gadgetisation du monde](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2023/06/e.jpg)








![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)

