
Saint Luigi
Comment répondre à la violence du capitalisme ?
Nicolas Framont
Les Liens qui Libèrent, 2025
L’affaire a fait grand bruit, le 4 décembre 2024, le richissime PDG d’une grande compagnie d’assurance était froidement abattu en plein New York. Le suspect, un jeune homme séduisant à l’air serein, est immédiatement considéré, par une large partie de la population américaine – et au-delà – comme un héros, malgré l’acte au plus haut point transgressif dont on l’accuse. Comme si l’aversion légitime qu’inspire la victime gommait la violence du geste, voire la justifiait. Luigi Mangione, meurtrier présumé, héros des temps moderne promis à la peine capitale s’il est reconnu coupable, pourrait alors devenir un martyre, un saint. Saint Luigi s’interroge sur cette affaire et sur ce qu’elle dévoile d’un nouveau rapport à la violence qui semble se faire jour et sur la « nouvelle donne du rapport de force entre dominants et dominés » qui pourrait annoncer « un nouvel âge d’or de la révolte » (p.24).
Coup de tonnerre : un PDG assassiné, un ultra riche trucidé, un bourgeois révolvérisé, un grand patron exécuté, un capitaliste liquidé, un fortuné zigouillé. Un intouchable dominant, au plus haut dans l’échelle de l’humanité libérale, s’est fait descendre. Ses collègues de trembler de peur et tous les milieux d’affaire de se barricader. L’impensable est arrivé : un dominé a renversé la table et s’en est pris physiquement à un dominant – crime suprême. Et pas n’importe quel dominant : le PDG d’une des plus grandes compagnies américaines d’assurances privées, celles qui portent quotidiennement la responsabilité de dizaines, centaines et milliers de morts en ne prenant pas en charge financièrement des soins médicaux indispensables. Pourtant, « Luigi Mangione, Américain d’origine italienne, diplômé d’une université prestigieuse […] n’a pas le profil qu’on attend d’un homme capable de tirer deux balles sur un PDG. Il est aisé, bodybuildé, l’air insouciant et ce qu’il montre de lui et de sa vie respirent une forme de naïveté et d’hédonisme. Aucun lien ne peut être fait entre ce suspect et une quelconque organisation militante. Il est le loup solitaire, l’anomalie sociologique, le bug dans la matrice. » (p.17) Et peut-être est-ce justement ce qui a fait trembler le monde capitaliste. Pour comprendre l’acte en apparence fou imputé à Mangione, et ses répercussions sociales, car telle est l’ambition de Saint Luigi, il est indispensable de s’appesantir sur la victime, Brian Thompson.
Les Etats-Unis ont, on le sait, un système de santé particulièrement injuste et inefficace (pour les citoyens, pas pour les assureurs) : espérance de vie, mortalité infantile, mortalité prématuré, mortalité maternelle, maladies chroniques, les Etats-Unis sont parmi les pires des pays développés sur tous ces indicateurs, avec pourtant un coût individuel par citoyen parmi les plus élevés. Cette gabegie est en grande partie due au modèle d’assurance maladie basé sur l’assurance privée et non sur la sécurité sociale collective. Et le désastre est largement entretenu par les assureurs eux-mêmes qui font tout pour ne pas prendre en charge les soins de leurs assurés qui paient pourtant le prix fort pour cela. Un véritable système organisé de refus de prise en charge a été largement documenté aux Etats-Unis, aboutissant à des milliers de faillites individuelles de personnes ne pouvant payer les frais de soins ou d’autres milliers de morts, de vies mutilées, de familles brisées. Dans ce système, Brian Thompson jouait un rôle particulièrement abject en tant que PDG de la pire compagnie d’assurance, United HealthCare qui, pour engraisser ses actionnaires et ses dirigeants, rejetait 29% des demandes de prises en charge en 2024 au moyen d’algorithmes, de consignes explicites de refus, de campagnes de déshumanisation… Autrement dit, Brian Thompson et tous les actionnaires d’United HealthCare doivent leurs fortunes aux « invalidités à vie, [aux] pertes de chance de survie et [aux] décès des milliers de patients à qui des soins postopératoires ont été refusés » (p.15). En d’autres termes, le tueur de Brian Thompson a rayé de la surface de la Terre un individu responsable (indirectement) de la mort de dizaines voire centaines de milliers d’êtres humains. « Il a mis de façon brutale, morbide et vengeresse le PDG de United HealthCare face à ses responsabilités. » (p.53)
Peut-être est-ce qui explique, en partie, l’indulgence voire la sympathie, quand ce ne fut pas le soutien explicite, qu’a inspiré Luigi Mangione lors de son arrestation. Dans les médias américains, dans la rue, sur les réseaux sociaux, des milliers de messages de soutiens déferlent. C’est que les citoyens américains sont confrontés jour après jour aux difficultés d’accès aux soins et à la précarité sanitaire, ils expérimentent parfois dans leur chair les conséquences des directives agressives d’un PDG de compagnie d’assurance privée. Face à cela, la compassion ne va pas à la victime, mais à celui perçu comme un vengeur, un justicier obligé de se sacrifier – Saint Luigi risque la peine de mort – pour dénoncer les dérives d’un système meurtrier et faire trembler ses instigateurs, ses exécutants et ses soutiers. Mais il y a plus. Le soutien populaire dont bénéficie Luigi Mangione malgré la brutalité de son geste tient aussi, montre Nicolas Framont, a sa personne elle-même : physique de play-boy au torse musclé qui s’étale sur les réseaux sociaux, fils de bonne famille ayant obtenu un bon diplôme, un « garçon ordinaire » (p.102) de 27 ans au moment des faits qui « avait tout pour lui » (p.103). Bref, le jeune homme auquel on s’identifie. Mais une normalité effrayante. « Effrayant car si Luigi Mangione est aussi ordinaire que cela, combien d’autres jeunes gens ordinaires pourraient agir de la sorte ? » (p.104) Saint Luigi pourrait inspirer d’autres jeunes gens « normaux » et « ordinaires » de la classe moyenne aisée, alors la situation serait, pour les grands capitalistes, littéralement incontrôlable.
Au-delà du cas Mangione, Saint Luigi invite à élargir la focale et interroge plus profondément sur notre rapport à la violence en particulier politique. Bien sûr, l’acte de Mangione est violent. Mais il répond, montre Framont, à la violence de Thompson. La première chose est donc de nommer cette dernière pour ce qu’elle est : une violence. La seconde, nommer celui qui l’exerce : Brian Thompson. En d’autres termes, il s’agit tout d’abord de comprendre que le système capitaliste est violent – et pas une violence uniquement symbolique, désincarnée et éthérée, mais une violence réelle – et que le système capitaliste est incarné – par des individus de chair et de sang et non pas uniquement par des mécanismes impersonnels et insaisissables. Ne pas voir cela revient à commettre une erreur d’analyse majeure qui nous prive de moyens d’action décisifs. La violence capitaliste s’exerce sur les corps dominés, que ce soit au-travers de systèmes de santé injustes, mais aussi de réformes néolibérales rabotant les droits sociaux (réforme de l’assurance chômage, réforme des retraites), de mise en concurrence des individus et de conditions de travail insupportables, dangereuses et potentiellement mortelles. Mais ces violences sont invisibilisées voire niées dans les discours politiques ou médiatiques dominants : jamais les dégâts du système capitaliste ne sont montrés pour ce qu’ils sont, mais ils sont réduits à des enjeux d’adaptation individuelle. « Il faut qu’un bourgeois trouve la mort pour que l’attention journalistique apparaisse, qu’une soudaine prise de conscience dans les rédactions de tout le pays se fasse » (p.70) écrit très justement Nicolas Framont. Ainsi, l’acte de Luigi Mangione a d’abord « mis en lumière médiatique un système » (p.69). Et cette violence, on l’a dit, est exercée par des individus concrets qui donnent corps au « système », en l’occurrence Thompson incarnant United HealthCare et plus généralement le système assuranciel américain.
Parler de violence est primordial, car celle-ci « implique un responsable et une victime » (p.73), autrement dit, employer le terme revient à poser des enjeux cruciaux, en particulier celui de la responsabilité des dirigeants économiques, politiques ou médiatiques. C’est ce qu’a compris le tueur de Brian Thompson. Cela permet également de situer le débat à la bonne hauteur : celle de la survie des corps – individuels et collectifs. C’est en ce sens que Framont écrit que « ce livre parle de la lutte des classes telle qu’elle s’exprime dans nos chairs » (p.22). Le mot de violence est donc un terme à se réapproprier. Saint Luigi nous invite ainsi à rejeter les discours pacifistes lénifiants et les modes d’action inoffensifs et des modes de protestation « purement symboliques » (p.83) qui ne débordent pas du cadre institutionnel et légal, cadre lui-même de plus en plus restrictif pour ne permettre aucune action qui pourrait nuire de près ou de loin aux intérêts capitalistes. Rester dans le cadre, revendiquer l’absence de débordements et condamner par avance toute forme de violence revient à faire le jeu du système qu’on prétend combattre – c’est s’en faire l’allié objectif. Saint Luigi a démontré que seule la radicalité paye, et l’imprévisibilité. Agir hors du cadre institutionnel, hors du cadre syndical, des manifs déposées en préfecture, hors de la représentation politique… L’essai de Nicolas Framont propose un retour tout à fait intéressant sur ce que l’on a appelé « l’action directe » et invite en creux à renouer avec des stratégies et des tactiques de luttes protéiformes et radicales. Des stratégies ayant pour but de faire peur, d’effrayer, de menacer : « je crois, écrit Framont, que c’est toujours le potentiel de violence qui permet d’obtenir un rapport de force, plus que la violence elle-même » (p.76) – potentiel annihilé sur le champ si l’on renonce par principe et a priori à la violence. Une violence contenue, maîtrisée, dirigée et instrumentale, faute de quoi elle ne peut que se résumer à elle-même – une violence appelant toujours plus de violence. Il faut parvenir à ce que Nicolas Framont appelle une « éthique de la violence » (p.120) ciblée et limitée dans le temps et l’espace. « La violence ciblée de Luigi Mangion et l’air innocent qui le suit partout neutralise l’une des principales raisons […] de l’opprobre collectif jetées [sic] sur la violence révolutionnaire : la peur qu’elle suscite [chez les dominés] » (p.121). Après des détours historiques sur les modes que la violence révolutionnaire a adopté au cours des décennies, ses succès et ses échecs, Nicolas Framont propose donc une réflexion sur les types de stratégies à même de recréer un rapport de force, des stratégies utilisant au moyen des niveaux de violence différentiés.
Saint Luigi est un petit essai passionnant, facile d’accès et rapide à lire. Le sociologue et journaliste Nicolas Framont y montre le potentiel – et aussi les limites – d’une forme de réappropriation de la violence révolutionnaire. A lire !
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)

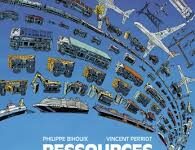

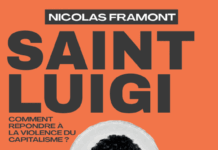
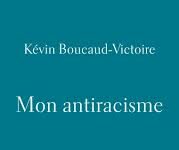
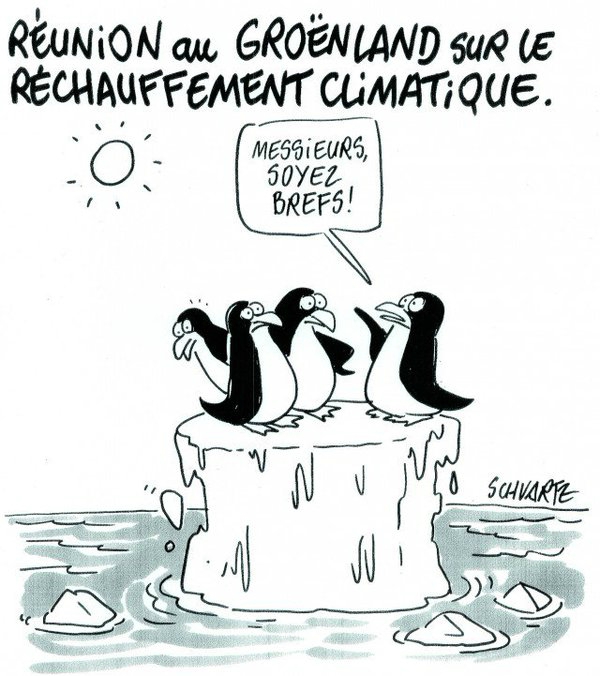

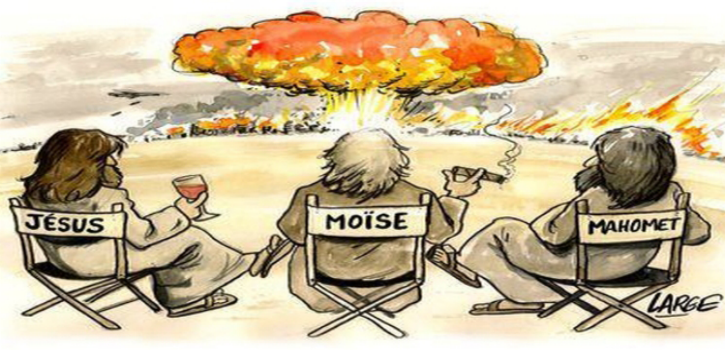
![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)





