[Présidentielle 2022]
Macron, le président illégitime
De la légitimité en démocratie
Au soir du 2nd tour de l’élection Présidentielle 2022, Emmanuel Macron est élu 11ème Président de la Vème République. La France s’enfonce donc encore plus dans les ténèbres de la destruction de la République sociale et de la démolition du politique. Soyez-en sûrs, malgré son discours aussi insipide que flou, aussi déconnecté du réel que lénifiant, malgré son « ce vote m’oblige pour les années à venir » qui laisserait penser qu’il a l’intention de prendre en compte ses opposants, malgré tout cela, Macron va se déchaîner. Il va ouvrir les vannes du mépris, de la casse sociale, de la violence symbolique et réelle. Il va mettre toutes ses forces à détruire le peu d’institutions sociales encore debout. L’autoritarisme ne connaîtra plus aucune limite. Dans cet article, j’analyserai brièvement les résultats électoraux, qui ne sont que l’écume des choses, pour me concentrer sur une réflexion autour de l’idée de légitimité et de justice.
Résultats
Les chiffres sont cruels pour le Président fraîchement réélu.
-Votes exprimés : 71.99% des inscrits – 91.5% des votants (en excluant les votes blancs et nuls). C’est-à-dire 28.01% d’abstention. N’oublions pas les 6% de votes blancs ou nuls en proportion des inscrits (soit 8.5% des votants).
-Emmanuel Macron : 35.52% des inscrits – 58.54% des exprimés. Ce qui représente 2 000 000 de voix de moins qu’en 2017.
-Marine Le Pen : 27.28% des inscrits – 41.46% des exprimés. Ce qui représente 2 600 000 de voix en plus qu’en 2017.
L’analyse est simple, et ne souffre aucune ambiguïté : Emmanuel Macron est élu avec une minorité des voix des citoyens français. C’est, après Pompidou en son temps (et dans des circonstances très particulières), le Président le plus mal élu de la Vème République.
Le score Macron est à peine supérieur à celui de l’abstention et des votes blancs ou nuls qui représentent 34.2% des inscrits – chiffre stable par rapport à 2017. Cela signifie qu’en France en 2022 un Président de la République peut être élu alors qu’il est majoritairement rejeté, et que l’élection elle-même est récusée par 1/3 des citoyens inscrits sur les listes électorales. Rappelons ici qu’en outre, 5% des citoyens en âge de voter ne sont pas inscrits sur les listes électorales.
Bien sûr, tous les soutiens de Macron fanfaronnent : le seul président à avoir été réélu sans cohabitation, le premier président réélu sous le régime du quinquennat, une victoire éclatante sur Marine Le Pen… Le blabla habituel. Des fossoyeurs qui dansent autour du tombeau qu’ils ont creusé, des charognards qui se repaissent d’une chair encore tiède, des assassins molestant post mortem le corps qu’ils ont achevé froidement. Alors que leur champion est en réalité élu par moins de citoyens qu’en 2017. Et je ne parle même pas de la proportion très importante de votes contre Le Pen… Certaines études la chiffrent à 42% (Ipsos Sopra Steria). Cela signifie que la minorité qui a pris le contrôle sur la France, une minorité d’intérêts – une classe sociale organisée et déterminée – qui se défend et ne recule devant rien, cette minorité donc se creuse et se rétrécit. Plus que jamais, l’oligarchie est visible – et elle fanfaronne. Une oligarchie autoritaire, de plus en plus oligarchique et de plus en plus autoritaire.
Décomposition politique
Si l’on remonte 15 jours en arrière, le premier tour a lui aussi été riche en enseignements, des enseignements confirmés par le second tour. Le premier détail notable, c’est l’éclatement manifeste du paysage politique français et surtout sa polarisation. Avec, en guise de première « force », l’abstention, qui a progressé de 22% à 26.3% des inscrits, soit plus que le score d’Emmanuel Macron. Macron qui ne représente, en fait d’adhésion à son programme, que 20% des électeurs inscrits. Les partis traditionnels se sont effondrés, l’affaire est entendue. Ne leur reste que leur hypothétique ancrage local, dont on verra vite s’il est encore d’actualité. Les législatives risquent de leur porter un coup fatal en finissant de les désosser. On se retrouverait donc avec un parti majoritaire ayant fini d’absorber les anciennes forces politiques dominantes (PS / LR et leur cohorte de grumeaux), achevant la dynamique amorcée en 2017 ; avec un bloc de droite mené par le RN, d’anciens LR plus durs que les autres, les jeunots de Reconquête[1], réalisant, malgré la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, une union des droite contrainte et forcée[2] ; et un bloc de gauche avec LFI en porte-étendard. Une tripartition de la vie politique française… en quatre blocs, car il ne faudrait pas oublier le bloc abstentionniste, majoritaire au premier tour. Cela donnerait raison à l’analyse particulièrement fine de Kevin Boucaud-Victoire, qui formule l’hypothèse d’un retour aux trois blocs politiques du XIXème siècle – le bloc abstentionniste en plus. Le journaliste et essayiste voit dans « l’affaiblissement du clivage gauche/droite, […] une nouvelle tripartition politique qui rappelle celle du XIXe siècle, où s’opposaient les Blancs (réactionnaires/conservateurs), les Bleus (libéraux-républicains) et les Rouges (socialistes) »[3]. L’Histoire se répète, semble-t-il.
Cela serait aussi la confirmation de la théorie de Jean-Claude Michéa qui parlait de « l’alternance unique » pour décrire la vie politique française : la gauche et la droite s’affrontent et se succèdent (alternance) mais pour conduire in fine peu ou prou la même politique libérale (unique). Macron réalise superbement ce schéma, puisque désormais il n’y a même plus d’alternance, juste un bloc libéral bourgeois autoritaire et hégémonique. Un « ni gauche ni droite d’en haut », pour reprendre encore les mots du philosophe.
Confusion pascalienne et illégitimité
L’enseignement majeur qui découle de cette élection, et que l’on peut tirer de l’analyse des scores, est simple. Emmanuel Macron n’est pas légitime pour exercer la fonction de Président de la République française. Je ne parle pas ici simplement des résultats, qui sont pourtant sans appel. A cette seule aune, Macron n’est pas le premier président français de la Cinquième république a avoir été élu après avoir récolté une minorité d’adhésion par les suffrages. Il n’est pas le premier président pour qui on doit mettre en doute la légitimité démocratique. Néanmoins, quelque chose d’inédit se passe. La démocratie ne se résume pas au vote, mais aussi aux institutions qui sont censées la faire vivre. Et en élargissant ainsi la focale, on ne peut que se désoler de ce que Macron nous a fait, au cours des cinq années écoulées, entrer pus profondément que jamais dans les ténèbres de l’oligarchie autoritaire. Certes cela fait belle lurette que la France n’est pas une démocratie, cependant nous atteignons un niveau sans doute inédit. Tous les contre-pouvoirs sont en passe d’être annihilés, les mouvements sociaux réprimés violemment, la volonté populaire majoritaire bafouée comme jamais.
Pourtant, Emmanuel Macron a, incontestablement, toute la légitimité institutionnelle que lui confère l’élection. Mais, est c’est bien là le point crucial, il nous faut plus que jamais déconnecter les institutions dites démocratiques et la démocratie. Les institutions sont aujourd’hui non seulement au service de l’oligarchie, mais pire, elles sont l’un des principaux outils de destruction de la démocratie. Voilà pourquoi on ne peut rien attendre des institutions. De la même façon qu’on ne peut attendre d’un fusil qu’il panse les plaies, on ne peut attendre d’institutions oligarchiques qu’elles pansent la démocratie.
Il faut donc opposer légitimité institutionnelle et légitimité démocratique. A l’aune de la seconde, il est clair qu’Emmanuel Macron n’est pas légitime. Son projet pas plus que sa personne ne sont des émanations de la volonté populaire. Au contraire, la majorité les rejette. Ce point est important à toujours garder en mémoire, car il est factuellement faux de dire que les Français auraient les dirigeants qu’ils méritent. Ils ne méritent pas des dirigeants qu’ils rejettent massivement.
La légitimité démocratique émane du peuple – demos – et de lui seul. Cela dit, il faut bien admettre que le peuple est une entité largement fantomatique et insaisissable. Beaucoup considèrent même que le peuple n’existe pas au motif qu’il serait une pure construction sémantique, un fantasme sans fondement réel, une vue de l’esprit, une abstraction. J’ai longuement écrit sur le peuple, sur sa réalité, sa consistance, sa permanence[4]. Le peuple n’est ni une entité abstraite surplombante, informant les masses depuis le ciel des idées pures comme une sorte d’esprit insaisissable, il n’est pas non plus, comme le prétendent les libéraux, une fiction dans la mesure où n’existeraient que des individus. Il émane de relations concrètes et situées, il est un processus infini, ce que j’ai appelé, après Bernard Stiegler, un « processus de transindividuation ». Oublions les mots compliqués, le peuple « est une manifestation de la puissance du collectif »[5] dont la spécificité est qu’il est « le politique en tant que tel »[6]. On pourrait dire du peuple qu’il est le corps politique lui-même. Autrement dit, le peuple est premier, car le collectif est premier par rapport à toute institution. L’institution n’est jamais qu’une cristallisation, presque au sens du Stendhal de De l’amour, autour d’un collectif et des affects communs. Cependant, lorsqu’elle est cristallisée, elle finit par exister pour elle-même et échappe aux affects collectifs qui lui ont donné le jour, et peut même se retourner contre eux. C’est exactement ce que nous vivons.
Ainsi, ce retournement conduit à penser que le Président serait le représentant des Français parce qu’il a été élu. L’élection serait une onction qui octroi de facto la bénédiction du peuple. Autrement dit, le Président est le représentant du peuple parce qu’il est élu, au lieu d’être élu parce qu’il est le représentant du peuple – ce qui serait la démocratie. On essaie de persuader le peuple qu’il est effectivement représenté par des gens qu’il a en fait rejeté. Ce renversement relève de ce le philosophe Blaise Pascal aurait appelé la confusion des ordres :
La tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu’on ne peut avoir que par une autre. On rend différents devoirs aux différents mérites : devoir d’amour à l’agrément, devoir de crainte à la force, devoir de créance à la science.
On doit rendre ces devoirs-là, on est injuste de les refuser, et injuste d’en demander d’autres.
Ainsi ces discours sont faux et tyranniques : je suis beau, donc on doit me craindre ; je suis fort, donc on doit m’aimer ; je suis… Et c’est de même être faux et tyrannique de dire : il n’est pas fort, donc je ne l’estimerai pas ; il n’est pas habile, donc je ne le craindrai pas.
La tyrannie consiste au désir de domination universel et hors de son ordre.[7]
Il y a confusion des ordres chaque fois que l’on exige d’un ordre les devoirs dus à un autre. Pour être clair, quand on exige de reconnaître la légitimité populaire d’un Président qui n’est pas élu par le peuple, on commet une telle confusion, que Pascal n’hésite pas à qualifier de tyrannique. Lorsque les citoyens sont sommés de tenir pour leur représentant légitime un dirigeant qui n’a qu’une légitimité institutionnelle déconnectée de la volonté populaire, c’est la même chose. Cette idée d’ordres hétérogènes qui appellent des devoirs eux-aussi hétérogènes est fondamentale, en particulier dans une démocratie qui est par excellence le régime de la recherche de l’équilibre et de la justice. Pascal parle très justement d’injustice dans ce fragment des Pensées, ce n’est pas pour rien. La justice condense tout à la fois l’exigence de vérité, c’est-à-dire de justesse, et celle de mesure. Dikē, la justice chez les Grecs, est inséparable de l’apparition et de la pratique du politique. Chez Platon[8], qui d’une certaine façon reprend les grands mythes grecs, « puisque Zeus a fait distribuer dikē et aidōs à tous, tous les hommes ont la capacité de participer au débat politique ; c’est là le minimum requis pour être citoyen »[9]. Du moins est-ce la position de Protagoras dans le dialogue du même nom. La justice (dikē) et la pudeur ou la honte ou encore, chez Bernard Stiegler, « le sentiment d’être mortel, savoir qu’on est un mortel, et qu’en tant que mortel il y a des choses qu’on ne peut pas faire »[10] (aidōs), ces deux vertus forment ensemble un couple à l’origine du politique. Mais la justice forme un autre couple, antagoniste cette fois-ci, avec hybris, la démesure. L’inverse de la justice, c’est précisément d’être dans la démesure, d’outrepasser les limites, la première forme d’hybris étant de se prendre pour un dieu. L’hybris est l’autre nom, chez les grecs, de la confusion des ordres, et elle est l’injustice fondamentale. Tout cela n’est pas sans lien avec une conception du politique comme conséquence du « don » maussien, cette réalité anthropologique concrète à la base des sociétés humaines archaïques – et donc de la notre – selon l’anthropologue Marcel Mauss[11]. Les sociétés humaines, soutient l’anthropologue, sont basées sur la triple obligation de donner, recevoir et rendre, d’échanger des dons (de parole, de femmes, de biens, mais aussi de coups, de violence…) qui, par leur circulation incessante et les dettes symboliques qu’elles créent, formant des liens d’interdépendance réciproque entre les donateurs, permet d’établir le lien social et politique. Les grecs, bien sûr, ne formulaient pas les choses ainsi, pourtant, aidōs et dikē sont un « don fait par Zeus par l’entremise d’Hermès »[12], une sorte de don primitif, ce qu’Alain Caillé appellerait un « don vertical », entre les dieux et les hommes à l’origine du politique. Mais on trouve également au sein d’aidōs et de dikē des éléments constitutifs du don. Aidōs est, on le voit à travers ce qu’en dit Bernard Stiegler, le sentiment dans lequel la « décence commune » plonge ses racines. Comme l’aidōs, « la common decency ne peut jamais que s’exprimer sous forme d’une interdiction : ‶il y a des choses qui ne se font pas″ »[13]. Comme je le montre dans Ce que le marché fait au monde, la décence commune est la manifestation morale de l’esprit du don. L’aidōs grec, en tant qu’il est « à la fois de la réserve et le sentiment de honte, fondé sur le respect qu’on se doit à soi-même autant qu’on le doit à autrui »[14], est au fondement de l’éthique, cette éthique que l’on retrouve dans la décence commune, engendrée par le don. Quant à dikē, ses liens avec l’esprit du don semblent bien plus évidents. Donner, recevoir et rendre, voilà trois actions qui impliquent en elles-mêmes la justice, et plus particulièrement le troisième terme du cycle, « rendre », qui est aussi le premier terme d’un nouveau cycle qui s’enclenche, « donner ». Au moment où l’on rend, on donne, relançant par la même occasion la valse des dons. Or, le contre don demande de faire preuve de justice et de justesse, car un contre don injuste (trop mesquin par exemple) briserait la chaîne infinie du don et entraînerai la guerre. Le don requiert également de façon particulièrement aiguë une fine connaissance des différents ordres symboliques dans lesquels chaque don prend place. Au don d’une femme, dans une société archaïque, on ne peut répondre que par le don d’une autre femme ; au don de certains biens on ne peut que répondre par le don de certaines monnaies ou de certains autres biens etc. Or, on l’a vu, le respect des ordres symboliques est inséparable de la justice. Tout cela pour dire que, finalement, l’idée d’ordres, au sens pascalien, est profondément ancrée dans l’exigence de justice et de don, c’est-à-dire dans le politique en tant que tel.
Nous sommes dans cette forme de démesure, de confusion, d’injustice – d’hybris. Ce qui ne peut qu’évoluer, Pascal est très clair, vers la tyrannie. La légitimité, puisque c’est de cela que nous étions partis, est légitime précisément parce qu’elle connaît ses limites, celles de l’ordre dans lequel elle est légitime. La légitimité est intimement liée à un ordre particulier, autrement dit, à chaque domaine correspond sa propre légitimité, et profiter de la légitimé conférée par un domaine pour prétendre à la légitimité dans un autre, c’est cela la confusion des ordres et, par voie de conséquence, la tyrannie. Toute la vie démocratique repose sur cette idée de limites, elle est le régime politique qui est le plus attaché à délimiter le plus finement les ordres et les domaines de légitimité qui s’y attachent – précisément au nom de la lutte contre la tyrannie.
La démocratie avant les institutions
La démocratie est nécessairement un processus qui part du bas vers le haut, qui fait émerger des représentants ou des décisions politiques à partir du peuple des citoyens. Or notre régime procède à l’exact opposé : du haut vers le bas. Les citoyens ne sont bons qu’à valider des décisions ou des dirigeants pré-choisis, à aucun moment ils n’exercent réellement le pouvoir.
De là le décalage entre légitimité institutionnelle ou formelle et légitimité démocratique ou populaire. Quand l’institution dite démocratique tourne à vide, pour elle-même, et qu’elle est au service d’intérêts particuliers, ceux de la classe dominante, elle se déconnecte du peuple et joue contre lui. Macron prend toute sa place dans ce dispositif, il en est même la pierre angulaire. Il est celui qui a porté le plus haut le décalage entre les institutions et le peuple dont elles sont censées être l’émanation. Sa réélection dimanche 24 avril n’en est qu’une manifestation claire et évidente. Je le redis, il devrait être inconcevable, en démocratie, qu’un dirigeant soit élu avec à peine plus d’un tiers des votes des citoyens inscrits sur les listes électorales. Mais cela ne dérange, semble-t-il, personne, ce qui est la marque que la déchéance démocratique que nous vivons est très profonde et qu’elle ne concerne pas que les classes dirigeantes. La société elle-même semble avoir accepté l’idée d’une fausse démocratie mais vraie aristocratie et semble incapable de penser la démocratie comme mode d’exercice du pouvoir politique par le peuple des citoyens.
Cependant, là encore, un décalage se fait de plus en plus jour entre les citoyens et ceux qui ont une forme de parole publique « autorisée » : journalistes, personnels politiques, penseurs, artistes, intellectuels… tous défendent, ou presque, la dite démocratie représentative actuelle et les institutions censées la garantir. Alors que, ce que les Gilets jaunes ont montré, et que les élections confirment, c’est que du côté des citoyens sans parole, ou qui n’ont qu’une parole « empruntée » ou « volée »[15], la critique des institutions actuelles est forte, vivace et prend de l’ampleur. Sans grands concepts, les Gilets jaunes ont saisi l’essentiel de l’aspiration démocratique, bien plus en tous cas que tous les intellectuels qui déblatèrent à longueur de journée sur les radios, plateaux télé, journaux ou grands médias en ligne. C’est pour structurer cette remise en cause globale des institutions actuelles qu’il nous faut repenser de fond en comble la démocratie et en revenir aux principes mêmes.
Je l’ai dit à maintes reprises, avant de rebâtir les institutions, il faut savoir quelles fins elles doivent viser. Et cela passe nécessairement par un travail de conceptualisation de la démocratie. On ne peut bâtir d’institutions démocratiques si l’on ne sait pas ce qu’est la démocratie, c’est une évidence. La première des étapes est la remise en cause systématique des institutions actuelles. Institutions qui n’ont plus aucune légitimité démocratique – et les dirigeants, par voie de conséquence, non plus. Le combat doit se jouer ailleurs que dans les institutions en place. Il faut (ré)investir le champ de la lutte sociale et de la critique. Les seuls progrès véritables ne viendront que « d’en bas » pour reprendre l’expression de Jean-Claude Michéa.
Entre illégitimité du Président élu, formation d’un bloc libéral autoritaire hégémonique et décomposition du champ politique, cette élection apparaît comme une sorte de croisée des chemins. Nous le savions déjà, mais nous ne pouvons désormais plus feindre de l’ignorer : rien de bon ne sortira d’institutions anti-démocratiques. Peut-être peut-on, comme les Insoumis et leur « Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale », essayer de limiter les dégâts lors des législatives. Mais n’oublions pas que tout le système institutionnel français verrouille la possibilité même d’un changement de paradigme politique. La lutte politique par d’autres moyens est notre seul espoir à présent.
[1] On verra à ce moment à quel point tous les transfuges du RN qui ont, par pur opportunisme, rejoint Zemmour, ont été d’une stupidité politique abyssale. Ils doivent aujourd’hui s’en mordre les doigts, quittant le navire pour un rafiot. En premier lieu Marion Maréchal Le Pen, qui a fait preuve d’une lucidité politique sans égale – l’ironie est de mise. La pauvrette se croyait maîtresse en stratégie politique, elle a été mise échec et mat par sa tante.
[2] Ce qui, finalement, serait l’ultime ironie pour Zemmour et Le Pen nièce, qui rêvaient de cette union des droites. Elle risque de se faire… contre eux.
[3] https://twitter.com/K_Boucaud/status/1513244764908531716
[4] Geoffrey Mercier, Ce que le marché fait au monde, neuvième chapitre, « Vive le peuple ! », L’Harmattan, 2020.
[5] Idem.
[6] Idem.
[7] Blaise Pascal, Pensées, éditions de Louis Lafuma, Seuil 1963, fragment 58.
[8] Rappelons ici que La République est sous-titré en Grec Peri dikaiou, « de la justice ». Dikē est la vertu fondamentale du politique.
[9] Jean Philippe A. Beaudin, La figure mythique de Promethée dans la philosophie de Platon, mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en philosophie, Université du Québec à Montréal, juin 2011.
[10] Entrevue de Bernard Stiegler, https://www.fondationostadelahi.tv/interviews/bernard-stiegler-definition-dethique/
[11] Marcel Mauss, Essai sur le don, Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 1924.
[12] Jean Philippe A. Beaudin, La figure mythique de Promethée dans la philosophie de Platon, art. cité.
[13] Geoffrey Mercier, Ce que le marché fait au monde, op. cité.
[14] Casevitz, Michel. « L’expression de l’intime et de l’intimité dans la langue grecque », Champ psychosomatique, vol. no 27, no. 3, 2002, pp. 123-126.
[15] Empruntée ou volée car on ne les entend jamais qu’à l’occasion de manifestations ou de mouvements sociaux d’ampleur. Ils « volent » leur représentation aux grands médias dominants, qui se passeraient très bien de leur donner la moindre visibilité et s’accorderaient très bien de les tenir invisibles et inaudibles. En ce sent, leur parole publique se distingue de la parole publique que j’ai appelée « autorisée ». Elle n’est que tolérée, et encore… Le principal procédé d’invisibilisation des citoyens consiste à les « représenter » sur le plan politique – c’est la démocratie représentative. Ne dites rien braves gens, vos représentants s’en chargent. C’est toute la thèse de l’essai important d’Harold Bernat, La défaite de la majorité, Atlantiques déchainées, 2022. Plus leurs représentants parlent pour eux, moins les citoyens ont la parole. La prise transgression est donc de laisser s’exprimer les gens directement, c’est ce qui fait le plus peur au système : des citoyens qui prennent la parole sans truchement, sans « représentants ».
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



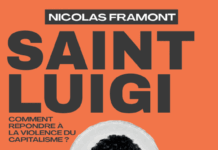




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)







