L’esprit du macronisme
ou l’art de dévoyer les concepts
Myriam Revault d’Allonnes
Seuil, 2021
Emmanuel Macron, rappelez-vous, fut un temps présenté comme un surdoué de la philosophie, un rival de Hegel, Kant ou Platon, en même temps qu’un homme politique génial égalant Machiavel et de Gaulle. Sa doctrine, bijou de pensée politique descendu des nuées sur des coussins de brocart et d’or, fut baptisée « macronisme ». Et c’est justement de cette pseudo-doctrine que Myriam Revault d’Allonnes, philosophe du politique enseignante et chercheuse, entend, dans L’esprit du macronisme, montrer l’insigne imposture. Dans ce petit livre de philosophie, dense mais très accessible, la philosophe étudie le rapport du discours macronisme à trois concepts politiques essentiels : autonomie, responsabilité et capacité. Au-delà des décisions politiques concrètes, Myriam Revault d’Allonnes s’intéresse à l’imaginaire du macronisme, à sa vision du monde sous-jacente. « Dans quel univers mental s’inscrit-il ? A quel style de vie […] renvoie-t-il ? En bref, quel est le cadre de sa rationalité anthropologique et politique ? »(p.7)
Très tôt, la réponse à ces questions est donnée. L’esprit du macronisme s’inscrit dans un « esprit du temps » (Zeitgeist disent les allemands), un bain mental qui imprègne les individus malgré eux, qui se nomme : « néolibéralisme »(p.11)). L’essai de Myriam Revault d’Allonnes va s’attacher à montrer que, relativement aux concepts d’autonomie, de responsabilité et de capacité, le fond idéologique du macronisme est bel et bien le néolibéralisme. Quelle est la spécificité de ce fond idéologique néolibéral ? L’esprit du macronisme le repère dans une inversion conceptuelle constitutive de la modernité, qui renverse la perspective du lien de l’individu au social. Pour dire les choses très simplement, les pré-modernes en général, et les grecs en particulier, pensaient que l’individu n’existait qu’à travers son existence sociale, c’est-à-dire qu’il n’y avait point d’individu humain en dehors des institutions et de la société ; alors que les Modernes, dont le philosophe anglais Thomas Hobbes, dont le néolibéralisme hérite, considèrent que la société est extérieure aux individus, qu’ils lui pré-existent. Dans cette perspective, la grande question des modernes et de se demander à quelle condition et dans quelles circonstances des individus humains choisissent de l’assembler en corps social. Au-delà même, c’est la liberté qui est en jeu : nécessairement construite à travers le lien social pour les uns, elle est inhérente aux individus et menacée par la société pour les autres. Ainsi, la question de la finalité du politique (la « vie bonne » chez Aristote) « est désormais supplantée par la nécessité de construire un ordre politique à partir d’une multiplicité d’individus installés en posture de fondement avant toute constitution du lien social »(p.26). Selon les Modernes, donc, « la politique est avant tout l’instrument et la garantie de la réalisation des finalités individuelles »(p.27). L’individu est placé au-dessus de toute collectivité ou institution, qui n’ont d’autre fonction que de le servir.
Voilà le pêché originel de la pensée Moderne, reprise par les néolibéraux : défaire le lien, plus, la dépendance, entre les individus et la société. L’esprit du macronisme mobilise un certain nombre de penseurs du politique pour expliciter ce lien indissoluble : Hegel, Montesquieu, Rousseau ou encore Kant pour les principaux. « Contre l’atomisme politique et la fragmentation des individus isolés […], Hegel soutient, à la lumière de la cité grecque et de sa possible actualisation, que l’entrée en institution est la condition du développement des capacités et des dispositions qui constituent l’agir humain. »(p.28) L’Homme n’est vraiment libre, donc vraiment humain, que parce qu’il appartient à une société structurée par des institutions collectives. Mais Myriam Revault d’Allonnes va plus loin en affirmant que « la réciproque est que les institutions, d’un point de vue anthropologique, sont elles aussi « endettées » à l’égard des individus : elles ne peuvent se soustraire à leur tâche qui consiste à produire les conditions de possibilité d’une véritable autonomie »(p.29)[1]. Ainsi, individus et institutions sont l’avers et le revers d’une même médaille, ce que rejette précisément le néolibéralisme, pour lequel il n’existe que des individus naturellement libres et autonomes qui s’assemblent, afin de maximiser leurs intérêts et au terme d’un calcul pesant les coûts et les bénéfices, en sociétés ou communautés.
On voit d’ores et déjà comment, à partir de ces considérations de Myriam Revault d’Allonnes, s’agencent les trois principaux concepts qu’elle analyse dans L’esprit du macronisme. Puisque le néolibéralisme sépare à toute force l’individu et le social, il est obligé de postuler l’individu autonome et libre, a priori de toute autre détermination. Parce qu’il est autonome, autosuffisant et foncièrement libre, l’individu néolibéral est seul responsable de ses actes et réciproquement, tous ses actes sont de sa responsabilité. Enfin, la capacité de l’Homme est celle de calculer, de soupeser, de compter au mieux, de maximiser ses intérêts. Bien sûr, ce sont de terribles dévoiements et d’atroces réductions que le macronisme néolibéral fait subir à ces concepts essentiels. Et c’est justement ce dévoiement qu’analyse par la suite Myriam Revault d’Allonnes.
L’autonomie est inséparable de l’idée d’émancipation, car l’autonomie n’est jamais acquise ni assurée une fois pour toute, elle est une « tâche indéfiniment relancée, dans sa complexité et avec toutes les ambiguïtés dont elle est porteuse »(p.44). Elle est le fruit d’un effort, avant tout d’un effort sur soi-même. C’est la fameuse formule de Kant dans Qu’est-ce que les lumières ? : « Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. » Autrement dit : penser par soi-même. Or, cela implique, selon Kant, « de pouvoir réfléchir sur son propre jugement du point de vue de l’universel »(p.44), c’est-à-dire depuis le point de vue d’autrui, d’un autrui absolu. C’est l’inverse même de la pensée close, repliée sur elle-même et autosatisfaite. Cette ouverture se traduit politiquement : la liberté autonome naît dans les institutions et le social qu’elle rencontre – en même temps qu’elle les crée[2]. « A cet égard […], les paradoxes de l’autonomie sont présents dès l’avènement de la modernité : l’affirmation de la souveraineté de l’individu rentre inévitablement en tension avec l’entrée en institution. »(p.46) Or, le macronisme nie précisément cette tension : pour lui, la liberté est liberté de choisir rationnellement ses intérêts, l’autonomie consiste en l’évacuation du collectif qui est vu comme une pesanteur, un frein, que l’individu « entrepreneur de lui-même » doit utiliser comme un instrument au grès de ses intérêts bien compris. « L’individu dit autonome, c’est l’homme entrepreneur et entrepreneur de lui-même »(p.48). C’est le sens, tel que l’analyse Myriam Revault d’Allonnes, de la formule de Macron souhaitant que la France devienne une start-up nation. La forme de l’entreprise doit dominer partout et tout le temps.
Le concept de responsabilité a lui aussi été vidé de toute sa complexité au profit d’une vision purement calculatrice et économique des rapports humains. Dans la philosophie classique, l’homme était considéré comme responsable des actes commis, en toute autonomie. On ne peut être tenu responsable au sens juridique s’il n’existe pas de liberté ni d’autonomie. En revanche, la responsabilité était aussi vue comme « imputation »(p.60) : autonome ou pas, c’est bien moi qui ait fait cela, j’en suis donc responsable. Au XXème siècle, la responsabilité a pris une extension maximale : sous l’impulsion de penseurs comme Hans Jonas, elle est devenue responsabilité face aux conséquences futures de nos actions collectives. Nous sommes à présent responsables des générations futures et du monde que nous leur laisserons. Dans tous les cas, la responsabilité se fonde sur l’existence d’autrui, un autrui fragile et vulnérable dont la fragilité même appelle et requiert que j’en prenne soin (Levinas). Mais avec l’individualisme fou du néolibéralisme managérial, exit autrui comme fondement de la responsabilité : je ne suis responsable que de moi-même. Je suis responsable du calcul optimal de mes intérêts, que je dois pouvoir assurer, à tous les sens du terme. C’est donc le développement de toutes les assurances privées, puisque je dois être seul à m’assumer et me prendre en charge, hors de tout cadre collectif. Macron l’a bien compris : « la responsabilité du chômage incombe avant tout au chômeur à qui il suffirait de traverser la rue pour trouver du travail »(p.70).
L’esprit du macronisme montre un semblable réductionnisme s’agissant de la capacité : négation du collectif, de la complexité, de l’ambiguïté au profit de la capacité à conduire rationnellement sa vie comme une entreprise. Ce sont toutes les injonctions actuelles à la performance, que ce soit dans le monde du travail, mais aussi dans la vie privée : l’individu doit être performant – selon des critères économiques – à chaque instant de sa vie.
On pourrait développer longuement, tant L’esprit du macronisme est dense, riche et stimulant. Un petit livre, vite lu, très accessible, loin du jargon et avec un réel souci pédagogique, mais qui va au cœur des concepts abordés. La philosophe Myriam Revault d’Allonnnes signe un livre important par sa densité et sa critique radicale du macronisme. Un travail percutant. Bonne lecture !
[1] J’ai, pour ma part, développé longuement ce thème dans Ce que le marché fait au monde, en montrant que ce processus d’endettement mutuel des institutions et des individus est structuré par l’échange de « dons/contre-dons » découvert par Marcel Mauss. Je montre aussi que cet endettement s’inscrit dans une spirale de « transindividuation » au sens de Bernard Stiegler. Tous ces concepts sont fondamentaux pour (re)penser le rapport entre l’individuel et le collectif. En outre, il ne s’agit pas de pôles figés qui se font face : l’individu est collectif, comme le collectif est individuel. C’est ce que le développe longuement dans cet essai.
[2] Là encore je renvoie à Ce que le marché fait au monde : l’institution est produite par la multitude, par le corps social lui-même. C’est sa manière de prendre en charge (prendre soin) le don/contre-don qui est un pharmakon, c’est-à-dire remède en même temps que poison.
Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !
Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !
Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !



![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)



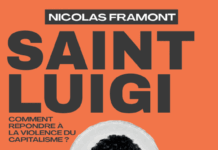




![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)




